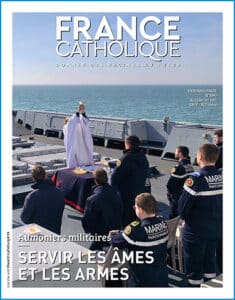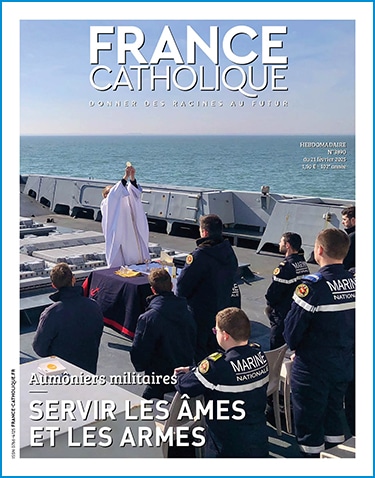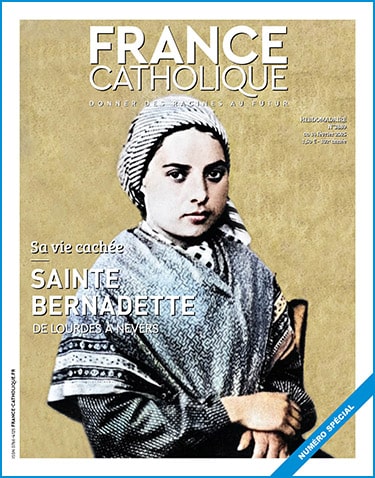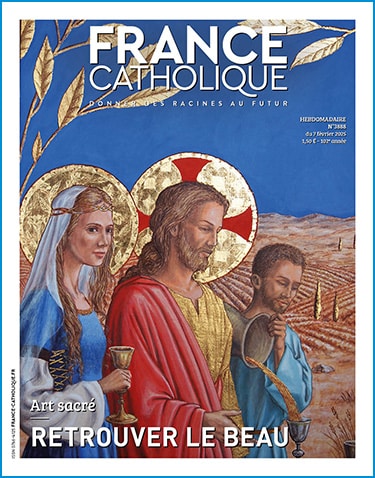SOIT QU’ILS S’EN FÉLICITENT, SOIT qu’ils le déplorent, ceux qui imaginent des contradictions entre la science et la foi montrent surtout leur ignorance de la science telle qu’elle est.
Par « telle qu’elle est », j’entends telle que les savants la pratiquent. Car une autre idée de la science bourdonne dans le cerveau de nos contemporains comme un infatigable bourdon, toujours présent, toujours menaçant : c’est la « science » des idéologies. Cette science-là n’existe pas. C’est une pure rêverie. Il faut, pour y croire, n’avoir jamais cherché, ce que font par métier les chercheurs, qui sont les seuls « savants » connus. Vous remarquerez qu’aucun « savant » ne se désignera jamais de ce nom. Il se dit « chercheur », ou « homme de science ».
La pseudo-science des idéologies est une idée creuse que l’on peut définir sans trop de difficulté. C’est un « monument » (le lieu commun du « monument où chaque chercheur apporte sa pierre »), un monument bien architecturé et qui se compose d’un certain nombre de « vérités démontrées » s’emboîtant les unes dans les autres1.
Mais qu’est-ce qu’une « vérité scientifique » ? C’est ici qu’il faut regarder de près et considérer, non pas ce que l’on rêve, mais ce que font les savants, pardon, les chercheurs.
Une « vérité scientifique » ne se présente sous sa forme dogmatique que dans les théories, par exemple v = gt, ou p = mg. Cette forme dogmatique est essentielle à la science. C’est elle qui permet le calcul, la prévision des résultats, l’expérience et l’application.
Passons sur l’application, qui consiste à utiliser des résultats connus et nous ramène donc à ceux-ci.
Qu’est-ce qu’un résultat ? Il ne faut pas imaginer un résultat prévu et vérifié (donc provisoirement tenu pour vrai) sous la forme absolue exprimée par la théorie ou la formule. Diable non ! Jamais un résultat ne se présente ainsi réellement ! Alors comment ? Il suffit d’ouvrir une publication scientifique, n’importe laquelle, et à quelque discipline qu’elle appartienne sans aucune exception (sauf les pures mathématiques), pour voir à quoi ressemble un « résultat », même si l’on n’y comprend rien (ce n’est pas nécessaire). Que voit-on ?
On voit un graphique avec deux lignes qui se croisent à angle droit en un point appelé zéro ; puis on voit une ou plusieurs courbes dans ce graphique ; enfin l’on aperçoit ce qui est à proprement parler le résultat : c’est-à-dire des points jetés sur le graphique ; en regardant bien, on constate que les points ont une tendance (plus ou moins évidente) à se grouper selon le dessin de la ou des courbes, par exemple presque tous sous la courbe, ou bien presque tous sur la courbe, ou bien entre les deux courbes s’il y en a deux, etc.
Il n’existe aucun phénomène connu qui se manifeste par des résultats tombant exactement sur le graphique comme le prévoit la théorie représentée par la courbe. Et ceci en premier lieu pour une raison bien simple qui est l’approximation de la mesure. Il n’y a pas de mesure absolue ! L’appareil expérimental est inévitablement un « machin » plus ou moins raffiné, comme notre œil par exemple, qui est un merveilleux appareil expérimental, mais qui ne peut pas distinguer une par une toutes les feuilles de la forêt, là-bas. On a fait au laser des mesures de la distance de la lune à dix centimètres près : c’est extraordinaire ! Le laser permettrait de suivre la course d’un lapin sur la lune. Mais enfin, restent les dix centimètres : IMPOSSIBLE (pour le moment) de suivre à cette distance avec un laser le vol d’une mouche2.
Les progrès de la science consistent sans exception, soit à découvrir de nouvelles choses à mesurer, soit à affiner les mesures existantes. D’ailleurs, c’est très souvent en affinant ces mesures qu’on découvre un phénomène nouveau, parfois révolutionnaire, dissimulé jusque-là dans le flou des mesures.
L’autre moyen de découvrir du nouveau est d’affiner la théorie, de lui trouver des conséquences à quoi l’on n’avait pas pensé… ce qui conduit souvent à des expériences montrant que ces conséquences n’existent pas, et que la théorie, jusque-là réputée « vraie », doit être remplacée. C’est ainsi par exemple que s’est imposée la théorie des quanta, il y a tout juste 78 ans : la théorie existante prévoyait une certaine courbe, et le rayonnement ultraviolet dans le corps noir, bien mesuré, refusait de se porter sur la courbe. Catastrophe ! Mais toute la science moderne en est sortie, la bombe, l’ordinateur, la télévision…3
Maintenant, comment la science ainsi comprise (et il n’y a pas d’autre façon de la comprendre) pourrait-elle rencontrer et éventuellement contredire la religion ?
En science, tout est mesure et spéculation sur des mesures. On ajoutait naguère à la mesure le classement pour intégrer les sciences biologiques et historiques. Mais avec la statistique, puis l’ordinateur, les classements se présentent eux aussi comme des mesures, et l’on peut désormais dire de toute science ce que Lord Kelvin disait des sciences « sérieuses » de son temps, c’est-à-dire les sciences physiques : « ce que l’on ne peut mesurer, on ne le connaît pas. »
On ne le connaît pas, s’entend, scientifiquement. Il se trouve que, précisément, ce qu’il y a de plus vrai, de plus profond, de plus certain en ce monde est par essence réfractaire à la mesure, non pas pour nous croyants, mais pour tout homme pensant. Sur Lord Kelvin pleurant au chevet de sa mère morte, on pourra mesurer toutes les corrélations physiques de la douleur. Mais sa douleur elle-même, solitaire, unique dans l’histoire du monde comme toute expérience intérieure, rien jamais ne la mesurera. Ou admettons même qu’on la mesure : le plus important restera que sa douleur est sienne à jamais, incommunicable, impartageable, toute mesurée qu’elle est4.
Mais où donc se situe l’expérience religieuse ? Dans la dernière solitude, celle qui n’a que deux témoins, la conscience Vivante et le Dieu invisible, « non pas, rappelle Pascal, celui des philosophes et des savants », mais le Dieu « sensible au cœur »5.
Et plus la science progressera, plus émergera l’évidence de cette solitude impartageable, irrémédiable, franchissable par le seul mystère de l’infini amour, parce que de son acte éternellement créateur tout procède, y compris l’insondable univers que la science explore.
Aimé MICHEL
Chronique n° 314 parue dans F.C.-E. -N° 1660 – 6 octobre 1978. Reproduite dans La clarté au cœur du labyrinthe, Aldane, Cointrin, 2008 (www.aldane.com), chapitre 24 « Ce que la science ne mesure pas », pp. 617-619.
—-
Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 16 décembre 2013
- Pour une critique de cette idée tenace de la science comme monument, voir par exemple les chroniques n° 34, Auguste Comte et le père Noël (27.09.2010), en particulier la note 1 sur le « disparate de la science », et n° 329, Superstition de notre temps dans La clarté au cœur du labyrinthe (Aldane, Cointrin, www.aldane.com, p. 499). Cette vision statique de la science « achevée » (ou qui se présente comme telle) doit être équilibrée par une vision dynamique de la science en train de se faire, voire de la science comme ignorance à surmonter. On en trouvera une application dans la chronique n° 157, L’apologue d’Alfred Kastler – D’où vient l’information qui se manifeste dans la complexité des êtres vivants ? 03.06.2013.
Cet article mérite d’être lu et relu car les idées qu’il exprime touchent à l’essentiel et sont rarement formulées avec autant de force et de lucidité. Sa méditation est rendue d’autant plus nécessaire que la société actuelle est dominée par un matérialisme diffus mais omniprésent, fondé sur des arguments qui n’ont que l’apparence de la solidité et qui suscite des oppositions également simplistes. Ce contexte est bien décrit par le généticien Francis S. Collins, qui a dirigé le projet de décryptage du génome humain : « Au XXIe siècle, écrit-il, dans une société de plus en plus technologique, une bataille fait rage dans les cœurs et les esprits. Nombre de matérialistes, notant triomphalement que les progrès réalisés par la science tendent à combler toujours davantage les failles dans notre compréhension de la nature, annoncent que la croyance en Dieu est une superstition dépassée, et que nous ferions mieux de l’admettre et d’avancer. De nombreux croyants, convaincus que la vérité qu’ils puisent dans l’introspection spirituelle est auréolée d’une valeur bien plus durable que celle des vérités acquises à partir d’autres sources, perçoivent les progrès de la science et de la technologie comme dangereux et peu fiables. Les positions se durcissent. Les voix sont de plus en plus stridentes. » Faut-il tourner le dos à la science ou à la foi ? « Ces deux choix sont aussi profondément dangereux l’un que l’autre. Les deux nient la vérité. (…) Les deux seront dévastateurs pour notre avenir. Et les deux sont inutiles. Le Dieu de la Bible est également celui du génome. Il peut être vénéré tant dans une cathédrale que dans un laboratoire. » (De la génétique à Dieu, trad. Alessia Weil, Presses de la Renaissance, Paris, 2010, pp. 194-195).
- La distance de la Terre à la Lune est de 384 400 km en moyenne mais elle varie beaucoup au cours du mois lunaire, entre 356 400 km au plus près et 406 700 km au plus loin, en raison de la forme elliptique de l’orbite lunaire.
Cinq réflecteurs ont été placés sur la Lune dans les années 1970 par les missions Apollo 11, 14 et 15 ainsi que par les sondes robots soviétiques Lunokhod 1 et 2. Quatre de ces réflecteurs sont toujours utilisés pour mesurer la distance Terre-Lune avec une précision centimétrique en mesurant le temps que met un rayon laser émis à partir de la Terre à revenir. Cela permet de savoir que notre satellite s’éloigne d’environ 3,7 cm par an. Plusieurs observatoires dans le monde mesurent cette distance ; l’un d’entre eux est sur la Côte d’Azur, près de Grasse.
Actuellement, la distance Terre-Lune est déterminée à 4 mm près, la précision atteinte sur la mesure du temps de vol des photons étant d’environ 10-10 secondes soit 100 picosecondes. Cela permet de vérifier avec cette précision l’accord entre l’observation et les calculs fondés sur la relativité générale. Pour aller plus loin sur ce sujet, on pourra lire l’article de Kenneth Nordtvedt, « La lune au secours d’Einstein. Entre la relativité générale et les théories rivales, la distance Terre-Lune », La Recherche, n° 295 de février 1997 et http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/XML/db/csphysique/metadata/LOM_CSP_laser-distance-terre-lune.xml
On sait, grâce aux relevés des dates et heures des éclipses par les astronomes babyloniens et chinois que l’éloignement de la Lune se poursuit à une vitesse constante depuis l’antiquité. Cet éloignement illustre le principe de conservation du moment cinétique dans un système isolé. En effet, la Lune crée sur la Terre des marées qui dissipent de l’énergie par frottement et ralentissent la rotation de la Terre sur elle-même. Cette diminution doit être compensée par une augmentation du moment cinétique du système Terre-Lune, donc par un éloignement de la Lune. C’est là un bel exemple de science sûre d’elle-même, « dogmatique » pour reprendre la formulation d’Aimé Michel.
On possède par ailleurs des preuves du ralentissent de la rotation de la Terre. En effet, on peut déterminer le nombre de stries de croissance journalière par année dans les coraux du Dévonien (il y a environ 380 millions d’années) et en déduire que l’année comportait 400 jours de 22 heures. L’extrapolation de cette tendance à des temps plus anciens conduit à une grande proximité de la Lune il y a 2 milliards d’années qui aurait dû provoquer d’énormes marées. Or on a des preuves géologiques de l’absence de telles marées à cette époque ce qui conduit à conclure que « l’histoire orbitale de la Lune constitue actuellement une des grandes énigmes du système solaire » (Pierre Thomas, article « Lune » de l’Encyclopædia Universalis). Comme on le voit, il n’y a jamais à aller très loin pour se heurter à l’ignorance des scientifiques, à la science qui cherche en tâtonnant dans les spéculations et les controverses.
- Cette « catastrophe ultra-violette » a eu une importance considérable dans l’histoire des idées car elle a puissamment contribué à mettre un terme à l’idée commune chez les scientifiques de la fin du XIXe siècle que la science était pratiquement terminée (voir la note de la chronique n° 287, Le pithécantrope et le jardin – La Révélation est forcément un mystère sinon elle serait dépassée dans vingt ans, mise en ligne le 11.03.2013). Cet épisode central est fort bien raconté dans le beau livre de Joao Andrade et Silva et Georges Lochak, Quanta, grains et champs (coll. L’Univers des Connaissances, Hachette, 1969, p. 60 et sq.)
Au milieu du XIXe siècle, les physiciens s’intéressèrent à la façon dont les corps matériels émettent de la lumière quand on les chauffe et en absorbent si on les éclaire. Ils s’aperçurent qu’il était particulièrement instructif d’étudier pour cela un corps capable d’absorber toutes les radiations quelle qu’en soit la fréquence. Comme ce corps, pour cette raison, apparaît noir on l’appela corps noir. L’intérieur d’un four peut en tenir lieu. Si on le chauffe à 1000 °C par exemple, les parois émettront vers l’intérieur toutes sortes de radiations : de la lumière visible, des rayons infrarouges et ultraviolets etc. En émission et absorption un équilibre s’établira. Il y aura ainsi dans le four une certaine quantité d’ondes électromagnétiques couvrant toute une gamme de fréquences. Il est facile de savoir lesquelles : il suffit de percer un trou dans la paroi du four et d’analyser le rayonnement contenu à l’intérieur (on lui donne le nom pittoresque de rayonnement noir) à l’aide d’un spectrographe donnant l’intensité de chacune des longueurs d’onde. On trouva de la sorte que toutes les longueurs d’onde sont représentées mais en proportion très différente. L’intensité est très faible pour les radiations de courte longueur d’onde (ultraviolettes) ; elle croît jusqu’à atteindre un maximum (lumière rouge) puis décroît pour devenir très faible vers les grandes longueurs d’onde (infrarouge lointain).
Vers 1880, on tenta d’expliquer ces résultats expérimentaux à partir des théories classiques. Cette théorie du corps noir est due pour l’essentiel aux Britanniques Rayleigh et Jeans et aux Allemands Kirchhoff et Wien. La lumière y était décrite à l’aide de la théorie électromagnétique de Maxwell-Lorentz, on la supposait émise ou absorbée par des électrons qui oscillent conformément aux lois de la mécanique de Newton et c’était grâce à la théorie statistique de Boltzmann que l’équilibre entre l’émission et l’absorption était calculé. Hélas, l’une au moins de ces trois théories se trompait car les résultats furent parfaitement décevants. En effet si la courbe théorique se raccordait convenablement à la courbe expérimentale dans la région de l’infrarouge, la discordance était criante dans la région de l’ultraviolet. Fait encore plus grave, la courbe théorique était non seulement inexacte mais absurde : si elle était vraie, l’énergie totale du rayonnement contenu dans le four serait infinie. On imagine la surprise désagréable que causèrent ces conclusions. La physique classique était si fortement charpentée que cette « catastrophe ultraviolette », comme on l’a nommée, ébranlait tout l’édifice. Ce n’est pas sans raison qu’un esprit aussi averti que Kelvin y voyait l’un de ses nuages.
C’est alors qu’au mois de décembre 1900, Max Planck présenta à l’Académie des sciences de Berlin son quatorzième Mémoire sur la théorie du corps noir, celui qui était promis à la célébrité : il y proposait d’ajouter à la physique classique un petit postulat qu’on devrait appeler l’hypothèse des quanta. Avec cette hypothèse supplémentaire, plus de catastrophe ultraviolette, plus de désaccord avec l’expérience, la théorie du corps noir rentrait dans l’ordre. L’idée révolutionnaire de Planck prenait le contre-pied de la conception qui avait cours jusque-là selon laquelle les atomes pouvaient prendre un ensemble continu d’états. Il supposa au contraire que les états ne peuvent changer que par bonds discontinus. Mais ce n’était pas du tout une idée facile à admettre car elle soulevait le problème redoutable de comprendre comment une énergie lumineuse émise par petits paquets pouvait se propager sous forme d’ondes. Comme on l’a vu il y a quelques semaines à propos de l’expérience des trous d’Young, le problème a été formellement résolu, même si, selon le mot de Feynman, personne ne comprend vraiment la solution ! (chronique n° 293, L’homme-caillou – Une Révélation ne peut pas être de nature scientifique, 14.10.2013).
- Aimé Michel prend souvent la douleur comme exemple d’une réalité indubitable dont l’essentiel n’appartient pas au domaine de la science, voir la note (d) de la chronique n° 10, Le coup de pied de Malebranche (15.04.2009). Il y a d’ailleurs sur ce point une difficulté qui mérite d’être relevée. D’un côté, il n’est de science que du mesurable ; or une mesure scientifique de la douleur est concevable voire déjà pratiquée (« toute mesurée qu’elle est »). À ce titre la douleur (du moins ce qui en est mesurable) fait partie du domaine de la science. D’un autre côté, la douleur éprouvée « incommunicable, impartageable » échappe radicalement à la science (« rien jamais ne la mesurera »). Jusque-là tout va bien.
Mais la difficulté vient de ce qu’écrit par ailleurs Aimé Michel vers la même époque (1978) : « le phénomène de la conscience jouera un rôle de plus en plus grand dans la nouvelle physique, peut-être au point de devenir le seul objet de la science. » (voir la note 4 de la chronique n° 255, Les mouches – Ces théologiens sérieux qui repoussent l’idée d’une Personne divine, 11.02.2013). Faut-il en déduire que sa pensée n’est pas complètement fixée sur ce point délicat, comme je l’ai longtemps pensé, ou bien y voir une conséquence de la dualité d’aspect de la conscience ? En effet, si la frontière dans la conscience, entre ce qui est mesurable et ce qui ne l’est pas, se déplace à mesure que la science progresse, on peut concevoir que le phénomène de la conscience prenne de plus en plus d’importance scientifique.
Mais quand et jusqu’où ? Je me garderai bien de répondre car rien n’est plus imprévisible que la science à venir. Toutefois, Aimé Michel maintient que subsistera le cœur « impartageable », sans doute parce qu’une science qui franchirait ce seuil deviendrait par là-même tout autre chose, sans commune mesure avec ce que nous appelons aujourd’hui « science »…
- Ce « Dieu sensible au cœur » renvoie à la loi morale (voir « Miaou ». et tout est dit ? – Ce monde mystérieux et cruel vient de l’amour et y retourne, 04.03.2013) et à l’expérience mystique (Au cœur de l’inconnu – Ceux qui portent au mystique un mépris « scientifique » sont des ignorants, 04.02.2013).