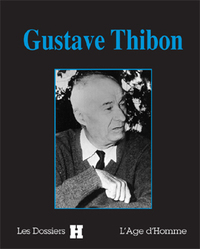Gustave Thibon ! Ce beau Dossier H, dirigé par Philippe Barthelet, lui rend le plus juste hommage. Au fur et à mesure que je progressais au milieu des textes choisis, des études, des évocations, le personnage revivait en moi tel que je l’avais connu en quelques rencontres marquantes.
La légende précédait l’homme, mais je n’avais pas été déçu ! Cette légende renvoyait au « philosophe-paysan », à son bon sens proverbial, sa sensibilité foncièrement réactionnaire. Mais j’étais plus intéressé encore par son colloque avec l’immense Simone Weil, son affrontement singulier avec Nietzsche, son statut de catholique plus proche de la mystique que de l’institution. L’auteur de Diagnostics, que j’ai lu très tôt (et qui était un de ses premiers livres, publié en 1940) était beaucoup moins simple que cette légende. Et j’avais le sentiment que pour prendre sa mesure, il fallait d’abord être à la hauteur de sa culture autant littéraire que philosophique, et peut-être littéraire avant d’être philosophique. Il convenait donc de se méfier des métaphores faciles sur l’enracinement, sans évidemment sous-estimer ce que Simone Weil appréciait tellement chez son hôte de Saint-Marcel-d’Ardèche.
La force de Thibon c’était d’abord la profondeur de son savoir, soutenu par une remarquable mémoire. Il se remémorait, chaque jour, des centaines de vers. Ce qui me frappait particulièrement, c’était aussi la façon dont il avait intégré la pensée de Simone Weil, dont à chaque occasion il citait une des formules, qui avait le don de vous saisir en vous faisant rebondir toujours plus haut. Quand je pense à lui, c’est presque toujours en revivant en imagination la venue de cette Antigone, que je ne puis qualifier que de « visitation ». Par analogie, évidemment, avec la scène évangélique. Simone n’est pas la Vierge comblée de grâce, mais son exceptionnelle densité intérieure, son sens de l’absolu, son intransigeance font d’elle une femme prédestinée dont l’apparition ne peut que transformer celui qui la reçoit. Son séjour à Saint Marcel d’Ardèche constitue un événement inoubliable de l’histoire de la pensée.
Pourquoi ne suis-je jamais allé dans ce village de vignes, dont Thibon disait qu’il appartenait déjà à la Provence, alors que j’ai rencontré un certain nombre de fois dans des endroits différents l’auteur de La Nuit étoilé ? J’avais peut-être 25 ans la première fois où j’ai parlé en public avec lui. C’était à Rouen, dans une église désaffectée, transformée en auditorium. Pour y accéder, nous avions traversé à pied les vieux quartiers de la ville, et je l’entends encore de sa voix chaude évoquer la triste banalisation de l’amour. J’avais lu d’ailleurs son bel essai Ce que Dieu a uni, dont j’appréciais à la fois le solide réalisme et la faculté d’émerveillement. Je ne saurais plus dire quel fut le premier livre de lui que je lus vers les 18 ans. Peut-être Diagnostics. Ce qui est sûr, c’est que je rédigeais une dissertation à partir de Nietzsche ou le déclin de l’esprit. Mon professeur m’avait recommandé d’équilibrer avec les pages du Drame de l’humanisme athée où Henri de Lubac aborde le même sujet, mais sous un tout autre angle. Je n’ai jamais repris cette analyse très singulière du génie nietzschéen. À tort, sans aucun doute, submergé que j’étais par la montagne d’érudition sur celui dont on avait fait le penseur inaugural de la déconstruction. Je dois préciser d’ailleurs que « le Thibon » faisait l’objet d’un certain mépris de tous ceux qui se réclamaient de Heidegger, Deleuze ou autres Morel. Au moins, l’écrivain ardéchois avait-il mis tout son cœur et toute sa chair dans cette sorte de combat singulier où l’adversaire lui était devenu fraternel et complice. Il est bien possible que l’on redécouvre, quelque jour, les mérites de cette lecture décalée où c’est saint Jean de la Croix qui est appelé à répondre aux contradictions mortelles de Zarathoustra.
J’ai entendu un jour Pierre Boutang reprocher à Thibon son inclination pour Nietzsche. « Votre Nietzsche ! » disait-il, pour lequel vous avez eu trop d’indulgence et dont les nazis se sont emparés non sans raison ! L’intéressé ne protestait guère, sachant trop, pour les avoir dénoncés quel poisons distillait celui qui avait prétendu qu’avec de tels élixirs il devenait plus fort. Mais puisque Boutang est venu s’interposer dans mon souvenir, je puis confier ce que m’avait dit Thibon à son sujet. Il l’admirait énormément (« un très grand platonisant »), mais protestait de toutes ses forces contre une écriture qu’il trouvait trop hermétique : « Quand j’ai lu son essai La politique considérée comme souci, j’ai été retenu par la complexité de la pensée et du style. J’en ai alors parlé à Mme Parain-Vial, pourtant habituée aux textes les plus ardus de la philosophie, et elle m’a répondu qu’elle éprouvait à lire Boutang les plus grande difficultés. De même, Gabriel Marcel ! Quand je lui ai demandé s’il avait lu Boutang, il m’a répondu : justement, j’avais des questions à vous poser sur ce que je n’ai pas bien compris ! »
Peu de temps après la publication de ce roman métaphysique prodigieux intitulé Le purgatoire, Thibon m’interrogea illico, sans autre préambule : « Vous avez lu ! C’est toujours aussi insupportable. Boutang croit que tout le monde a la même culture que lui et se trouve capable d’interpréter dans une même phrase une réminiscence de Dante, une autre d’un dialogue de Platon et un clin d’œil à Heidegger. » Je reconstruis un peu mais c’était l’idée ! Je me dois d’ajouter que lorsque, de son côté, Boutang me parlait de Thibon, il se montrait parfois un peu agacé mais aussi émerveillé. L’agacement venait sans doute de la dissymétrie entre le normalien et le « philosophe-paysan ». L’émerveillement se rapportait à leur communion au royaume des poètes, à leurs attachements et enracinements communs, à leurs admirations identiques. Notamment à l’égard de celle que le normalien avait célébrée comme une « Antigone juive », dès la publication de La pesanteur et la grâce et de L’enracinement. Plus tard, elle réapparaîtra dans L’ontologie du secret, en des pages dont Florence de Lussy écrira qu’elles sont « les plus aiguës jamais écrites sur la philosophe ». (Introduction au volume Simone Weil œuvres, Quarto Gallimard).
Mas tout cela me ramène au Dossier H de Philippe Barthelet. Je me suis précipité sur la préface de La pesanteur et la grâce qu’écrivit Gustave Thibon après avoir rassemblé et ordonné les textes des cahiers que Simone Weil lui avait confiés, avant qu’elle ne parte de Marseille à destination des États-Unis. C’est un des cadeaux du Dossier H que de nous restituer ainsi une multitude de documents qui n’étaient plus accessibles. Celui-là a un prix inestimable. Il rappelle d’abord les circonstances dans lesquelles Thibon accueillit Simone Weil et il offre une première synthèse d’une pensée qu’il a murie durant toute son existence : « Ces textes sont nus et simples comme l’expérience intérieure qu’ils traduisent. Aucun rembourrage ne s’y interpose entre la vie et le verbe : l’âme, la pensée et l’expression constituent un bloc sans fissures. Même si je n’avais pas connu personnellement Simone Weil, son style seul me garantirait l’authenticité de son témoignage. Ce qui frappait avant tout dans ses pensées, c’est la polyvalence de leurs implications possibles, leur simplicité simplifie tout ce qu’elle touche. Elle nous transporte sur ces sommets de l’être d’où l’œil embrasse, dans un seul regard, une infinité d’horizons superposés. » Il n’y avait entre la Simone qu’il avait accueillie à Saint-Marcel et sa pensée aucune espèce de hiatus. Le même sens de l’absolu, la même intransigeance, qui, dans sa vie supposaient cet ascétisme héroïque, débouchait pour son intelligence dans ses formules d’une extraordinaire condensation, où le mystère divin se détache au dessus de nos imperfections : « Toute l’œuvre de Simone Weil est mue et imprégnée par un immense désir de purification intérieure, qui rejaillit dans sa métaphysique et sa théologie. Tendue de toute son âme vers un bien pur et absolu, dont rien ici bas ne peut lui prouver l’existence, mais qu’elle sait plus réel que tout ce qui existe en elle et autour d’elle, elle veut assoir la foi en cet être parfait sur une base qu’aucun coup du sort ou du malheur, aucun remou de la matière ou de l’esprit ne puisse ébranler. »
Je puis témoigner, avec une foule d’interlocuteurs de Thibon, que des décennies après, c’est comme si la Visitation avait eu lieu hier. Simone était omniprésente dans sa conversation et je voudrais raconter ici un épisode que je n’ai vu repris nulle part ailleurs et qui mérite pourtant d’être consigné. On sait que dès sa vie étudiante, la jeune normalienne avait très activement milité dans les organisations d’extrême gauche. Elle s’était trouvée très proche du trotskisme, à tel point que lorsque l’ancien chef de l’armée rouge se trouva banni par Staline d’Union Soviétique, et traqué par ses agents secrets, Simone Weil exigea de ses parents que le proscrit fut reçu au domicile familial à Paris. On conçoit l’effroi des intéressés qui ne partageaient nullement les engagements idéologiques et militants de leur fille. Mais il devait être très difficile de lui résister. Trotski débarqua donc un jour dans l’appartement familial. Thibon décrivait la scène que lui avait rapportée Simone : plusieurs gardes du corps dormaient au travers du couloir, à la porte de la chambre du leader révolutionnaire. Ce n’était sûrement pas pour effrayer l’auteur de La condition ouvrière, qui, nullement intimidée avait interpellé Trotski dès son arrivée : « Camarade, expliquez moi Kronstadt ! » Elle tenait absolument à obtenir de la bouche même du responsable de la répression à l’encontre de la révolte des marins de ce port à l’embouchure de la Neva, pourquoi il avait si brutalement réagi. C’était un sujet de scandale entre factions révolutionnaires, à cause de la férocité sanglante avec laquelle des soldats, qui avaient participé au soulèvement de 1917, avaient été massacrés.
Mais Trotsky se justifia sans broncher face à la jeune fille qui exigeait des comptes : « Si c’était à refaire, je le referai ! La révolution était en danger. Les troupes de Dénikine nous menaçaient. Il fallait étouffer la révolte au plus vite. » Thibon m’avait rapporté quelques trente ans après l’avoir entendue de son hôte cette « anecdote » qui reflétait exactement le tempérament inflexible de Simone.
Mais je me suis laissé un peu égarer… Cet énorme cahier de 650 pages exigerait une analyse d’ampleur comparable. Je ne puis qu’esquisser quelques remarques générales, en remerciant Philippe Barthelet d’avoir mené à terme un tel travail. Il nous offre le résultat d’années de recherche qui lui ont permis de retrouver dans les archives des pièces essentielles pour comprendre le sens d’une existence et d’une œuvre. Cela lui permet dans son introduction de mettre les choses en perspective, en évitant les approximations et même les erreurs. Thibon inclassable et irrécupérable ? Cela devient de plus en plus vrai à mesure qu’on perce l’écorce du personnage. Je l’avais pressenti en l’écoutant parler de sa prédilection pour les personnalités qu’il qualifiait d’étagées. J’ai cru retrouver cette notion quand Barthelet cite un de ses aphorismes : « Le jour où tu comprendras que tout le monde a raison à son niveau et dans ses limites, ce jour là tout le monde te donnera tort. Toutes les portes se ferment devant celui qui est ouvert à tout. N’ayant plus de complices, il n’a plus que des ennemis. »
Mais nous voilà contraints alors de délaisser la légende pour tenter de prendre la vraie mesure du personnage. Ce n’est pas évident, non parce qu’il se déroberait, se dissimulerait à plaisir, non même qu’il serait quelqu’un de secret par principe. Son œuvre n’est pas ordonnée au cordeau, elle se disperse le plus souvent dans des recueils d’aphorisme. Le rapprochement avec la manière de Nietzsche, qui lui-même sollicite, est évidente. Mais alors, il faut se faire à une pensée par fragments qui sont souvent de magnifiques pépites, et qui parfois laissent en attente d’un complément, d’un développement. Lui-même en était bien conscient. Mais il y a un sens général à tout cela, une sensibilité qui s’affirme à force de diagnostics imparables, de jugements qui font mouche.
Dans le monde catholique, au moment de la guerre, peu d’intelligences ont échappé à son influence et même à son obsession. C’est que la publication de ses premiers livres coïncidait avec l’effondrement de 1940, et ils apparaissaient comme prémonitoires de la défaite, alors même qu’ils faisaient mal à tous ceux dont les illusions se trouvaient fustigées. Philippe Barthelet publie à ce propos des réactions très hostiles de la mouvance gauche chrétienne. Pourtant aucun des contradicteurs n’échappe à sa morsure. Le plus véhément de ses adversaires, le jésuite Alfred de Soras, ne peut s’empêcher d’avouer l’étendue des erreurs que Thibon a rendu évidentes : « Pourrait-on raisonnablement contester la valeur de ce message ? Sans doute sa véhémence nous hante : mais il est des heurts salutaires. Et peut-être avions-nous besoin de recevoir un tel choc thérapeutique, ayant tous, plus ou moins, été jadis contaminés par des candeurs dont notre défaite nous a brusquement mais trop tard révélé la gravité. Beaucoup d’entre nous ont cru trop « candidement » il y a quelques années, au progrès, au caractère raisonnable de l’homme, à sa fidélité spontanée aux pactes signés, à la possibilité d’établir sans sanctions un régime de désarmement universel… Sur tous ces points et sur bien d’autres, nous aurions dû faire « retour au réel ». M. Thibon a donc raison de souligner que certains de nos desseins et de nos espoirs ont été, pour une large part, chimériques. » Cet aveu résonne d’autant plus fortement qu’il est balancé par une contre-attaque vitriolesque. Car ces concessions, qui ne sont pas de forme, se concluent par l’envoi d’une flèche objectivement mortelle : « Pourquoi ôter si rudement la paille de l’œil du voisin ou du frère, alors que la poutre peut-être… » Oui, la poutre pourrait bien être dans l’œil de Thibon dont les justes sévérités ne sont pas innocentes, lorsque prétendant arracher les masques, « il égratigne les visages ». Des bons et de justes, de loyaux militants qui n’ont rallié le monde moderne que pour le convertir ont été ainsi injustement fustigés.
C’est que le catholicisme français est farouchement divisé et que les règlements de compte sont toujours près à ressurgir sous couvert d’explications mutuelles. Il est vrai qu’à ce moment précis, les circonstances obligent à tenir compte des événements et des nouveaux rapports de force.
L’auteur de Diagnostics, Retour au réel, L’échelle de Jacob, n’est pas complètement affecté par le sceau maurrassien imprimé au front des protagonistes de droite. Il semble même que son génie précoce s’est éclos dans le sein maritanien, ce qui n’est pas tout à fait exact. Là-dessus, il faut faire totalement crédit à Barthelet de l’irréductible originalité de l’homme de Saint-Marcel.
Justement, se pourrait être le motif des tentatives, sinon de captation, du moins de rapprochement dont il a été l’objet. Car il n’y a pas que Thierry Maulnier et Henri Massis pour vouloir l’attirer du côté de La Revue universelle. Il y a Emmanuel Mounier qui tient absolument à le faire collaborer à Esprit. D’ailleurs les deux premiers articles sont à la veille d’être imprimés juste au moment ou Vichy décide d’interdire la revue du personnalisme chrétien ! Les preuves signées de Mounier figurent explicitement dans le Dossier H. Et puis il y a l’extraordinaire article du tout jeune Jean-Marie Domenach dans Les cahiers de notre jeunesse ! Article clairement contestataire, extrêmement dur sur le fond, mais qui montre en même temps que le débat intérieur se développe dans l’âme du résistant en herbe, celui qui confronte ses esprits contraires, dont Thibon incarne d’évidence celui qui s’oppose au daimon progressiste, alors sanctifié par le fameux père Marie-Dominique Chenu : « L’intraitable et grandiose loi du progrès ».
Nous sommes quelque deux ans après l’interdiction d’Esprit. L’eau n’a pas seulement coulé sous les ponts. C’est l’équilibre du monde qui a changé avec le renversement des alliances, le recul des forces de l’Axe, l’entrée des communistes dans la résistance. Tout cela produira des conséquences, dont les plus ultimes sont inscrites dans les positions personnalistes d’après-guerre. Sur ce point, Philippe Barthelet a la cruauté de citer le Mounier de La petite peur du XXe siècle, qui, oubliant ses tendresses pour le philosophe de Saint-Marcel, le crible du reproche mortel adressé à ceux qui n’ont pas suivi le sens de l’histoire, Staline régnant au Kremlin. Je crois que nous avons assez de distance avec cette période pour tenter de la comprendre sans céder à la pente des guerres civiles. D’ailleurs, il est remarquable que le Domenach que nous avons connu en ses dernières années aurait identifié sans aucune difficulté le double cours contrasté qui se dessinait en 1943 et s’était retrouvé quand il faisait le bilan de sa vie.
J’ajouterai que tous les griefs assénés contre Thibon ne sont pas à rejeter sans examen. C’est vrai qu’à cette période son Retour au réel a tiré le penseur sur des positions qui ne sont pas dépourvues de défauts, à force de systématisme réactionnel. « Prenons par exemple, écrivait Domenach, l’examen que fait Thibon des causes de la dénatalité : le déracinement, la peur du risque, l’amour du confort, tout cela est fort juste, et en général parfaitement dit par un homme qui est en bonne situation pour le dire. Puis, chemin faisant, c’est la conception même du mariage qui vient à être critiquée : Thibon, sans insister, regrette le temps où « l’on aimait les hommes à travers les institutions », où pour la femme « le mariage pesait plus que la personne du mari ». Cela est grave. Les fanatiques de Thibon s’en sont-ils aperçu ? Ce qui est en question ici, ce n’est rien moins que le progrès spirituel accompli dans l’ordre du mariage depuis le temps où on mariait les jeunes filles de force : ce qui, selon Thibon, est cause de stérilité n’est rien moins que la conception chrétienne du mariage. »
Comment donnerais-je tort sur ce point précis au jeune Domenach ? Thibon a souvent souligné, peut-être à l’excès, l’opposition « du temps où il y avait des mœurs » avec le volontarisme moderne, moraliste en diable, où tout était révocable d’un jour à l’autre. Dans sa jeunesse, les fêtes votives donnaient lieu à des débordements, à la suite desquels plusieurs filles du village se trouvaient engrossées. L’outrage était réparé dans l’année, les dites filles dûment mariées avec des jeunes gens à qui on en faisait le devoir, même s’ils n’étaient pas les géniteurs. C’est bien qu’il y avait des mœurs alors ! Thibon se faisait-il l’apologète intégral de ces pratiques ? J’en doute, mais je l’ai entendu raconter cette histoire devant une assistance tradi assez médusée. On ne peut jouer sur ce type de paradoxe que jusqu’à un certain point. L’indignation de Domenach était justifiée, mais par ailleurs on pourrait trouver dans cet autre livre de Thibon Ce que Dieu a uni, la réponse antithétique à ses propres provocations : « L’amour n’est pas une étincelle éphémère issue de la rencontre de deux désirs, c’est une flamme éternelle jaillie de la fusion de deux destinées. » On trouverait aussi chez lui toute une autre doctrine de l’amour propre à éclairer pour la préparation au mariage chrétien.
Mais je voudrais achever mon propos sur cette période charnière où il y a encore incertitude sur le destin définitif du penseur. Là encore, il faut remercier Barthelet d’avoir rappelé — ce qui était complètement oublié — comment Thibon fut étroitement associé au Père Lebret dans l’entreprise d’Économie et Humanisme, où il s’agissait de repenser avec des concepts nouveaux, l’avenir du développement économique et social, en dehors des paramètres de l’individualisme libéral et du collectivisme. François Perroux était également de l’aventure, avec les dons qu’on lui connaît. La leçon, c’est évidemment que les clivages intellectuels ne sont pas toujours si faciles à établir dans l’histoire des idées, même entre catholiques. Thibon aurait-il pu échapper au destin qui a fait de lui l’irréductible figure d’un camp contre un autre ? Il est légitime de se le demander, non sans remarquer qu’on n’a peut-être pas été suffisamment attentif aux déplacements successifs qui ont bouleversé les lignes, déportant les uns vers la gauche et d’autres vers la droite.
En bout de course, Gustave Thibon, aussi catalogué qu’il soit, demeure quand même une énigme, et parfois un objet de scandale. Certains — et ils appartiennent aussi bien à la droite qu’à la gauche — ont prétendu que l’interlocuteur de Simone Weil aurait perdu la foi sur le dernier versant de sa vie. Je n’en crois rien pour ma part et me suis déjà expliqué sur le sujet. Mais comme il a été évoqué encore récemment, je voudrais en dire un mot. Est-il vrai que Jean Madiran, qui l’avait si souvent accueilli dans sa revue Itinéraires prétendait, dans les dernières années du philosophe, que « Thibon c’était Voltaire » ? Je relève par ailleurs au courrier de Témoignage Chrétien, dans la suite d’une vive polémique à propos d’un article de Jacques de Guillebon : « Thibon nourri aux anthologies des grands penseurs, des sagesses de toujours et de partout où Marc-Aurèle côtoie Nietzsche et Jésus… Thibon dont les dérobades et paradoxes, la prétendue théologie apophatique aboutissent, pour qui sait un peu lire, à un plat et grotesque aveu d’agnosticisme banal (à la Maurras). « Oui, c’est vrai. Rien à faire, j’y crois pas. Mais je n’arrive pas à croire à mon incroyance ». Ce serait lui le grand spirituel du XXe siècle ? N’y aurait-il pas plus à voir du côté, par exemple, de ce qu’a écrit Grothendieck ? Ou même Marcel Légaut ? »
Je suis en désaccord total avec un pareil jugement, que n’excuse qu’une profonde ignorance du sujet. Il me suffira de citer Thibon lui-même dans un texte qui date de 1993, un questionnaire de Luc Adrian auquel il avait répondu pour Famille Chrétienne et que l’on retrouvera à la fin du Dossier H :
« Votre saint préféré ?
– Saint Jean de la Croix, Docteur de la nuit. Le plus extrémiste de tous les saints, avec qui Nietzsche se serait bien entendu.
Je suis réaliste parce que je défends les « milieux de soutien » : Je sais qu’un Dieu sans Église est le début d’une Église sans Dieu. Mais je suis extrémiste par mon attrait pour la théologie négative, la mystique de la nuit, le « Dieu sans fond ni appui » qui était celui de saint Jean de la Croix et qui est le mien aujourd’hui.
– Votre sainte préférée ?
– Thérèse de Lisieux. »
Il n’y a presque rien à ajouter. Avec Thérèse aussi, Thibon a partagé la nuit de l’esprit, celle que connut encore sa grande amie Marie Noël. C’était dans la logique de tout son cheminement spirituel, qui ne s’est jamais séparé de la tradition du Carmel.