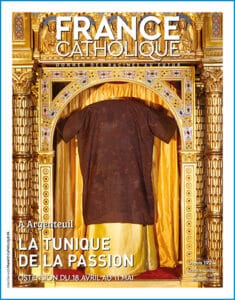Le foyer. Ce mot magique qui résonne dans le cœur de chacun. Même pour ceux dont le foyer a été brisé, qui n’ont plus de foyer, il plane encore une idée que chacun peut poursuivre.Le foyer est le refuge où chacun peut s’abriter, se faire dorloter, se faire reconnaître, vivre libre, et aimer.
L’appel du foyer se retrouve dans la culture populaire. Combien de chansons l’invoquent ! Combien apparaissent dans des films ! Combien d’œuvres littéraires, depuis l’Odyssée, narrent le retour au foyer. Le but final du sport Américain « Base Ball » est d’atteindre la dernière base, nommée « Home » [Maison, foyer]. Assister à cet exploit entraine une folle joie chez les spectateurs et téléspectateurs.
Et des milliards de dollars sont dépensés pour la décoration de nos maisons afin d’en faire de chaleureux foyers « Home, sweet home ».
Nos foyers sont le grand théatre où se jouent nos vies, selon les mots éloquents de G.K. Chesterton :
Le lieu de naissance des enfants, du décès des gens, le décor des événements de la vie, ce n’est ni un atelier, ni un bureau. C’est bien plus petit, si on le mesure, et tellement plus grand par son importance. Et alors que nul ne serait assez insensé pour prétendre que c’est l’unique lieu de travail souhaitable, le seul endroit où devraient travailler les femmes, c’est un lieu doté d’une qualité d’unité et d’universalité tel qu’on n’en trouvera nul autre dans le monde éparpillé de la division du travail.
Le foyer est par nature un préambule au paradis. Citons les dernières paroles de S.S. Jean-Paul II : « que j’aille à la maison du Père. » Il désirait rejoindre le foyer — là où chacun est attendu par Dieu, même s’Il permet que nous n’en éprouvions pas le désir.
Étrangement, alors que le désir intime pour un foyer anime les humains, l’idée qu’on pourrait souhaiter créer un foyer, un lieu assurant amour, ordre, propreté, formation, soins, semble tombée en désuétude. Imagine-t-on pour les millions de femmes de nos jours pire destin que « femme au foyer » ?
Les années 1960 ont vu les femmes déserter leurs foyers. Betty Friedman lançait dans The Feminine Mystique une idée dont l’écho a atteint des millions de femmes en Occident : « une douleur sans nom ». Quand Friedman et ses amies féministes posaient la question : « n’y a-t-il rien d’autre ? » elles imaginaient que la réponse serait : « non ». Dans leur délire féministe pour s’évader de chez elles le slogan choisi fut, pour l’élite des femmes, « non serviam » [en latin dans le texte], refus retentissant de servir leurs familles, leurs enfants, ou toute autre forme d’avenir que le leur.
Wendell Berry a mis le doigt sur le côté illogique des « femmes libérées » en demandant : « Pourquoi une femme refuserait-elle nettement l’engagement conjugal d’obéissance (selon sans doute le principe que la soumission à un être humain dépasse la dignité humaine) puis envisagerait de prendre un emploi la soumettant à l’autorité d’un patron (homme ou femme), autorité impliquant spécifiquement l’obéissance ? »
Les femmes suivant ce courant culturel n’ont pas encore réalisé que le malaise général ressenti par les maîtresses de maison dans les années 1960 tenait du même sentiment de vide qu’elles éprouvent de nos jours. Le féminisme n’a guère donné de bonheur aux femmes, incitant à chercher, grappiller, saisir ce qui semble meilleur au coin de la rue. Elles ignorent tout simplement qu’aucune carrière, aucune aventure, aucune croisière à Bali, aucun sac Louis Vuitton, ne comblera leur vide.
Alors les enfants deviennent des adversaires, empêchant les femmes de réaliser leurs rêves. Avorter devint un besoin. Le nombre d’enfants supprimés par l’avortement est effarant. Les pertes militaires de la guerre du Viet Nam — 58 220 en tout — semblent mineures devant ce nouveau genre de mise à mort, mères tuant leurs enfants (60 millions — 3 000 par jour). L’avortement est, de loin, aux États-Unis, la plus important cause de mort, dépassant largement maladies cardio-vasculaires et cancer.
Qu’advient-il, alors, quand des générations ont mis à mort leurs propres enfants en avortant ? Le Moyen Âge était opposé à l’avortement car supprimant une vie innocente, mais également en raison des dégâts mortels pour l’âme. Ce n’est pas seulement un enfant qui meurt lors de l’avortement, mais aussi un peu de la maman et du papa.
Saint Thomas d’Aquin le disait, « bonum est diffusiyum sui, le bien se répand de lui-même ». Le contraire est tout autant véritable : le mal sait bien se répandre. Ce mal terrible atteint tout dans la vie de famille.
Est-il donc étonnant, alors, que notre foyer spirituel, l’Église, semble aussi s’effondrer? Quand le constituant fondamental de la sociéte — la famille — a été déchiré, ne soyons pas surpris d’assister au même phénomène au sein de l’Église. Nous attendons mieux de la part de nos évêques, sainteté et bonté, mais eux aussi sont des produits de notre culture déchiquetée.
Ce qui ne les absout pas de leurs fautes, mais nous aide à comprendre comment ceux-ci, chargés de tant d’âmes, pouvaient réagir par de tels méfaits. Quand des femmes peuvent envisager la destruction de leurs enfants en adhérant à une sorte de « club féministe », on n’est guère loin de saisir pourquoi ces évêques peuvent abandonner leurs fils spirituels et adhérer au « club (version masculine) ».
Selon Chesterton, « il y a deux façons pour se trouver au cœur du foyer : soit y demeurer, soit errer de par le monde pour finalement s’y retrouver ».
Notre culture actuelle appelle à retrouver le foyer après avoir fait le tour du monde à la recherche du bonheur. Les féministes acharnées, bien qu’ayant cherché en tous sens, ressentent toujours ce « mal-être indéfinissable ». Leurs cœurs inapaisés souffrent sans Dieu, et ne trouveront la paix qu’en revenant au foyer.
– 22 septembre 2018.
Source : https://www.thecatholicthing.org/2018/09/22/a-theology-of-home/
Sainte famille à l’oiseau – Bartolomé Esteban Murillo, 1650 (Musée du Prado, Madrid).
Pour aller plus loin :
- Où donc se sont perdues les voix des grands jurisconsultes, les Carbonnier, Batiffol, Mazeaud, Savatier, Foyer, Cornu, Malaurie...?
- Une autre opinion pour un autre spectacle…
- Théologie morale et épanouissement humain
- La paternité-maternité spirituelle en vie monastique est-elle menacée en Occident ?
- Récupérer la théologie de la Libération