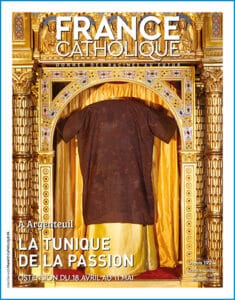6 Juillet
La mort du père Jean Cardonnel – ce 4 juillet, il avait 88 ans – ne m’est nullement indifférente. J’ai eu l’occasion de connaître l’homme dans ses années les plus « flamboyantes », et lorsque je remémore mes souvenirs, je ne puis que reconnaître sa chaleur méridionale, son extraordinaire présence. En 1968, j’étais au Quartier latin, lorsqu’il prêcha son carême révolutionnaire, préconisant la grève générale comme signe tangible pour remplacer avantageusement le jûune, l’aumône et la pénitence. C’était un peu l’ambiance du moment, en plein essor de la Révolution culturelle chinoise, l’exaltation lyrique du Tiers-Monde et une culture marxisante largement partagée dans l’intelligentsia. Je n’étais pas allé l’écouter à la Mutualité, mais on m’avait rapporté ses propos. Je revois encore un aumônier d’Henri IV confiant sa perplexité. Ce dominicain exalté avait-il la foi ? Car il n’y avait pas seulement en jeu son engagement politique. Il entendait renouveler le langage théologique, voulant briser la gangue métaphysique de tout un discours ecclésial. Il faudrait avoir à l’esprit la rhétorique en usage alors sur le thème « Dieu est mort en Jésus Christ ». Mais elle s’est très vite démodée. C’est le paradoxe de ces tentatives d’intégration pour rejoindre l’esprit du temps qui sont frappées d’obsolescence presque aussitôt après qu’elles ont paru l’avant-garde même.
Toujours est-il que c’est quelques mois après son carême révolutionnaire que je fis la connaissance de Jean Cardonnel. J’avais alors un ami qui tenait la chronique religieuse de Combat, Charles Reymondon. Il signait ses papiers sous le pseudonyme de Baruch. Il était prêtre, religieux mariste – il demanderait d’ailleurs quelques temps après sa réduction à l’état laïc. Ancien disciple du père Marcellin Fillères, il était le plus singulier informateur religieux que comptait alors Paris. Il faut dire que Combat était un quotidien hors-normes lu par les non-conformistes. L’époque glorieuse de la Libération n’était pas oubliée avec les éditoriaux d’Albert Camus. Henri Smadja, le directeur-propriétaire, laissait à Philippe Tesson, son rédacteur en chef, toute latitude pour diriger la rédaction. C’est grâce à Combat que j’avais fait connaissance avec Reymondon. Il n’avait pas hésité à ouvrir un débat-fleuve avec le jeune journaliste que j’étais alors. Il venait de publier un livre dans une collection dirigée par Tesson et avait eu l’idée d’organiser une discussion à son sujet dans le journal. C’est ainsi qu’un beau soir je me suis retrouvé dans la deux-chevaux de Robert Toubon aux côtés de Baruch et de Jean Cardonnel à destination de Versailles. Nous devions aller, en effet, chez Louis Salleron ! Un affrontement Cardonnel-Salleron, ça promettait ! Ce dernier, professeur émérite d’économie à l’Institut catholique, rédigeait alors une page très militante dans l’hebdomadaire Carrefour sous le titre « Le laïc dans l’Église ». Il y défendait les positions d’un traditionalisme intelligent. Intellectuel de grande culture, très marqué par la pensée de Simone Weil, il était armé d’une ironie des plus redoutables. Mais j’étais loin d’imaginer la soirée que nous passerions à son domicile.
Coincé dans les embouteillages de la porte de Saint-Cloud, nous mîmes un temps considérable pour atteindre l’autoroute de l’Ouest. Cela nous permit largement d’aborder la discussion avec le père Cardonnel. L’homme me parut tout de suite cordial, direct, beaucoup plus nuancé que je m’y attendais. Surprise : son progressisme ne s’accommodait guère d’un laisser aller théologique. Il protestait avec véhémence contre certaines licences des traductions liturgiques. Plus tard, Gustave Thibon me confierait qu’il avait jadis reçu une lettre du jeune frère Jean Cardonnel lui reprochant de ne pas s’inspirer d’un thomisme plus rigoureux. Je ne sais si quelqu’un s’attaquera un jour à une biographie de l’intéressé. Elle pourrait nous apprendre beaucoup sur l’évolution intellectuelle d’après-guerre, telle qu’elle a été vécue par une génération de jeunes clercs, perturbée par le climat idéologique et les transformations politiques du monde. Il est peu douteux que le mélange idéologico-religieux a produit une inclination vers un prophétisme qui trouvait ses marques dans ce qui apparaissait alors comme à l’avant de l’émancipation humaine. La générosité évidente de pareil attitude n’était pas indemne d’un dérapage sérieux. N’est-ce pas Bernanos qui déclarait un jour : « Je serai fusillé par des prêtres portant en poche le Contrat social de Rousseau. » Mais nous n’en étions pas encore là.
A Versailles, chez Salleron, ce fut l’inattendu qui arriva. Ce n’est pas Cardonnel qui dominait par son verbe, nous assistâmes à un festival Salleron. Je pense que notre révolutionnaire était quelque peu médusé. Il ne s’attendait surement pas à trouver pareil interlocuteur. Baruch avait bien choisi. Il savait que le Versaillais n’était pas de petite pointure et qu’il était capable d’attaquer sur les terrains les plus surprenants. Bernard Billaud a raconté dans son beau livre sur Jacques Chirac, comment il avait fait rédiger par Salleron un discours que le maire de Paris devait prononcer devant un auditoire franc-maçon. Ce fut un triomphe, Chirac n’ayant rien retranché ou ajouté au texte préparé. Certes, Cardonnel n’était pas inerte, il fut loin d’être inexistant, mais en-dessous des éclats auxquels on s’attendait. Je serais incapable de reprendre la substance de la conversation. Mais on pourrait la retrouver quasi in-extenso dans la collection de Combat où elle fut publiée par la suite. Il y en eut des pages et des pages. Aujourd’hui, une telle prolixité serait inimaginable. Mais Combat était Combat, bravant toutes les règles.
En cours de soirée, il y eut une autre surprise : l’arrivée de Madame Salleron accompagnée d’un de ses fils religieux – Carme, peut-être ? Visiblement l’épouse de notre hôte était ahurie de retrouver Cardonnel chez elle ! Quant au jeune religieux en habit, il rompit un peu le rythme par des considérations assez scolastiques. Cardonnel devait le trouver « terriblement romain ». C’est vrai qu’il faisait ses études à Rome. Le style du papa lui convenait beaucoup mieux. Je dois ajouter que le jeune religieux, dont le rayonnement était grand, devait mourir prématurément, et que ce serait une rude épreuve pour les Salleron. Nous quittâmes fort tard leur domicile, reconduits à Paris dans la vaillante deux-chevaux de Robert Toubon. Celui-ci, frère du futur ministre Jacques Toubon était un collaborateur proche de Philippe Tesson. Il devait diriger plusieurs années le Quotidien du médecin et sera quelque temps mon directeur de rédaction au Quotidien de Paris. J’ai gardé le meilleur souvenir de lui. Cette nuit là, il fut ravi de tout ce qu’il avait entendu, et nous eûmes très longtemps après l’occasion de reparler de Baruch. Lequel s’était retranché dans sa Thébaïde ; je ne le revis qu’une seule fois, en compagnie de Christian Bailly, un autre disciple étonnant du père Fillères, qui porta longtemps le projet d’un immense musée de la presse.
Souvenirs, souvenirs… Charles Reymondon s’est éteint en 2000, dans un grande paix. Je le dis parce que c’était quelqu’un de tourmenté. Avec Cardonnel il avait en commun une passion politique, qui l’amenait à délirer un peu sur « la dictature du prolétariat ». Y croyait-il vraiment ? Il avait en tête tout un système intellectuel très construit, qui participait lui aussi des hantises des années 60-70. Quand à Jean Cardonnel, je devais le revoir deux ou trois fois, la dernière par hasard dans les rues de Montpellier. La première, il m’avait livré ses impressions de la soirée versaillaise, un peu en retrait par rapport à Salleron qu’il jugeait plus figé que sur le moment. Je ne me souviens plus des circonstances où il évoqua pour moi le grand séjour qu’il venait de faire en Chine. Enthousiaste est trop peu dire, il en était quasi transfiguré : « Il faudrait que je vous raconte cela en détail. C’est une expérience inoubliable. » J’étais plus que réservé, me doutant bien que la réalité devait être épouvantable à l’encontre du tableau ahurissant qu’on nous avait offert. Même le livre d’Alain Peyrefitte (Quand la Chine s’éveillera) avait provoqué ma méfiance. J’avais sur le moment écrit un article intitulé « Pourquoi je ne veux pas mourir maoïste ! » C’est dire l’ambiance. Cardonnel avait vraiment poussé le bouchon très loin. Le sommet fut atteint lors d’une « radioscopie » avec Jacques Chancel, où notre dominicain exalté déclara que la Chine qu’il avait visitée se présentait à lui comme un immense couvent, dont le père-abbé était en somme le grand timonier. La Révolution accomplie, il l’avait vue de ses yeux, et il s’indignait qu’on put mettre en doute ses allégations. A un évêque qu’il lui avait objecté que ce ne devait pas être très drôle, il avait répondu à peu près : « Comment, Monseigneur, vous auriez voulu que ce soit comme chez nous, débridé, immoral ? »
Mon oncle prêtre qui avait écouté cela de toutes ses oreilles avait réagi vivement : « Tous les fous ne sont décidément pas enfermés ! » C’est vrai qu’il y avait de quoi s’interroger sur cet opium des intellectuels et des clercs qui faisait délirer, comme ça n’était pas permis. J’y ai repensé, non sans accablement, lorsque j’ai lu la grande biographie de Mao publié il y a 3 ans chez Gallimard. Dans mes appréhensions et en fonction de mes informations (exemples La Chine du cauchemar de Lucien Bodard ou les avertissements d’un Simon Leys dans Les habits neufs du président Mao) je n’avais pas imaginé le degré d’horreur atteint par ce régime, au total le plus meurtrier du XXe siècle. Mao qu’une part de notre intelligentsia avait présenté sous les couleurs les plus laudatives – un immense penseur, un stratège génial, un politique hors classe – avait été en fait le plus cynique des manœuvriers, dépourvu d’humanité, couvert de sang jusqu’à l’écœurement. L’épouvante seule qualifie ce régime qui n’eut jamais la moindre considération pour le peuple qu’il prétendait servir.
Je sais qu’on a reproché à cette biographie d’avoir éludé la part idéologique, marxiste, de Mao, celle où un Soljénitsyne discerne le facteur multiplicateur et justificatif de la Terreur. C’est possible, mais je ne puis m’empêcher de penser que les deux auteurs sont justifiés dans leur analyse d’un personnage avide de son seul pouvoir et se servant beaucoup plus de l’idéologie qu’il n’est asservi par elle.
Que dire, en conclusion, de Jean Cardonnel ? Ma dernière entrevue à Montpellier me l’avait révélé inchangé. Il se préoccupait alors du sort des prisonniers en France. Très louable cause, pour laquelle il eut été à bon escient mobilisé à l’heure de la Chine maoïste, qui loin d’être un couvent était une immense prison. Un de ses frères dominicains, largement son cadet, membre comme lui de la province de Toulouse, m’a dit qu’il était demeuré impénitent. Sans doute était-il de ce type d’homme dont l’enthousiasme et la générosité empêchent la sagesse de les éclairer. J’avoue avoir gardé néanmoins de l’amitié pour l’homme chaleureux qui ne m’avait pas considéré et traité comme un adversaire. Le père André Gouzes m’a raconté un jour qu’il l’avait accueilli dans sa belle abbaye de Sylvanès, en lui expliquant qu’en ce haut lieu les biens spirituels et culturels étaient le plus largement offerts au peuple. C’était, d’un même mouvement, sincère et un brin malicieux. Ce qui est sûr, c’est que Jean Cardonnel a voulu bien faire, qu’il s’est dépensé sans compter pour ce qu’il croyait être la justice. On se souviendra de lui comme d’un aventurier peut-être téméraire. On regrettera ses errements, on s’interrogera sur les illusions d’une époque. Mais puissions nous, forts de la lucidité que donne l’expérience, ne pas mépriser pour autant l’élan qui veut renouveler le monde et servir les pauvres.