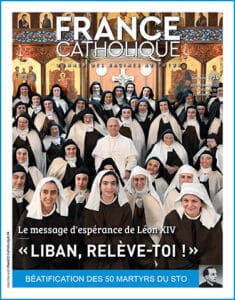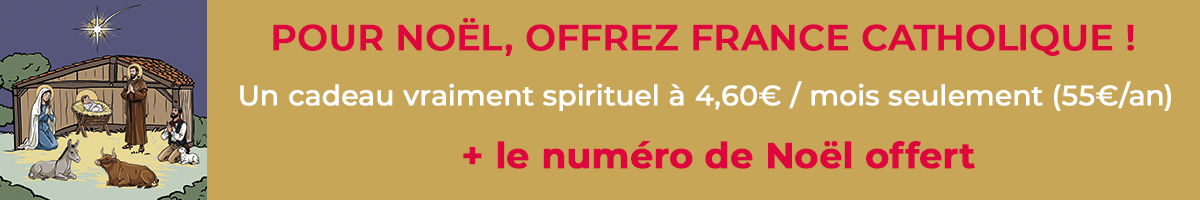Pourquoi un nouveau livre sur la liturgie ? 1
Il y a bientôt cinquante ans que le concile Vatican II est achevé. C’est l’occasion de porter un regard sur ce qui a été accompli et ce qui ne l’a pas été, ou imparfaitement. J’ai voulu dresser un tableau d’ensemble des divers aspects de la liturgie, notamment ceux que l’on oublie, par exemple, l’architecture de l’église qui fait partie intégrante de l’action liturgique.
Quels sont les acquis ?
L’insistance sur la participation commune. Dès lors que l’on était en assemblée, constituant le corps du Christ, au même titre que le corps eucharistique à proprement parler, figuré par les espèces eucharistiques, il fallait que tous les membres de ce corps vivent en unité. Cette redécouverte concordait avec une conviction des Pères de l’Église. Ils insistaient sur le fait que les croyants doivent devenir ce qu’ils sont appelés à être, le corps du Christ, et que c’est une condition indispensable pour pouvoir communier en vérité au corps eucharistique. Si cette première communion n’est pas réalisée, le corps du Christ est disloqué, et la communion au corps eucharistique du Christ ne peut qu’être parodique, faussée ou blasphématoire. Un autre acquis fut la distribution des lectures bibliques en trois années (A,B,C), et, pour chaque dimanche et fête, en trois lectures.
Y a-t-il eu d’autres aspects remis en honneur par le Concile ?
Mon livre détaille les réformes réalisées dans la mouvance de la constitution Sacrosanctum concilium. En premier, le recentrement de toute l’année liturgique sur le Mystère Pascal, et, également, la clarification des rites et des prières, parfois obscurcis sous les alluvions du passé, la création de nouvelles prières eucharistiques retrouvant des formes anciennes, diversifiant le seul Canon romain, lui-même conservé comme « première prière eucharistique », et nullement délaissé pour une autre conception de l’Eucharistie, comme l’ont prétendu faussement les détracteurs de ces créations nouvelles. Celles-ci ont tenu compte des nouveaux apports de la recherche théologique concernant l’Eucharistie, ont élargi les perspectives du mystère de l’Eucharistie, ne l’ont pas le moins du monde dénaturé.
Le bilan vous semble donc positif » ?
On saurait mauvais gré de répondre non à cette question, car la constitution sur la liturgie fut décrétée à une très large majorité par les Pères conciliaires. Contester ses dispositions reviendrait à nier qu’elles aient été inspirées par l’Esprit-Saint. On n’est aucunement légitimé à le faire. Par contre, tout ce qui a été fait au nom du Concile n’émanait pas toujours de lui… En ce sens la relecture de Sacrosanctum concilium est à recommander, ce à quoi je me suis appliqué, alors que certains « réformateurs » ne l’ont pas vraiment fait, me semble-t-il.
Quel point principal montre qu’on ne s’est pas toujours attaché à suivre exactement les dispositions du Concile ?
L’aspect de communion au plan horizontal, a été retenu, mais la dimension de la verticalité a été plutôt gommée, sous prétexte qu’elle l’était aussi par la constitution conciliaire, ce qui est inexact. La double dimension de verticalité et d’horizontalité est constitutive de la liturgie en tant que telle. On a voulu croire parfois que le Concile remettant en vigueur la dimension de corps communionnel, éliminait tout aspect de verticalité, de transcendance du mystère. Il n’en est rien. Si l’on se donne la peine de lire les textes référents, l’équilibre des deux ressort clairement.
On a dit que la messe avait été privée de toute sacralité. Il est vrai que les plus revendicatifs en matière d’évolution ont affirmé que la tentative de relier le visible à l’invisible par les signes du sacré était une entreprise d’émanation païenne, inutile et suspecte. Mais le Concile n’a jamais prétendu abolir le sacré, dont le terme même est mentionné plus de cinquante fois dans Sacrosanctum concilium. On a dit qu’en cela, il restait tributaire d’un passé révolu, qu’il fallait suivre ce vers quoi tendaient ses intentions par-delà ce que disaient ses mots. Avec ce genre d’interprétation, on peut faire n’importe quoi.
De quel sacré parlez-vous ?
D’abord celui des sacrements qui détiennent, en leur vocable même, la terminologie du sacré. Ils sont des signes spécifiques de liaison entre le visible et l’invisible, de communication de la grâce (transcendante) par le biais de signes sensibles. Tel est le sacré chrétien, qui n’a rien à voir avec le sacré des paganismes. Quand on parle du sacré, parfois, on perd tout sang-froid ; on le rejette en bloc comme émanant du paganisme au même titre que le vaudou, les cultes des Romains ou les religions à mystères. On s’autorise des amalgames. Or il y a un sacré judéo-chrétien, qui est totalement différent du ou des sacrés païens.
Comment discerner ?
La constitution conciliaire en donne un aperçu éloquent quand elle déclare : « Dans la liturgie terrestre nous participons par un avant-goût à cette liturgie céleste qui se célèbre dans la sainte cité de Jérusalem, à laquelle nous tendons comme des voyageurs, où le Christ siège à la droite de Dieu, comme ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle » (cf. S.C., n° 8). C’est dire que deux célébrations se passent en même temps et sont indissolublement unies. Qu’elles sont donc reliées l’une à l’autre par le régime des signes qui reproduisent, d’une certaine manière, le céleste en son actualité dans le terrestre. C’est un aspect de la sacralité chrétienne. Les sacrés païens sont fabriqués par les humains pour tenter de rejoindre ou d’évoquer les dieux, leur action supposée, tandis que le sacré chrétien est ordonné par Dieu Lui-même, qui sanctifie des réalités sensibles pour les rendre efficaces au plan de la grâce. Le sacré sacramental, sinon sacramentel, émane de la Sainteté divine. Comment des choses façonnées par les hommes pourraient-elles produire quoi que ce soit au plan de la grâce ? C’est le combat permanent des prophètes de l’Ancien Testament contre l’idolâtrie. L’initiative des moyens qualifiés pour s’unir à Dieu ne peut se justifier que si Lui la prend, consacre ceux-ci, les reconnaît comme émanés de Lui, les hommes religieux s’y conformant pour les rendre aptes à la communication de la grâce.
On a pourtant l’habitude de dire qu’il y a d’un côté la vie de Dieu et de l’autre ce que font les humains dans leur désir de la rejoindre et de s’y joindre.
Certes, la liturgie a un côté humain, incluant les différentes cultures et les langages des nations. Il faut en tenir compte, mais ne pas oublier que la priorité doit être accordée à la fidélité à l’Esprit de Dieu qui ne peut agir que dans les formes qui lui sont appropriées. La constitution conciliaire le dit : « Il appartient en propre à la liturgie d’être à la fois humaine et divine, visible et riche de réalités invisibles, fervente dans l’action et occupée à la contemplation, présente dans le monde et pourtant étrangère. Mais de telle sorte qu’en elle ce qui est humain est ordonné et soumis au divin ; ce qui est visible à l’invisible ; ce qui relève de l’action à la contemplation » (cf. S.C., n° 2). Au divin de la liturgie revient la première place, et, pour reprendre une expression de l’Évangile, « elle ne peut lui être enlevée ».
Vous parlez de « mystère ». Y aurait-t-il du mystère dans la liturgie ?
Pas au sens où on l’entend couramment, comme quelque chose d’étrange ou d’énigmatique. Ça, ce serait le sacré païen, le fameux tremendum mis en lumière par Rudolf Otto. C’est lui qu’on représente quand on veut évoquer le Moyen âge aujourd’hui. On l’affuble de vêtements impressionnants, parodiques et terrifiants. Il faut le bannir, mais ne pas rejeter la notion qui est traditionnellement chrétienne.
L’année liturgique, comme le rappelle le Concile, est « célébration des mystères du salut ». Ces mystères « sont en quelque manière rendus présents tout au long du temps » (cf. S.C., n° 102).
Cachés autrefois dans les arcanes du temps et de la Sagesse de Dieu, ils sont aujourd’hui dévoilés dans la vie du Christ. Ces mystères, émanant de l’insondable pensée divine, sont pleinement manifestés en Jésus. Ils ne sont donc pas cryptés, mais, au contraire, décryptés en Jésus, mais, aussi, issus de la transcendance divine qui garde toute une part d’inconnu. Voici encore un aspect à retenir du sacré chrétien. Ces événements de Salut sont manifestes, mais n’éliminent pas le fait qu’ils sont à toujours mieux comprendre, puisqu’ils contiennent en eux tout le Mystère de Dieu.
Est-ce ce que vous appeliez « la dimension verticale » ?
Cette notion vient des origines chrétiennes. Elle représente en effet la verticalité, que l’on peut appréhender également dans la symbolique de l’Église. Elle est continuellement présente dans le texte conciliaire. Il faudrait mieux la prendre en compte dans les liturgies courantes en s’attachant à les présenter de façon plus exacte, au cours des fêtes et des dimanches de l’année.
N’est-ce pas le cas aujourd’hui ?
Hélas ! Ce fonctionnement s’est mis en place après le Concile, mais lui-même ne l’avait pas conçu. Le Concile, sur ce point majeur, n’a pas été vraiment appliqué.
Les équipes chargées de programmer les célébrations prennent ce qu’elles trouvent dans le panel des chants qui existent sur le marché du chant liturgique, mais n’utilisent pas les textes qui définissent le sens que l’Église veut donner à telle ou telle fête. Cette pratique a eu pour effet de faire perdre son relief aux « saisons » de la liturgie. Il serait souhaitable que les textes officiels soient traduits, de sorte que les compositeurs puissent s’attacher à mettre en musique ce qui est effectivement prévu, et non se contenter de broder autour de façon assez imprécise dans des chants généraux, qui ne cernent pas exactement les fêtes et dimanches en leur riche texture symbolique.
n Les chants qui sont utilisés à la place des textes officiels sont-ils à écarter ?
Evidemment pas. Mais il faudrait définir leur usage avec plus de précision (tel ou tel temps liturgique, telle ou telle fête, tel ou tel dimanche), pour qu’ils ne reviennent pas à tout moment et mieux les faire cadrer à la textualité définie. En raison de leur usage général, leurs formulations sont trop imprécises au regard de la symbolique biblique dont les textes officiels de la liturgie sont imprégnés. On perd de la sorte tout un pan de culture chrétienne essentielle à l’expérience de la foi dans le temps.
On aurait intérêt à s’attacher au sens de la liturgie tel que proposé par l’Église elle-même. C’est le bon sens, sur tous les plans. C’est exprimer la foi dans la culture d’une lecture figurative et symbolique de l’Écriture. Perdre la culture de la foi, c’est ébranler son assise naturelle, cette lecture méditative, reliante et symbolique de la Bible telle que proposée par la tradition, et c’est donc la fragiliser. C’est ce que l’on voit aujourd’hui.
La langue culturelle de la foi, n’est-ce pas le latin ?
Il me semble qu’on a largement stérilisé le débat concernant la liturgie en le réduisant à un débat sur l’usage du latin. à partir de cette base étroite, toutes sortes d’arguties fallacieuses ont été défendues de part et d’autre.
Bien des contradictions auraient baissé leurs gardes, si l’on s’était attaché à l’essentiel. Le Concile n’encourageait pas la proscription du latin, mais proposait qu’il coexiste avec les langues courantes, sans systématisme, ni radicalisme. À mon sens, ce n’est pas la question du latin ou non qui est en cause, mais la question de savoir si on veut célébrer la liturgie de l’ Église, ou autre chose s’en écartant.
Pourquoi a-t-on connu des tensions ces dernières décennies ?
On ne s’est pas trouvé, quoi qu’on en ait dit, en présence de deux modes de célébrer, comparables, mais, face à un mode entièrement préétabli, et, un autre, s’éloignant des formes prescrites. Le conflit est venu en partie de ce qu’ils ont été présentés comme des styles déterminés, alors que le mode de célébrer, dit pourtant conciliaire, ne s’appuie pas assez sur les cadres définis par les textes officiels, contenus dans le missel, notamment par rapport à la célébration des « mystères », qui sont abandonnés à l’imprécision des textes en suivant des options fort différentes les unes des autres. La liturgie, « collant » plus à son génie propre, à son sens propre, n’aurait plus le caractère parfois contestable qu’on lui attribue quand elle ne célèbre pas exactement ce qu’elle est appelée pourtant à célébrer.
Il faudrait, me semble-t-il, qu’on ait plus à cœur de célébrer la liturgie de l’Eglise, et non moyennant des formes approchées qui ne sont pas elle, mais quelque peu autre chose qu’elle-même. Si l’on avait plus adopté ce point de vue, un certain nombre de griefs et d’insatisfactions n’auraient pu se donner libre cours. Le but de mon livre est de montrer que les oppositions se sont artificiellement figées, et pourraient être dépassées en élargissant les perspectives du mystère liturgique, et en les prenant toutes en compte, et non certaines au détriment d’autres.