Quelle intention peut-on prêter au pape François dans cette volonté d’associer ses deux prédécesseurs Jean XXIII 1 et Jean-Paul II1 dans une même cérémonie de canonisation le 27 avril prochain ?
On se souvient peut-être que pour sa béatification, le bon pape Jean avait été associé à Pie IX. Une des interprétations donnée à l’époque concernait la volonté de réunir deux papes réputés être de sensibilité et d’orientation différentes. C’était accorder beaucoup de crédit à des préjugés faciles et à des amalgames idéologiques qu’un minimum de connaissance du sujet aurait suffi à écarter ou à relativiser. N’était-il pas patent que Jean XXIII avait la plus grande vénération pour Pie IX, qu’il aurait voulu canoniser lui-même ? Opposer l’initiateur de Vatican I défini comme conservateur à l’initiateur de Vatican II défini comme progressiste relève du non-sens absolu, voire d’une manipulation de l’histoire sur laquelle il conviendrait de s’interroger, non sans rendre compte de la différence des époques, des contextes historiques et du renouvellement des questions posées à l’Église pour qu’elle assume sa mission pastorale dans un monde d’évidence complètement bouleversé.
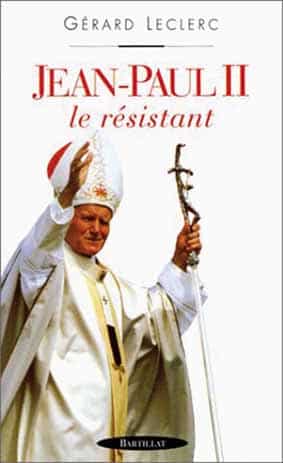
Jean-Paul II avait sans aucun doute en tête le rapprochement intéressant à opérer entre les deux hommes qui avaient assumé la responsabilité considérable de réunir les deux conciles de la période contemporaine. Bien sûr, la finalité d’une béatification consiste d’abord à authentifier la sainteté d’une vie, l’héroïsme des vertus d’un serviteur de Dieu, l’exemple donné au peuple chrétien. Mais les personnages distingués n’échappent pas à leur temps, à leur inscription dans l’histoire. Et lorsqu’il s’agit d’évêques de Rome, il n’est pas possible de mettre entre parenthèses les actes essentiels de leurs pontificats, et notamment de leur magistère. On s’en était aperçu à propos de saint Pie X, béatifié et canonisé par Pie XII. Sa lutte déterminante contre le modernisme ne pouvait être ignorée dans le cadre même des enquêtes préalables, d’autant que l’auteur de Pascendi conservait des adversaires affirmés. Apollinaire, notre poète, n’avait pas été impressionné par les attaques à l’égard de Joseph Sarto : « L’Européen le plus moderne c’est vous pape Pie X. » Ce en quoi il se retrouvait paradoxalement en accord avec Aristide Briand, qui s’était pourtant trouvé en conflit direct avec Rome au moment de l’élaboration et du vote de la loi de séparation de 1905. C’est peut-être que l’appréciation juste des événements les plus conflictuels relève de jugements supérieurs aux passions du moment.
C’est un élément d’explication à l’initiative de Jean-Paul II, allant à l’encontre des réflexes partisans et des expressions idéologiques. En choisissant cette option, il désirait de surcroît inviter à poser un autre regard sur le passé ecclésial. On pourrait risquer une opinion analogue à propos de l’initiative de François, qui a pu surprendre de la même façon. La figure de Jean XXIII est beaucoup moins familière aux nouvelles générations que celle du pape polonais qui, non content d’avoir assumé un des plus longs pontificats romains, avait marqué son temps comme acteur majeur de l’ébranlement de l’empire communiste. Cela fait un demi-siècle que le fils des paysans de Sotto Il Monte a rejoint le ciel, et même si son souvenir est resté très présent, il appartient à une autre époque. En l’associant à celui qui l’avait béatifié, François invite implicitement à une sorte d’anamnèse et de mise en perspective du temps de l’Église.
Ce n’est pas du tout un aspect secondaire du grand événement que l’Église entière va vivre le dimanche de la Miséricorde. Bien au contraire ! La reconnaissance de la sainteté d’une personne ne consiste pas dans la seule insistance sur ses mérites privés, comme s’il s’agissait de prêter attention à la démarche purement solitaire d’une âme en quête de perfection et d’un destin supra-temporel. On peut revenir là-dessus aux fortes pages du cardinal de Lubac dans son grand livre Catholicisme, corroboré par bien des études postérieures. Alors que la contemplation du sage grec est solitaire, ce que Plotin traduit par « la fuite du seul vers le Seul », le christianisme affirme à l’encontre de toutes les spiritualités du monde « une destinée transcendante pour l’homme et pour l’humanité une destinée commune ». « D’où, en connexion étroite avec son caractère social, un autre caractère de notre dogme, également essentiel : son caractère historique. Si, en effet, le Salut que Dieu nous offre est le Salut du genre humain, puisque ce genre humain vit et se développe dans le temps, l’exposé de ce Salut prendra naturellement la forme d’une histoire : ce sera l’histoire de la pénétration de l’humanité par le Christ. »
Les événements contemporains, comme tous ceux qui les ont précédés, ne sont pas de l’ordre d’une circularité vaine, où tout se reproduirait sans cesse sur le modèle d’un cycle sans cesse recommencé. Le dynamisme du Salut a fait exploser tout cela et notre existence la plus personnelle est reliée à une construction qui est pleine de sens, car l’avènement de la Révélation nous rend participants d’une histoire où l’Esprit est à l’œuvre. En d’autres termes, associer Jean XXIII et Jean-Paul II c’est nous inciter à reconnaître comment l’Église s’est construite en notre temps, singulièrement grâce à l’élaboration du concile Vatican II, à laquelle les deux serviteurs de Dieu ont été étroitement associés. Le premier en fut le concepteur et l’initiateur, le second y participa activement du début à la fin, en fut comme archevêque de Cracovie le plus diligent des applicateurs et comme évêque de Rome le plus pertinent des interprètes pour mener le concile à sa pleine consécration.
C’est bien pourquoi il s’avère utile de revenir sur les parcours de l’enfant de Sotto Il Monte et de l’enfant de Wadowice, pour comprendre comment l’un et l’autre ont travaillé à une même œuvre grâce à leurs talents parfois contrastés, grâce à une même ferveur pour le développement du dessein divin à travers la croissance du corps ecclésial. Mais à cette fin, il faut être au plus près de ce qu’ils furent réellement, en ne craignant pas d’ébrécher certains mythes qui s’opposent à l’intelligence de leur parcours, de leur pensée, de leur projet. Or, avec Jean XXIII, le travail de déconstruction du mythe constitue une nécessité première, tant sa persistance obère la réalité de la personnalité et de ses intentions.
Le mythe Jean XXIII, c’est tout simplement le mythe d’un pape progressiste, dont la volonté d’ouverture au monde aurait conduit à vouloir révolutionner l’Église, en l’accordant aux idéologies du temps. Mais les choses sont encore plus subtiles. Elles tiennent à l’éclosion de la civilisation de communication de masse, qui ne va pas sans création de ce que, déjà à l’époque, Edgar Morin signalait, notamment avec la création « d’un Olympe de vedettes qui domine la culture de masse, mais communique par elle avec l’humanité courante ». C’est notre cher ami Luc Baresta qui, dans son très beau livre sur Jean XXIII, restitue l’ensemble des fils et des réseaux qui ont imposé une certaine image du pape. Image qui, avec la très vive émotion suscitée par l’agonie de celui-ci s’imprime comme définitivement dans une opinion captive. Luc Baresta reprend aussi une analyse publiée pendant l’été 1963 par le père Rouquette dans un article des Études à propos de l’association du mythe à la cause de la paix internationale, à un moment de crainte de guerre mondiale, voire nucléaire. Il faut savoir qu’à l’époque la thématique de la paix est soigneusement colonisée par le pouvoir soviétique et l’appareil communiste, lesquels accablent le pape de louanges intéressées. Le père Rouquette note que Jean XXIII s’est imposé comme « la voix de l’agneau parmi les loups ». « Mais cette création d’un mythe n’est pas sans danger. Il faut garder notre lucidité devant cette inattendue explosion d’enthousiasme pour un pape. La tentation serait de l’utiliser pour une apologétique facile. »
De la paix, on passe rapidement à l’ouverture à gauche. Apertura a sinistra qui résonne particulièrement en Italie, en raison de la présence du plus puissant Parti communiste d’Europe occidentale. Il suffit de connaître un peu les tendances personnelles de Giuseppe Roncalli, qui, patriarche de Venise, s’est opposé très fermement à un tel tournant de la vie politique italienne, pour prendre conscience que l’on est en pleine propagande. Mais la force de développement du mythe est telle qu’on ne peut plus arrêter sa dynamique. Jean XXIII reçoit-il au Vatican le gendre et la propre fille de Khrouchtchev, le maître du Kremlin, que son geste est interprété tout de suite comme celui d’un rapprochement de l’Église avec le communisme ainsi que d’un désaveu des condamnations portées par le magistère dans les documents les plus solennels. Dans la même foulée, Jean XXIII deviendra le contraire de son prédécesseur immédiat Pie XII, qu’il révère pourtant.
Et que dire du concile ? La formule d’aggiornamento va devenir celle de tous les travestissements possibles, au point d’agacer sérieusement un Urs von Balthasar, par ailleurs favorable à des réformes sérieuses, notamment celle qui consiste à raser les bastions qui, sous couvert de protéger, empêchent la communication de l’Évangile au monde. C’est dire à quel point s’impose un véritable discernement. Il ne fait pas de doute qu’en convoquant un concile, le pape songe à une réforme profonde de l’Église dans sa tête et dans ses membres. Ce n’est pas pour autant que Jean XXIII se retrouve dans le courant qui, s’exprimant largement dans le cadre d’un péri-concile relayé par les médias, voudrait opérer une rupture par rapport à l’Église de toujours. Le cardinal Congar, pourtant associé à l’œuvre de renouveau, s’insurgera lui aussi contre les entreprises qui « visent à démolir et saccager ».
Bien sûr, d’autres formules du pape ont été reprises dans le cours des polémiques parfois féroces qui attisent les oppositions. Celle sur « les prophètes de malheur », énoncée dans le discours d’ouverture de Vatican II a fait mouche. Si l’on relit de près le texte, on saisit que le pape en veut à ceux qui désespèrent de tout progrès possible et se réfugient derrière un catastrophisme qui risque d’inhiber toutes les énergies de l’évangélisation. Ce n’est pas pour autant qu’il prône un optimisme béat ou se rallie à une philosophie de type marxisant. Le problème essentiel n’est pas là. Si Jean XXIII a choisi de se lancer dans le défi audacieux d’un concile œcuménique, c’est qu’il est profondément imprégné de culture historique et qu’il s’est particulièrement intéressé au concile de Trente et à ses suites. Cela, grâce à l’exemple de saint Charles Borromée, archevêque de Milan qui sut tirer les conséquences du concile de Trente à travers une œuvre réformatrice et surtout constructrice dont le jeune Roncalli avait mesuré l’importance. N’avait-il pas publié 3 000 pages en cinq tomes, pour établir Les actes de la visite apostolique de saint Charles Borromée à Bergame en 1577 ? À Bergame, c’est-à-dire chez lui, dans son diocèse natal. Luc Baresta en montre tout l’intérêt qu’il est impossible de ne pas associer à l’idée d’un nouveau concile dans la suite du grand concile de Trente : « Cette histoire, de quoi est-elle faite, sinon des deux efforts conjugués qui sont, avec des accents divers, ceux de l’Église qui se ressaisit : effort doctrinal dont les résultats, touchant le dogme alors menacé, furent à Trente impérissables ; et conjointement au premier l’effort disciplinaire et pastoral dans une époque où la contamination du “monde”, de ses richesses et de ses pouvoirs avaient en maint lieu affadi ou même tragiquement altéré l’image visible du sel de la terre. C’est bien dans ce double effort qu’il faut situer saint Charles Borromée. »
Il y a aussi un curieux paradoxe à faire revêtir des habits par trop modernistes à un homme qui est foncièrement de tradition, par ses origines terriennes, par ses goûts spontanés, par sa culture aussi, qui se distingue notamment par un attachement à la langue latine. Celle qu’il voudra promouvoir dans un document Veterum Sapientia, accueilli avec beaucoup d’agacement par ceux qui le brocarderont en « sagesse des croulants ». Mais en quoi un enracinement si profond s’opposerait-il à l’évidence de nécessités nouvelles, telles qu’elles surgissent du présent ou telles qu’elles résultent des ratages du passé ? Durant toute sa carrière de représentant du Saint-Siège, en Bulgarie, en Grèce, dans la France de la Libération, Mgr Roncalli a eu les yeux grands ouverts sur les misères et les drames — comment oublier les juifs qu’il secourut pendant la guerre ? — et sur les innovations apostoliques. Qu’il ait conçu un vif attrait pour les relations œcuméniques, singulièrement avec l’orthodoxie, qui s’en étonnerait ?
Mais il faut, en définitive, se demander pour quel motif déterminant Jean XXIII a voulu Vatican II. Rien d’autre que la volonté d’exprimer avec le plus de force possible les richesses du christianisme, pour que le monde reconnaisse le visage du Christ ressuscité. Toutes les gloses ne pourront effacer ou amoindrir cette certitude centrale, exprimée de la façon la plus nette dans toutes les déclarations annonçant le concile : « Ce qui est demandé, maintenant à l’Église, c’est d’infuser les énergies éternelles, vivifiantes et divines, de l’Évangile, dans les veines du monde moderne. » (Bulle d’induction du concile, 25 décembre 1961) « Que peut être un concile, sinon le renouvellement de cette rencontre avec le visage de Jésus ressuscité, roi glorieux et immortel, rayonnant à travers toute l’Église pour sauver, réjouir et illuminer les nations humaines ? » (Message au monde entier, 11 septembre 1962). Ce parti pris pour l’annonce directe de la bonne nouvelle supposait la mobilisation de la vertu d’espérance. Et si le saint pape n’ignorait rien de la puissance des ténèbres, il était animé par la certitude que la lumière de Pâques pouvait la vaincre. Ou encore, comme le dit Luc Baresta, si les prophètes de l’Ancien testament prédisent les malheurs encourus par infidélité à l’Alliance, Yahvé en sa miséricorde pouvait faire surgir du désert un jardin.
Le concile pouvait d’autant moins renier l’intégrité de la foi qu’il devait la faire briller dans tout son éclat. D’où la décision de ne pas procéder selon l’habitude conciliaire qui faisait passer l’affirmation positive de la foi par l’intermédiaire de l’anathème contre l’hérésie. Cela explique la difficulté rencontrée dès le début de la première session du concile, avec des schémas préparés par les services de la curie, mais selon une méthode scolastique très formelle et dans une perspective purement défensive. Jean XXIII n’avait pas voulu cela et il ne pouvait s’opposer aux pères conciliaires insatisfaits, qui désiraient qu’on reprenne le travail dans l’esprit que lui-même avait préconisé. De là à parler de révolution conciliaire et même comme le fit de façon un peu catastrophique Yves Congar, de « révolution d’octobre dans l’Église », il y avait l’amorce d’une confusion mortelle dont allaient profiter ceux qui voulaient faire un usage détourné, voire pervers de Vatican II. Mais ceux-là agissaient à l’encontre de la volonté formelle de celui qui avait donné les directives les plus claires et les plus irrécusables.
On sait que Jean XXIII ne devait connaître que la première session de Vatican II, laissant à son successeur Jean-Baptiste Montini le soin de présider les trois autres sessions. Il est hautement probable qu’il pressentait que ce serait Montini qui reprendrait la tâche et l’achèverait. Pouvait-il prévoir que Paul VI aurait à subir douloureusement le poids d’une crise post-conciliaire que la réussite incontestable de Vatican II n’annonçait pas ? C’est une des raisons pour lesquelles il est extrêmement intéressant d’observer l’attitude de Mgr Karol Wojtyla, d’abord présent dans l’aula de Saint-Pierre comme auxiliaire de Cracovie mais participant très actif jusqu’à jouer un rôle essentiel dans la rédaction de la Constitution Gaudium et Spes. Dès le départ, il a communié à fond avec l’esprit de l’entreprise, il en a saisi tous les ressorts, toutes les potentialités pastorales, de telle sorte que de retour à Cracovie il a mis son diocèse en état d’intérioriser la doctrine conciliaire et de l’actualiser notamment dans le cadre d’un synode très participatif. Le cardinal de Lubac m’a confié plus tard que si tous avaient agi comme Wojtyla, il n’y aurait pas eu de crise post-conciliaire.
Un point essentiel doit être souligné, parce qu’il nous donne la clé de l’impact indissolublement doctrinal et pastoral du concile. Celui-ci a beaucoup insisté sur la nature intime de l’Église comme sacrement du Salut et pure expression de la lumière du Christ, mais il a également formulé de façon très précise ce qu’on pourrait appeler, en terme stratégique, l’angle d’attaque d’intervention de l’Église dans les affaires du monde. La séparation qui est intervenue à l’ère moderne entre le spirituel et le temporel a pu avoir un effet négatif, avec une sécularisation de la société qui l’a rendue imperméable à l’appel de la grâce et du salut. Mais l’Église ne renonce pas pour autant, elle sollicite l’attention générale en revendiquant sa compétence dans l’ordre anthropologique. Elle est donc à même, de ce point de vue de dispenser un enseignement précieux à tous les hommes qui sont en situation de l’entendre, pour peu qu’ils soient réceptifs aux sollicitations profondes de leur être ou de leur cœur.
Karol Wojtyla a énormément insisté là-dessus, parce que toute sa recherche depuis sa jeunesse, étayée par la phénoménologie, la tradition thomiste, aidée aussi par son enracinement littéraire, et enfin éclairée par la théologie et la mystique, l’avait persuadé de recourir à une approche de la personne référée à la grâce rédemptrice du Christ. Son mot d’ordre si célèbre « N’ayez pas peur » désignait la seule confiance dans le Christ sauveur et miséricordieux, qui concerne chaque homme et tous les hommes. C’est en vertu de cette approche que l’Église était légitime à provoquer sans cesse le monde pour l’appeler à reconnaître cet appel du maître intérieur, conformément à une tradition qui n’avait pas commencé au XXe siècle. L’attachement de Karol Wojtyla aussi bien à la spiritualité de Marguerite-Marie à Paray-le-Monial qu’au témoignage de sœur Faustine s’intègre dans la piété de tous les siècles chrétiens.
Dans ces conditions, l’homme qui prend la succession de Paul VI et de Jean-Paul Ier, à l’automne 1978, sait parfaitement en quoi son pontificat et son magistère seront inspirés par un concile qu’il a vécu et dont il toujours su distinguer le véritable enseignement. C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de dégâts, mais ceux-ci ne sont pas imputables, comme le croient Mgr Lefebvre et ses disciples aux déviations du concile et aux poisons qui y auraient été distillés. Ce qui s’est produit, c’est une véritable trahison stigmatisée par un Lubac meurtri qui dénonçait « un oubli du Salut, un éloignement de l’Évangile, un rejet de la Croix du Christ, une marche au sécularisme, un laisser-aller de la foi et des mœurs, bref, une dissolution dans le monde, une abdication, une perte d’identité, c’est-à-dire la trahison de notre devoir envers le monde ». Tout l’effort de Jean-Paul II consistera à revenir à l’esprit qui a pris corps dans les textes de Vatican II pour relancer l’Église dans la dynamique d’un renouveau de la foi.
Ce faisant, le pape venu de l’Est ne faisait que reprendre l’élan conciliaire et celui que Jean XXIII avait voulu donner au travail des pères. Ce fut l’objet du Catéchisme de l’Église universelle, aussi appelé de ses vœux par l’épiscopat mondial, et dont Jean-Paul II rappelait dans sa préface qu’il correspondait étroitement aux travaux et aux textes de Vatican II : « Avec l’aide de Dieu, les pères conciliaires ont pu élaborer, au long de quatre années de travail, un ensemble considérable d’exposés doctrinaux et de directives pastorales offert à toute l’Église. Pasteurs et fidèles y trouvent les orientations pour le renouveau de toute la vie ecclésiale voulue et mise en application par le deuxième concile du Vatican. »
Comment ne pas relier tout ce récit à la situation présente et au témoignage donné par le pape François, traçant librement son sillage dans une cohérence de fond avec le beau labeur théologique de Benoît XVI ? Le dessein sans cesse affirmé de François de faire briller la miséricorde de Dieu dans les plaies de l’humanité ressemble trait pour trait à celui de Jean-Paul II qui n’a eu de cesse de prêcher un Dieu « riche en miséricorde ». En quoi, il faisait aussi écho au bon pape Jean, qui dans ce fameux discours d’ouverture du concile déclarait : « Aujourd’hui, l’épouse du Christ préfère recourir au remède de la miséricorde plutôt que de brandir les armes de la sévérité. » Cela ne signifie nullement que l’Église renonce à dénoncer les forces du mal et ce qui détruit profondément l’humanité. On sait comment François n’hésite pas constamment à rappeler l’existence de Satan et son pouvoir mortifère sur le monde.
Mais à l’encontre d’une spiritualité de type janséniste, au pire sens du terme, l’Église préfère mettre en évidence la sollicitude divine, la chance et la joie d’être sauvé. Dans sa préface au livre de Luc Baresta, le père Bernard Bro fait un saisissant raccourci des intentions du concile, et d’abord de celle du pape qui en décida la tenue : « Vatican II : c’est le concile qui a relu tous les autres conciles à travers le plus haut attribut divin : la miséricorde. Vatican II, c’est tous les conciles relus à travers les larmes du curé d’Ars, la douleur pressante de saint François de Sales et l’offertoire de Thérèse de Lisieux. Elle avait tout pressenti dans son « Offrande à l’amour miséricordieux ». C’est l’intuition la plus profonde de Jean XXIII. Elle est révolutionnaire et instauratrice. »
Est-il étonnant que deux des papes qui ont promu cet Évangile de la miséricorde soient eux-mêmes proclamés saints ? Qu’on me permette en conclusion d’associer deux images de Giuseppe Roncali et Karol Wojtyla, à la veille immédiate de leur installation comme successeurs de Pierre. Giuseppe Roncalli, on le retrouve dans un couloir, en pleurs, assis sur sa valise. Karol Wojtyla, la veille du conclave, passe toute la nuit étendu de tout son long, les bras en croix dans sa chapelle. Ces hommes ne furent si grands que parce qu’ils étaient habités par l’humilité des disciples du Christ en croix.
- Gérard Leclerc, Le Pape et la France, Éditions Bartillat, 188 pages, 16 €. Jean-Paul II, Le résistant, Éditions Bartillat, 248 pages, 17 €. ↩︎








