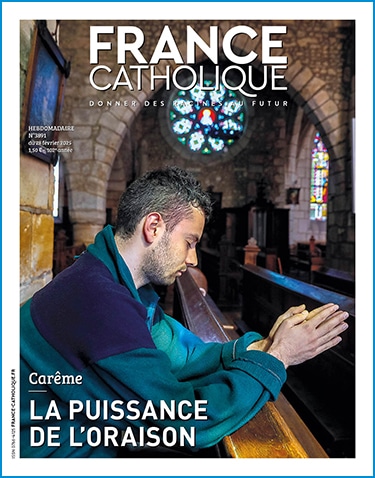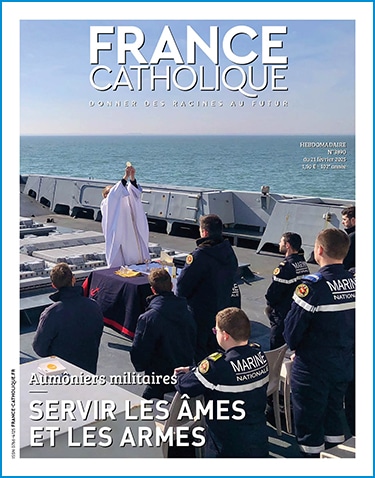DONC, M. MITTERRAND a réuni les experts de l’économie socialiste pour examiner les divers aspects de la crise actuelle (voir FC-E du 20 juin, page 51). Et posant la question de savoir si le capitalisme allait s’effondrer, il a répondu : « Non, pas encore, et pas sans lutte politique. »2
L’économie est un épais fourré où le profane s’égare et disparaît sans laisser de traces. Ce qui pourtant l’encourage à oser y mettre son grain de sel (je parle pour moi qui n’y connais rien), c’est premièrement que les experts ne semblent guère plus heureux, se trompent toujours dans leurs prévisions, ne s’entendent pas même pour expliquer ce qui s’est passé, adhèrent à des théories contradictoires, n’arrivent jamais eux-mêmes à faire fortune3, et, deuxièmement, que l’on voit souvent des illettrés en dominer si bien la pratique et les lois qu’ils y passent maîtres et s’y taillent des empires.
La réussite de M. Floirat
Pour moi, j’ai reçu mon illumination en économie le jour où j’ai entendu un éminent spécialiste, auteur de nombreux livres respectés, professeur de renommée internationale, mais aussi impécunieux que moi, expliquer clair comme le jour, dans une conférence, comment M. Sylvain Floirat (ancien chauffeur de poids lourds) était devenu ce qu’il est4.
L’éminent professeur nous fit comprendre cette destinée foudroyante en l’expliquant par les ensembles, l’algèbre de Boole et plusieurs autres instruments abstraits, dont M. Floirat n’a jamais entendu parler, dont il se moque bien mais dont il permet l’usage à ses ingénieurs avec un grand libéralisme (pourvu toutefois que leurs plans réussissent).
Revenons à M. Mitterrand. Il pense que le capitalisme ne s’effondrera pas encore cette fois. Seules, dit-il, de nombreuses petites entreprises s’effondreront, cependant que, conformément aux lois du capitalisme, les grosses deviendront plus grosses.
Par prudence, compte tenu de mon ignorance crasse en la matière, je ne proposerai sur ce pronostic que quelques réflexions vagues, disons historico-philosophiques.
D’abord, je ne vois pas, en effet, (hors les conséquences politiques) pourquoi le capitalisme aurait quoi que ce soit à redouter d’une crise, étant donné que le capitalisme est une crise. Le capitalisme ne marche, c’est connu, qu’en se détraquant. Tous ses progrès se font par crises. Il ne dispose que d’une façon de s’adapter aux situations nouvelles, et c’est précisément de faire une crise.
Ou plutôt comme toute situation historique est par définition nouvelle, il est en état de crise (c’est-à-dire de mutation) permanente. Plus la situation varie vite, et plus son état de crise s’aggrave. La crise actuelle, comme les précédentes, est signe de changement. Simplement, cette fois, le changement est plus rapide et douloureux5.
Que se passe-t-il donc dans le système capitaliste quand apparaissent des situations imprévues ? La réaction est mécanique, puisqu’elle n’est contrariée ni palliée par aucun plan : tout ce qui est inadapté s’effondre. Mais en même temps, des esprits ingénieux saisissent les occasions nouvelles et font leur bonheur du malheur des autres.
Toute la grandeur et l’horreur de la révolution industrielle (vécue par l’Europe au XIXe siècle) se trouvent dans cette mécanique. Parce que le malheur des crises est vécu essentiellement par le monde ouvrier, les théoriciens révolutionnaires du XIXe siècle inventèrent l’idée de classe. L’abondance, au moins dans quelques pays, a changé ici quelque chose de fondamental : le système peut maintenant s’offrir le luxe de payer ses chômeurs. Aux États-Unis, le chômeur gagne plus que notre smicard, avec un coût de la vie moins élevé (sauf pour le logement).
Le prix de la métamorphose
La crise peut-elle détruire le capitalisme ? M. Mitterrand est réaliste en répondant : « Non. » Il est réaliste aussi quand il dit que seule l’action politique peut le détruire. Non seulement son évolution spontanée par voie de crises ne peut le détruire, mais c’est de cette façon qu’il se nourrit de ses échecs, qu’il accélère son histoire. Si la crise actuelle est assez grave et si ceux qui la subissent l’acceptent, le monde occidental en sortira changé.
Quelles raisons ceux qui la subissent, c’est-à-dire les plus pauvres, ont-ils de l’accepter ? C’est là qu’intervient la politique, où tout est passion imprévisible. Personne n’a jamais expliqué pourquoi la même misère a fait le Labour en Angleterre, la social-démocratie en Allemagne et en Suède, le parti communiste en France. Même un ignorant réfugié dans les idées vagues et historico-philosophiques n’a aucune lumière à proposer là-dessus.
Supposons par pure hypothèse que les peuples des pays capitalistes supportent la traversée actuelle sans que leurs épreuves les induisent à changer d’idées politiques, qu’en sortira-t-il ? Un monde où une part notable de nos présentes structures se sera effondrée pour faire place à d’autres, actuellement inexistantes et imprévisibles. Un monde métamorphosé.
Peut-on aller plus loin, essayer de deviner la nature de ces métamorphoses ? L’exemple des crises précédentes nous donne peut-être une réponse. Quels ont été les résultats de la dernière guerre ? En quoi ont-ils transformé le monde ?
Ecartons, de ces résultats, ceux qui découlent du mouvement des armées (pays occupée militairement, etc.). Ce qui reste est de nature technique, scientifique : l’automation, l’informatique, le nucléaire, l’électronique et, d’une façon plus fondamentale, un commencement de décadence de la priorité de l’énergie, de l’industrie lourde et des matières premières en faveur des concepts nouveaux d’information, de management, de travail et de capital intellectuel toutes réalités qui ont permis le relèvement si rapide de pays détruits mais hautement intellectualisés, comme le Japon, l’Europe Occidentale, l’essor d’Israël, et qui ont aussi assuré la mainmise quasi universelle et si mal supportée de l’Amérique, mecque de la science et de le technologie.
On peut donc prédire à coup sûr que sauf révolution politique, (ainsi que le dit M. Mitterrand), les résultats de la présente crise seront de nature technologique et scientifique.
Je crois qu’on peut sans risque de se tromper aller un peu plus loin encore dans la prédiction !
La vanité des plans
Pendant tout l’avant-guerre, Staline, à coup de plans menés tambour battant, s’était donné comme objectif de dépasser l’Amérique dans ce qui faisait alors la puissance d’un pays : la production du charbon, de l’acier, de l’industrie lourde. Cet objectif est largement atteint. L’URSS produit maintenant plus de charbon et plus d’acier que les États-Unis6.
Seulement, en 1975, ce n’est plus cela qui fait la puissance et l’avance d’un pays ! Les réalités historiques se sont métamorphosées de façon imprévue, donc hors des normes de toute planification imaginable. L’URSS a dépassé les Etats-Unis, mais elle est plus éloignée que jamais de les rattraper ! Il en sera ainsi tant que les plus défavorisés en Occident accepteront les crises sans broncher, ou tant que les pays planificateurs ne libéreront pas ses secteurs évolutifs de la contrainte planificatrice.
On peut donc prédire que, si elle ne déborde pas le cadre économique, la crise actuelle se soldera par un surcroit de retard des pays planificateurs (et, bien entendu, il ne faut pas entendre seulement par là les pays socialistes).
Dans nos prochaines chroniques, j’exposerai quelques–unes des percées de la science de ces dernières années, en les choisissant parmi celles qui peuvent avoir une influence imprévisibles sur l’Histoire.
Aimé MICHEL
Chronique n° 209 parue dans F.C. – N° 1489 – 27 juin 1975.
Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 14 juillet 2014
- Cette chronique parue la semaine précédente est la n° 208, La bousculade américaine – La source révolutionnaire de ce temps, c’est l’Amérique, mise en ligne le 05.12.2011. Elle se termine par une prévision : « Je ne sais si nous allons vers une crise. Mais je prédis, si elle vient et si elle est assez grave, qu’elle profitera à l’Amérique deux ou trois ans plus tard, qu’elle se traduira par l’apparition de créations inattendues et révolutionnaires, comme lors de la dernière guerre, l’atome et l’informatique. Malheureusement les « booms » américains font des éclats et tout le monde n’est pas né pour la bousculade. »
- C’était trois ans après la signature du Programme Commun de gouvernement entre le parti socialiste, le parti communiste et les radicaux de gauche qui devait conduire François Mitterrand à la présidence de la République six ans plus tard.
- Cette critique des économistes est exprimée dans plusieurs chroniques. Aimé Michel écrit par exemple « Les immenses travaux des sociologues et des économistes, pour ne parler que d’eux, ont souvent révélé des faits insoupçonnés. Mais ces résultats n’ont permis ni d’améliorer la société ni de gérer ses richesses. Les améliorations, quand elles se sont produites, semblent avoir été mises au monde par le hasard. » (La providence et les microscopes… – Certaines ignorances sont providentielles, mises en ligne le 07.04.2014).
- Sylvain Floirat (1899-1993), ouvrier devenu milliardaire grâce à son sens des affaires, est né en Périgord d’un père cordonnier et d’une mère épicière et mercière. Ses parents sont trop pauvres pour lui payer des études secondaires alors, muni de son seul certificat d’étude, il s’engage comme apprenti chez un carrossier-charron. A quinze ans il va à Paris et suit par correspondance des cours de comptabilité puis de dessin industriel. Embauché dans une usine de carrosserie il en gravit tous les échelons jusqu’à devenir directeur. Il achète alors avec ses économies un atelier de carrosserie-charronnage et devient ainsi fabriquant de cars, les « Cars Floirat » ce qui lui permet de racheter des lignes d’autocars dans le sud de la France. Résistant à Marseille de 1940 à 1943, il revient à Paris et crée en 1945 la société de transport aérien Aigle-Azur. Dix ans plus tard il la revend (elle deviendra alors U.T.A.) et rachète Bréguet-Aviation qu’il dirige jusqu’à sa vente, en 1967, à son ami Marcel Dassault. En 1955 également, il reprend la société en difficulté qui exploite la radio Europe n° 1. En cinq ans il la redresse et il la préside jusqu’en 1981.
Sylvain Floirat conserva l’accent rocailleux de son Périgord natal et demeura toute sa vie un homme simple qui aimait retrouver les vieux de son village au bistrot. Il resta aussi fidèle aux principes qui firent sa fortune : travail acharné et sens des réalités. Ainsi, en 1967 à l’ENA, il rappelait que « Le profit est l’axe de tout. Sans profit, pas de dividende, ce dividende qui est aussi sacré que la paye du personnel, qui passe même avant la machine. Chaque fois qu’on oublie le profit, on fait machine arrière. » (cité par Philippe Denoix dans l’article sur Sylvain Floirat de l’Encyclopaedia Universalis). Lui savait bien que quand on oublie de compter c’était la peine ouvrière qu’on oublie de compter.
- Cette interprétation de « la » crise apparaît encore plus pertinente aujourd’hui qu’en 1975. Pourtant, cette « évidence » est-elle entrée dans les esprits ?
- La presse et de nombreux économistes dissertaient encore en 1975 sur la puissance industrielle de l’URSS qui était couramment présentée comme la deuxième puissance économique du monde après les États-Unis. Or cette vision des choses était profondément erronée pour au moins deux raisons. La première, qu’Aimé Michel remarque à juste titre, est que les productions de charbon et d’acier ne font plus, à cette époque déjà, la puissance d’un pays ; l’évolution de ces industries au cours des dernières décennies l’a amplement confirmé. La seconde raison est plus surprenante : c’est que la production annuelle de 145 millions de tonnes d’acier affichée par l’URSS, qui en faisait la première puissance sidérurgique au monde, était tout simplement sans signification ! Voici en effet l’explication qu’en donne quelques années plus tard l’historien Alain Besançon dans un petit livre qui demeure l’un des plus utiles pour comprendre ce que fut l’URSS, Anatomie d’un spectre. L’économie politique du socialisme réel (Calmann-Levy, Paris, 1981) :
« Chacun sait que l’U.R.S.S. ne produit pas plus d’automobiles que l’Espagne ; que l’équipement des ménages en appareils d’acier n’est pas comparable au nôtre ; que le réseau ferré n’est guère plus long que celui de l’Inde ; que le réseau routier est très inférieur à celui de la France ; que la production de tanks ne peut absorber, si démesurée qu’elle soit, plus d’un ou deux millions de tonnes d’acier. Que peut donc signifier ce chiffre de 145 millions de tonnes, soit autant que la production réunie du Japon et de l’Allemagne, qui produisent ensemble une douzaine de millions d’automobiles et bien autre chose ? Il faut donc supposer que dans ces 145 millions de tonnes figurent : 1° la production de vrai acier ; 2° la production d’aciers inférieurs ; 3° la production d’aciers de rebut ; 4° la production d’acier pour la rouille ; 5° la production de pseudo-acier et 6° la pseudo-production d’acier. Un spécialiste de l’économie soviétique est sans doute capable de ventiler la production d’acier entre ces six chapitres. Il justifie finalement ce chiffre de 145 millions de tonnes en tenant compte de gaspillages, d’utilisation différente de l’acier, de pertes, etc. Il reste que l’assertion “première puissance sidérurgique du monde” est à prendre hors de son sens commun, car on ne peut comparer que ce qui est comparable. Les États-Unis et le Japon, deuxième et troisième puissances sidérurgiques du monde, et dont il est très facile d’analyser à quoi ils emploient leur acier, ne produisent pas en quantité comparable les cinq dernières catégories d’acier que l’U.R.S.S. coule avec une si extraordinaire abondance dans des laminoirs géants. » (pp. 15-16)
Cet exemple reste d’actualité en ce sens qu’il invite à exercer un certain sens critique à l’égard d’assertions qui pour être partagées par beaucoup de monde n’en sont pas moins fondamentalement fausses.