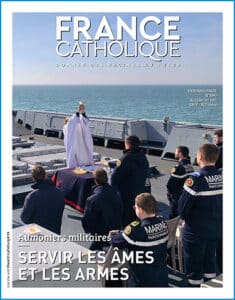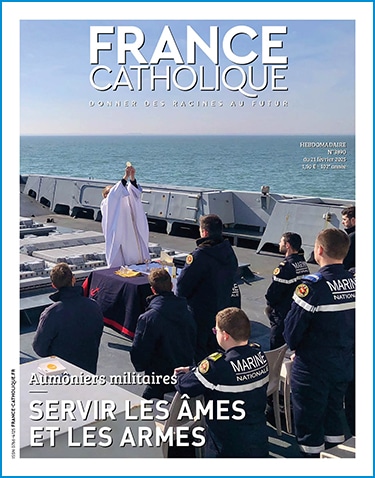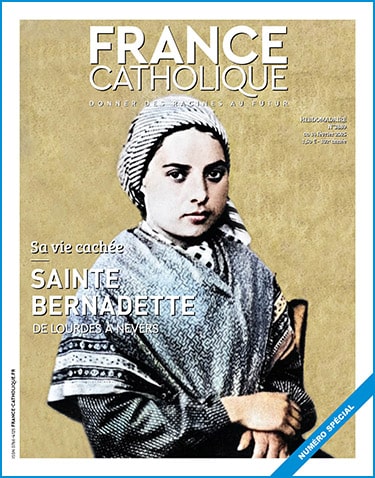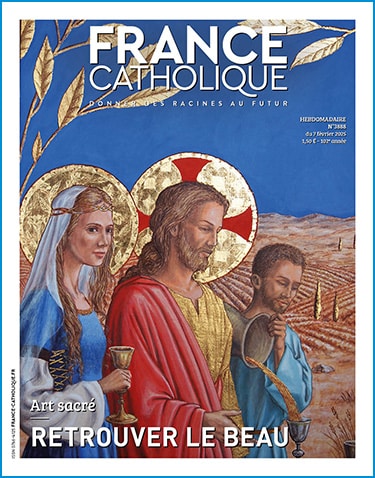Ier février
Raymond Aron. Je viens de lire les pages admirables de Pierre Manent (dans son recueil intitulé Enquête sur la démocratie) sur ce grand homme que j’ai toujours suivi avec attention alors même que je n’étais pas sûr d’appartenir à sa famille intellectuelle. Qu’importait ! Il faut se méfier de cette notion de « famille intellectuelle » lorsqu’elle risque de glisser du côté des camps d’où l’on s’observe pour éventuellement faire feu. Heureusement, mes fidélités ne m’ont jamais vraiment empêché de regarder ailleurs, et j’ose même dire que mes adversaires m’ont souvent rendu des services considérables, notamment celui de libérer le sens de la discussion, celui qui permet de penser dans un autre espace. Mais je n’ai jamais considéré l’auteur de L’opium des intellectuels comme un adversaire et, rétrospectivement, je le considère comme un maître qui m’a appris énormément de choses. C’est lui qui m’a donné l’essentiel de mon savoir sur Marx et surtout de mon discernement sur le marxisme. Il m’a empêché de subir les sortilèges des marxismes imaginaires, celui de Sartre et celui d’Althusser. À ce propos, j’ai été très reconnaissant à Jean-Paul Casanova de reconstituer le grand livre que Raymond Aron avait porté sur le sujet sans pouvoir jamais le rédiger en entier. J’y ai retrouvé toutes les articulations que les autres livres avaient mises en lumière.
Je n’ai rencontré le philosophe qu’une seule fois – personnellement j’entends. C’était pendant la campagne présidentielle de 1981 qui mettait aux prises Giscard et Mitterrand. Il était sur le point de déménager de son bureau de la Maison des Sciences de l’Homme du boulevard Raspail où nous nous étions retrouvés. Nous avons sans doute passé plus de deux heures à l’interroger avec Stéphane Denis sur le président sortant qu’il défendait. Mais ce n’est pas ce que j’ai retenu de ses propos. Le mur de Berlin n’était pas encore tombé et le face à face Est-Ouest s’imposait encore avec de redoutables bras de fer. On a oublié un peu vite que la crise des euro-missiles atteindra son apogée en 1983. Aron n’est alors nullement persuadé d’un effondrement rapide du système soviétique, et il souhaite de toutes ses forces que les États-Unis tiendront le choc. Notre entretien sera interrompu par un appel téléphonique de Madame Aron prévenant son mari du succès du lancement de je ne sais plus quelle fusée depuis le cap Canaveral. Aux yeux du philosophe il était important que les Américains gardent « le moral » pour aller jusqu’au bout d’un combat dont le sort lui paraissait encore incertain.
Autre souvenir : quelle ne fut pas ma surprise d’être cité et discuté dans les Mémoires que Raymond Aron publia en 1983. C’était à propos d’une chronique que j’avais consacrée à son livre d’entretiens avec Dominique Wolton et Jean-Louis Missika Le spectateur engagé (Julliard 1981), deux remarquables intervieweurs qui devaient récidiver plus tard avec l’indispensable Choix de Dieu du cardinal Lustiger. Je m’étais permis – ce qui ne manquait pas d’un certain culot – de présenter avec assurance quelques objections péremptoires à l’intéressé, non sans avoir préalablement exprimé ma gratitude à son endroit. Raymond Aron ne faisait-il pas trop confiance à notre société de production, insuffisamment soucieux de son nihilisme de fond ? Et les Mémoires de citer quelques-unes de mes formules : « Le malheur, c’est que ce parfait honnête homme, ce juste, soit aussi le défenseur inconditionnel d’une civilisation qui porte en elle-même sa contradiction. » Ou encore : « Dans un monde nihiliste, la liberté sur fond d’abandon n’a plus rien de raisonnable… il est dommage qu’un homme aussi avisé ne se soit pas rendu compte des limites du monde libéral. » Et bouquet final : « Cette société est fille plus encore du désir que de la raison. » Ce qui m’autorisait à invoquer Nietzsche et Heidegger par-delà Tocqueville et Max Weber, références typiquement aroniennes.
Apparemment mon outrecuidance n’avait pas indisposé Aron qui se donnait la peine de me répondre assez largement : « Je n’ai besoin ni de Nietzsche, ni de Heidegger pour savoir que le devenir de l’humanité n’obéit pas à la raison. » Mais c’était pour conclure in fine : « Contre les maux de la civilisation industrielle, les armes nucléaires, la pollution, la faim ou la surpopulation, je ne détiens pas le secret de remèdes miraculeux. Mais je sais que les croyances millénaristes ou les ratiocinations conceptuelles ne serviront à rien ; je préfère l’expérience, le savoir et la modestie. Si les civilisations, toutes ambitieuses et toutes précaires, doivent réaliser en un futur lointain les rêves des prophètes, quelle vocation universelle pourrait les unir en dehors de la Raison ? »
Encouragé par un tel traitement de faveur, je répliquais un peu plus tard par une autre chronique dont j’ai oublié les arguments. Malheureusement, Raymond Aron ne put en prendre connaissance, puisqu’il allait mourir la veille de sa parution. Avec la distance, je serais assez enclin à méditer ces dernières lignes, stimulé d’ailleurs par la synthèse que Pierre Manent établit si brillamment de sa pensée. Cette majuscule finalement employée pour la Raison n’était-elle pas un symptôme de l’énigme qui traverse toute la philosophie d’un homme qui n’a jamais renoncé à penser en termes généraux alors qu’il était pris sans cesse dans la contingence des faits qu’il analysait en journaliste supérieur ?
La Raison est-elle plus que la faculté qui permet de déterminer quelques idées régulatrices ? Dans ce cas il faudrait mesurer la révérence et préférer la minuscule. Mais il faut croire que, pour l’agnostique, la Raison est tout de même ce qu’il y a de plus estimable dans l’échelle des valeurs, et cela avant même d’avoir mesuré au plus loin ce que Urs von Balthasar appelle « ses dimensions ».
Ne reconnaissant pas les dimensions métaphysiques, le philosophe ne pouvait même entrevoir un sens général de l’histoire. Et pourtant ! Le père Gaston Fessard n’était-il pas fondé à trouver dans sa trajectoire intellectuelle une énigme impossible peut-être à dénouer, mais surtout impossible à éliminer. Dans les Mémoires, Aron se montre extrêmement sensible au livre posthume que Fessard lui a consacré (La philosophie historique de Raymond Aron) et qui répond à l’objection faite naguère par Léon Brunschvicg à la thèse de jeunesse sur La philosophie de l’histoire. Celle-ci était-elle « un drame sans unité ? » Non répondait le jésuite car il y avait dans toute l’œuvre aronienne « une théorie de l’action et la recherche du sens dans l’histoire ». L’homme qui s’est toujours dressé contre les totalitarismes, et qui a dénoncé avec une juste vigueur les compromissions des intellectuels avec le stalinisme, ne pouvait considérer les choix politiques sans référence à des fins ou à des valeurs. Ce qui conduit à réfléchir sur le sens de l’homme et de son agir. Le Père Fessard voyait bien s’esquisser une certaine unité du drame qu’en théologien il envisageait surnaturellement. Raymond Aron, sans pouvoir acquiescer, ne refusait pas la possibilité. Et il comprenait en quoi son ami religieux pouvait trouver des points de repère dans cette direction, ne serait-ce que la signification de la destinée du peuple juif : « Dans l’introduction, je distinguais histoire naturelle et histoire humaine. Je n’éliminais pas catégoriquement l’Histoire surnaturelle ou sacrée, ou si l’on veut, le vide. Le père Fessard, lui, remplit le vide par sa foi au Christ. »
Pierre Manent, de son côté, montre comment l’agnosticisme, ou même l’athéisme de Raymond Aron paraissait sans problème, sans nostalgie apparente. En même temps, « on ne trouve pas chez lui ces railleries et ces pointes si caractéristiques de la tradition française des Lumières à laquelle il appartient. » Mais il ajoute ceci qui est extrêmement intéressant : « Si, d’une façon mystérieuse nos amis font partie de nous-même et de ce que nous sommes, alors il importe de remarquer ceci : les esprits les plus spontanément et les plus profondément attentifs à l’œuvre philosophique d’Aron furent des catholiques, en particulier l’historien Henri-Irénée Marrou et le père jésuite Gaston Fessard. » Cela ne prouve rien, mais rien n’empêche de rêver à ces « complicités tacites », à ces « affinités informulables » qui dessinent « le réseau invisible d’une fraternité dont ni les uns ni les autres ne savent le secret ».
Pourtant il y a une raison décelable de cette affinité. Elle tient au goût de l’histoire et au fait que les chrétiens sont sensibilisés plus que d’autres aux rapports du temps et de l’absolu, des événements et de l’Esprit qui s’y révèle. Aron n’avait évidemment pas la culture biblique et patristique des Lubac, Balthasar, Daniélou, Bouyer, Marrou, mais il ne pouvait que les intéresser prodigieusement, ne serait-ce qu’avec tout ce qu’il leur apprenait sur les grands Allemands élaborateurs de l’intelligibilité historique. L’agnosticisme scientifique du penseur constituait un puissant stimulant à pressentir comment, mystérieusement et aux yeux de la foi, une unité de sens pouvait se profiler…