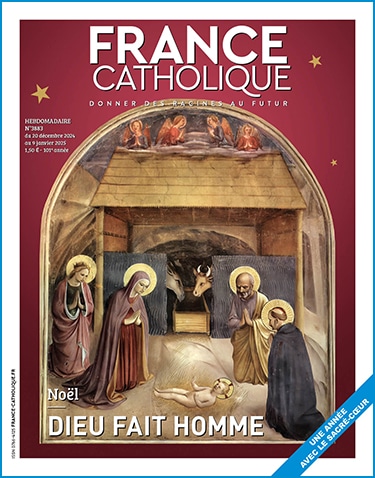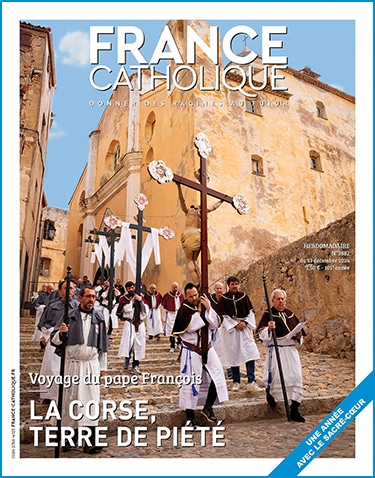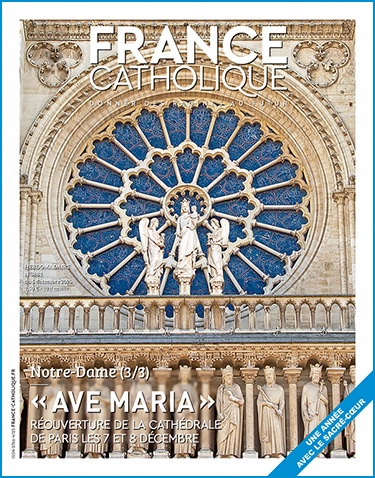C’est une captivante expérience de psychologie collective que les élections présidentielles à la française. La Constitution imaginée par le général de Gaulle, avec son scrutin direct, ne ressemble de ce point de vue à aucune autre, du moins parmi les principales Constitutions contemporaines. II est vrai que les Américains élisent eux aussi leur président. Mais leur scrutin est indirect et leurs candidats ont besoin du parrainage d’un parti. En France, c’est le choix de l’homme sur sa mine, ses propos, sur sa personne.
Je ne sais si je me trompe mais il me semble qu’historiquement, pour retrouver des chefs souverains ainsi directement élus au suffrage universel direct, il faut remonter à la Gaule pré-romaine. Sans doute de Gaulle y avait-il pensé. Et ma foi, à voir le succès populaire de ce rite, il semble qu’il ait gagné son pari sur la permanence d’une certaine Gaule…
Tenons-nous-en à la psychologie. Je gage que nous avons tous été surpris par les fluctuations des sondages au cours de la campagne1. Est-il vraisemblable qu’en si peu de temps tant d’électeurs aient si souvent changé d’idée ? N’est-il pas plus raisonnable de supposer que les idées restant les mêmes, un je ne sais quoi s’est passé, par le truchement des mass media, entre la personnalité des candidats et celle des citoyens ?
L’effet de masse
Cette hypothèse est d’autant plus vraisemblable, que sur le fond des choses, les idées et les programmes offerts par les deux principaux rivaux n’étaient pas séparés par un abîme, les commentateurs l’ont souligné à l’envi. En face du candidat de la gauche, il s’agissait bien de choisir entre deux personnalités. Le problème est donc là : qu’est-ce qui, entre ces personnalités, a déterminé le choix ?
L’établissement du leadership2 a été étudié de bien des façons sur toutes sortes de groupes sociaux : colonies de vacances, campus universitaires, clubs sportifs, amirales d’anciens, « fans » de telle ou telle activité collective (y compris la délinquance). Le problème consiste à déterminer les traits physiques, intellectuels et moraux des personnalités qui prennent la tête, qui imposent leur autorité. Les résultats ne sont pas simples, loin de là3.
D’abord intervient la dimension du groupe. Il s’avère qu’une personnalité qui s’impose sans difficulté au sein de, par exemple, dix petits groupes différents, peut perdre la suprématie dès que l’on rassemble ces dix groupes en un seul. Tel qui sait s’imposer en détail est dépassé en bloc.
Il est certain que bien peu, parmi les hommes politiques du début du siècle et d’avant, auraient résisté à l’épreuve de la télévision, ou même de la radio. Il leur suffisait, pour dominer, de convaincre une assemblée, l’état-major d’un parti. On voit mal Richelieu lancé dans une campagne électorale et encore moins Mazarin qui baragouinait un mauvais français.
L’effet de masse mis en évidence par les psychologues est bien visible dans l’histoire des révolutions. Au début, dans le désordre des grands mouvements populaires, ce sont les tribuns qui s’imposent, les personnalités théâtrales, les Mirabeau par exemple. Puis la révolution s’organise en clubs, en cabinets, en cellules. Alors la voix feutrée des Robespierre devient audible, les manœuvres silencieuses des Staline l’emportent.
Ou plus simplement, ce peuvent être l’habileté ou la compétence. Ce n’est probablement pas un hasard si MM. Chaban-Delmas et Edgar Faure, qui sont ou ont été des présidents d’Assemblée et des leaders de partis, ont moins bien réussi devant le grand nombre : les qualités exigées ne sont pas les mêmes.
Les méthodes dites de sociométrie (a), appliquées en Amérique par C. et M. Sherif à l’observation des colonies de vacances, ont montré d’autre part que le leader n’est pas forcément la personnalité la plus populaire. Dans certaines circonstances, le groupe accepte ou même réclame pour chef quelqu’un que personne n’aime (b).
En fait, le leader que l’on se donne dépend en premier lieu des circonstances et des besoins subjectifs de groupe, des besoins qu’il croit avoir. Plus les circonstances sont tendues, plus le choix risque de se porter sur des personnalités redoutées plutôt qu’aimées. C. et M. Sherif ont montré, aussi que plus les situations sont tendues, moins les liens affectifs entre le groupe et son leader sont partagés : le leader qui se révèle dans la violence « n’aime pas » ses compagnons. Son sentiment dominant tend au contraire vers le mépris.
Un autre fait observé par ces deux psychologues est plutôt étonnant. Il a cependant été confirmé par d’autres chercheurs, y compris par ceux qui étudient les animaux sociaux (par exemple les babouins)4 : dans les situations violentes, le groupe a tendance à choisir le leader qui respecte le moins les règles du groupe.
Savoir l’heure du pire…
En d’autres termes, dans les situations violentes, les actes que le groupe tient pour délictueux deviennent, quand ils sont commis impunément et avec audace, d’excellents arguments politiques. Sans doute faut-il chercher dans cette réaction paradoxale la réussite du nazisme au sein du peuple le plus légaliste d’Europe. Sans doute aussi explique-t-elle la violence de tous les gauchismes.
Citons enfin un résultat observé par des psychologues américains ayant étudié l’autorité des maîtres d’école sur leur classe. En apparence, nous sommes loin de la politique, mais est-ce sûr ? Les écoliers préfèrent les professeurs offrant les traits moraux et physiques de l’archétype paternel (ou maternel s’il s’agit d’une femme).
On pense évidemment à Pompidou, à Golda Meir, à Adenauer. On pense aussi à l’extraordinaire réaction d’horreur provoquée chez les Américains par Watergate. Les Américains savent bien que tous les chefs d’État font chaque jour bien pire que d’écouter les conversations de leurs adversaires. Mais un père qui triche, c’est inadmissible…5
Aimé MICHEL
(a) J. L. Moreno : Les fondements de la sociométrie (PUF, 1954).
(b) C. et M. Sherif : Groups in harmony and tension (Hayen and Row, New York, 1956). Voir aussi : D. Krech et R.-S. Crutchfield : Théorie et problèmes de psychologie sociale (2 vol., PUF, 1952).
Chronique n° 186 parue dans France Catholique-Ecclesia – N° 1431 – 17 mai 1974
Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 28 avril 2014
- Il s’agit de la campagne présidentielle de 1974. Le 2 avril 1974 Georges Pompidou décède à Paris. Le 19 mai, Valéry Giscard d’Estaing est élu président de la République avec 50,81 % des suffrages exprimés contre 49,19 % à François Mitterrand. Jacques Chirac est nommé Premier ministre le 27 mai.
- Aucun mot français équivalent à « leader » ne s’est imposé. Meneur aurait pu faire l’affaire si les psychologues français s’en étaient emparé et lui avait permis d’acquérir avec le temps la connotation positive qu’il n’a pas au départ. Si cela ne s’est pas fait c’est parce que, jusqu’à une époque récente, ces psychologues ne se sont pas intéressé à la question de l’origine de l’autorité : la notion de chef leur suffisait, ils n’avaient pas besoin de celle de meneur ! Or il existe une différence entre le chef et le meneur. En effet le chef reçoit son autorité de l’institution qui le nomme, alors que le meneur voit sa prééminence reconnue par le groupe social qu’il influence. Les Romains, déjà faisaient cette différence entre la potestas et l’autoritas, entre le pouvoir fondé sur la légalité et l’autorité personnelle fondée sur la légitimité.
- Le leadership est un des nombreux thèmes de recherche de la psychologie sociale, discipline qui s’intéresse à la manière dont les pensées, les sentiments et les comportements d’un individu sont influencés par d’autres individus ou la société. Le livre de Gustave Le Bon, La psychologie des foules (1895), et celui de Jacob Levy Moreno, Who Shall Survive (1934), dont la première traduction française citée par Aimé Michel (Les fondements de la sociométrie, 1954), sont deux classiques de cette discipline. Moreno (1892-1974), Viennois émigré aux États-Unis en 1925, est considéré comme le fondateur de la sociométrie, c’est-à-dire de la quantification et de la modélisation des relations au sein des groupes et un des pionniers de la psychothérapie de groupe. Pour lui, les groupes se développent en fonction des attractions et des répulsions entre les individus selon des lois accessibles à la mesure.
Sur quoi repose le leadership ? De quoi donc est faite l’autorité personnelle ? Cette question a donné lieu à des milliers d’articles, motivés tant par le désir d’améliorer le fonctionnement des sociétés humaines que par les attentes pratiques des entreprises et des organisations. Le résumé d’Aimé Michel donne une bonne idée de la diversité des travaux entrepris et de la complexité des réponses apportées. Remarquons que, conformément à son habitude, il ne mentionne que des travaux expérimentaux fondés sur des mesures, qui seuls méritent d’être qualifiés de scientifiques (il en existe bon nombre d’autres qui se complaisent dans des développements verbeux).
Si on poursuit la distinction entre chef et leader, on voit qu’il existe une tension chargée d’électricité politique entre deux réponses extrêmes : l’une qui voit la source de l’autorité dans les qualités du leader, l’autre dans la disposition du groupe à l’égard de celui qui dirige ; autrement dit l’une où la prééminence du chef suffit selon un processus autocratique allant de haut en bas, l’autre où il faut une investiture démocratique selon un processus allant aussi de bas en haut. Les sociologues américains, en particulier Kurt Lewin (1890-1947), qui, Juif comme Moreno, dut fuir l’Allemagne en 1933, ont apporté des arguments en faveur de la supériorité du leader démocratique sur le leader autoritaire. À l’aide d’expériences sur de petits groupes (école, atelier, etc.), ils ont montré que la représentativité du leader favorisait la cohésion du groupe, que son autorité dépendait de l’objectif du groupe et que l’efficacité de son commandement était fonction de son aptitude à donner corps à ce que les sujets veulent réaliser. Mais ce schéma n’est pas valable en toutes circonstances, en particulier, comme le souligne Aimé Michel, il cesse de s’appliquer dans des situations de violence.
- Chez les espèces sociales les relations entre membres d’un groupe peuvent en effet prendre la forme d’une organisation hiérarchique avec des individus dominants et des individus subordonnés. Un petit nombre d’espèces d’invertébrés ont des groupements ou des sociétés hiérarchisés, comme certains crustacés (pagures, écrevisses) et quelques espèces d’insectes (blattes et hyménoptères : bourdons, guêpes des genres Polistes et Vespa), même si des sociétés d’insectes développées comme l’abeille domestique, les fourmis et les termites ne semblent pas avoir d’organisation de ce type. Par contre, les sociétés hiérarchisées sont très fréquentes chez les diverses classes de vertébrés, poissons, reptiles, oiseaux, mammifères, à l’exception des amphibiens. Chaque individu de la société occupe un rang déterminé, souvent très stable. La hiérarchie peut être linéaire (chez les poules par exemple), avec un individu alpha au sommet, suivi d’un bêta et ainsi de suite jusqu’au dernier, mais il n’en va nécessairement ainsi : l’individu A domine B qui domine C, mais C peut dominer A (hiérarchie triangulaire).
L’établissement de la hiérarchie peut impliquer ou non des luttes. Il est remarquable que ces luttes, même spectaculaires, entraînent rarement des blessures graves, sauf dans des situations de surpopulation (ou de captivité) où la compétition peut conduire à l’élimination du dominé par la faim, les blessures ou le stress. On retrouve donc en sociologie animale des dysfonctionnements comparables à ceux observés en sociologie humaine.
- Les écoutes téléphoniques ne sont pas d’aujourd’hui… Sur Nixon et le Watergate, voir la chronique n° 48, Les casseurs de Babylone, parue ici le 05.07.2010.