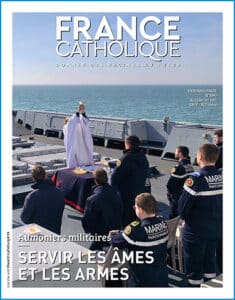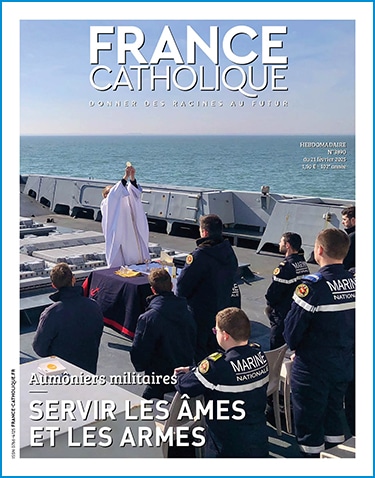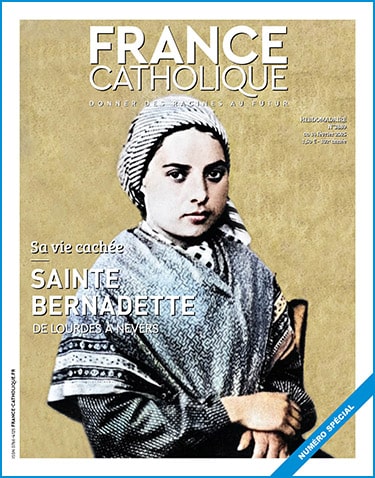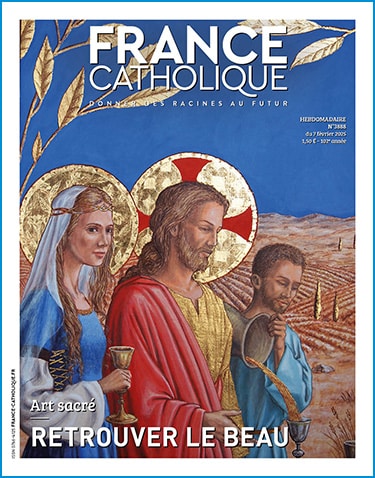28 MARS
Hier soir, à l’invitation du groupe Sénevé, dans la salle du couvent des dominicains, Faubourg St-Honoré, j’ai aussi expérimenté en quelque sorte des réflexions que je me formule à moi-même depuis quelques années à propos de l’homosexualité. J’ai peut-être surpris – au moins au début – mon auditoire par un certain “détachement”, une objectivité dans l’analyse, où je racontais, j’expliquais, sans formuler de jugement. C’était volontaire de ma part, car mon souci premier était de faire un récit avant même d’engager une réflexion philosophique ou théologique. Seule ma fille Thérèse m’a un peu reproché cette neutralité méthodologique, très calculée, trouvant que le sujet était trop grave pour que je m’abstienne, même provisoirement, d’engager le fer et de dénoncer le péril social. Je persiste néanmoins à estimer utile le récit pour faire comprendre d’où on vient et où on va. D’où on vient ? De la marginalité revendiquée encore dans les années soixante. Où on va ? A un bouleversement complet des structures sociales à partir d’une révolution symbolique.
30 MARS
Les Lumières ! Il n’est pas de jour où la révérence ne soit faite à cet âge de raison et de tolérance… Si on va y voir d’un peu près, la réalité est moins brillante. Ce n’est pas sans connaissance précise du sujet qu’un Benjamin Constant pouvait abruptement déclarer : “Etrange philosophie, à dire vrai, celle du dix-huitième siècle, prenant du plaisir à tout dégrader et à tout avilir ! Quand on relit avec attention les ouvrages de cette époque, on n’est pas étonné de ce qui a suivi ni de ce qui en résulte encore à présent.” Xavier Martin cite ce texte en conclusion d’un Voltaire méconnu (Dominique Martin-Morin), terrible dossier à charge pour le sieur Arouet, qui n’est pris qu’à ses propres tours, ses humeurs et ses haines. L‘étrange bonhomme ! Comment Philippe Sollers, dont les goûts littéraires sont souvent classiques et sûrs – s’est-il entiché d’un écrivain à l’égard duquel Gœthe avouait son aversion. Un type vraiment insupportable, demi-fou – ses intimes étaient encore plus durs – mesquin, rancunier jusqu’à la vengeance.
Bien sûr plaident pour lui ses causes célèbres, l’affaire Calas en premier lieu. Mais si c’était les arbres qui cachent la forêt ? Car on s’étonne du mépris du grand défenseur pour cette famille Calas (“des protestants imbéciles”), de l’indulgence pour les juges qui ont condamné sur des faux indices. Silence des historiens et des biographes sur des déclarations embarrassantes…
De mon cours de littérature française, en classe de Première, j’avais gardé une idée mitigée de l’auteur de Candide. Il est vrai que le cher abbé Lemaire excellait dans les portraits en nuances et les jugements balancés – lui était un véritable tolérant. J’ai partagé sa conviction d’un Voltaire complexe, dont la rouerie cachait des trésors d’indulgence et le scepticisme d’étonnantes perplexités métaphysiques. En lisant Xavier Martin, ce qui reste de mes illusions s’effondre. Je prends conscience de l’énorme charge de ressentiment de l’obsédé d’ “Ecrasons l’infâme”, sa haine de la figure du Sauveur.
Cette hystérie devait se retrouver dans la déchristianisation révolutionnaire. Le violent carnaval qui s’acharne sur les églises, les croix, les statues, multiplie sacrilèges et blasphèmes, traque les prêtres fidèles, est-ce l’assouvissement de la haine voltairienne ? C’est le passage à l’acte ! Et pourtant, le libraire-imprimeur Nicolas Ruault, principal réalisateur et diffuseur des œuvres complètes et posthumes du patriarche de Ferney, s’affole de ce spectacle : “Nous avons vu ce que jamais on n’avait vu sur terre : la religion détruite par la populace et par ses prêtres mêmes.” Il en sera retourné et finira par écrire à son frère : ”Jetons-nous mon cher ami à la Providence de Dieu en bons chrétiens que nous sommes ; nous n’avons rien de mieux à espérer.”
La “sainte haine” de Voltaire contre ce qu’il appelle “la charogne”, il faudrait la psychanalyser. Peut-être y trouverait-on des circonstances atténuantes. Quelle idée lui avait-on donné du christianisme ? Quelles relations avec les jansénistes, dont on sait qu’il les haïssait aussi ? Mais est-ce en raison du jansénisme ? Sa conception du Salut ? Sans donner toutes les réponses, l’ouvrage de Xavier Martin offre à penser sur la frénésie du personnage, son égomanie, son refus de tout pardon, même après la mort de ses adversaires, ce qui avait le don d’irriter le roi de Prusse Frédéric II, pourtant son plus célèbre complice.
C’est cela qui rend la lecture de ce livre débilitante, décourageante, et qui fait sans cesse ressurgir “le hideux sourire” dont parle Musset.
30 MARS
Passer du XVIIIe au XXe siècle n’est pas une assurance de plus grande satisfaction. Et j’en reste au domaine des Lettres et d’une certaine philosophie. Pierre-André Taguieff, en publiant, Les contre-réactionnaires (Denoël) convie à un spectacle aussi peu plaisant que celui des rancœurs voltairiennes. Les rancœurs anti-réactionnaires ont inspiré une littérature tout aussi malhonnête. Avec Taguieff, il faut s’attendre à des études-fleuves, à des bibliographies quasi exhaustives. Depuis La force du préjugé qui constituait une analyse imparable de l’antiracisme, il a toujours procédé de la même façon. L’érudition ne signifie pas l’exclusion de la profondeur philosophique. Ce qui m’avait frappé avec ses premiers livres, c’était son refus de se laisser aller à l’à-peu-près des bons sentiments. C’était dans le climat des premiers succès du Front national et de l’antiracisme qui lui répondait. Il fallait impérativement quelqu’un comme lui pour désenchanter le « mardi gras de l’esprit » que constituait l’idéologie du métissage généralisé opposée à la démagogie raciste. L’antiracisme n’est pas indemne du racisme qu’il combat en adoptant ses catégories, alors qu’il croit en prendre le contre-pied. C’est justement le contre-pied qui est facteur de dérive et d’erreurs funestes.
Taguieff s’occupe donc aujourd’hui de la “chasse au réactionnaire”, en rappelant qu’elle demeure héritière de la rhétorique stalinienne, réduisant tout adversaire à un “fascisme” infamant, a fortiori lorsqu’il est étranger au nazisme ou au mussolinisme. Cela nous vaut un pavé de 600 pages que je n’ai pas lâché jusqu’à sa conclusion, tant il m’apportait d’éclaircissements. Je ne me risquerais pas à le résumer, mais je tiens à souligner comment il oblige à reconsidérer la notion de Progrès et l’adhésion que l’on est sommé de signer à un progressisme forcément émancipateur. Une des plus grandes tyrannies actuelles est liée à la religion du moderne et de ce que Taguieff appelle encore le bougisme.
3 AVRIL
Mais nous voilà entrés dans la grande Semaine de l’année, celle qui exigerait que l’on fasse silence sur ce qui n’est pas l’essentiel, que l’on s’arrache à l’actualité qui nous aliène et aux futilités qui nous rendent inconsistants. Les chrétiens ont une chance extraordinaire qui prend son maximum d’intensité avec la liturgie des Jours saints. Pour qui, depuis l’enfance, s’est trouvé saisi par cette divine dramaturgie, il est inconcevable de se dérober à cet appel qui soulève tous les horizons et d’abord notre horizon d’homme, celui où s’entrouvre le sens d’ici-bas. Jeudi saint, Vendredi saint, Samedi saint, Saint jour de Pâques commencé dans l’illumination de la nuit, rien ne peut seulement évoquer autant le bouleversement du passage de la mort à la vie. Et le plus indicible s’exprime dans la pureté mélodique du Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem. Mortem autem crucis…
Ce n’est pas par convention que j’évoque l’enfance. C’est dans mes jeunes années que j’ai été initié au Triduum pascal dans une église qui se métamorphosait, notamment le Vendredi saint avec une immense croix plantée à l’entrée du chœur. A ce sujet, une chose que je ne parviendrai jamais à comprendre, c’est la défiance post-conciliaire à l’égard des servants d’autel. Les enfants de chœur qu’on a massivement supprimés. Pourquoi ? La perception directe de la liturgie n’a pas de prix et la proximité du mystère du sacerdoce est un privilège pour entrer dans l’intelligence de la mission ecclésiale. C’est une des raisons pour lesquelles je n’ai jamais senti de rupture dans l’évolution de ma foi. Lorsque dans les années quatre-vingt, j’étudiais La Dramatique divine de Balthasar et tentais de faire partager mes découvertes, j’avais le sentiment d’une continuité avec l’enfance, d’un développement au sens où le cardinal Newman en parle.
Autre impression de cette semaine : l’accord de la piété populaire la plus spontanée avec les événements célébrés, notamment cet exercice de piété si simple et si touchant qu’est le chemin de Croix. Il y a quelque chose d’indépassable dans la vénération de la Croix par tout un peuple, que ce soit à Notre-Dame ou dans la plus humble des paroisses de banlieue.
4 AVRIL
L’histoire de la guérison de sœur Marie-Simon-Pierre m’a paru admirable. J’ai mal supporté une certaine narquoiserie dans les médias. Dans notre sacré pays, on évolue souvent de la pensée franchouillarde, carrément vulgaire, au scepticisme des esprits glacés. Or, pour reconnaître un signe comme celui-là, il faut une disponibilité intérieure, une humilité apte à rendre possible l’étonnement, non pas au sens de l’ébahissement, mais à celui de la pureté du cœur. Sœur Marie-Simon-Pierre qui était atteinte par la maladie de Parkinson – maladie dont on ne guérit pas – s’est trouvée libérée des symptômes de son mal, non en vertu d’un traitement médical, mais d’une grâce obtenue à la suite d’une intense prière. La simplicité de cette seule proposition nous renvoie à ce qu’est un signe ; c’est-à-dire une sorte de sourire d’en-haut. De ce point de vue, il y a radical malentendu avec le rationalisme contemporain et la mentalité ambiante qu’il produit. Par miracle, il entend, me semble-t-il, un fait tapageur, de quoi esbaudir les badauds, quelque chose d’invraisemblable en somme. Le mouton à cinq pattes pour dire les choses sommairement. A ce niveau, la discussion ne peut qu’être bloquée et l’incompréhension radicale.
Un signe, il faut être « disposé » à le voir, non pas conditionné. A ceux qui lui réclament un signe spectaculaire, Jésus oppose son refus cinglant. Une des difficultés actuelles, bien mise en évidence par Mgr Jacques Perrier à Lourdes, tient dans la confrontation entre l’aspect scientifique de la vérification et le signe lui-même, d’un autre ordre.
9 AVRIL
Le seul grand signe qui nous a été donné c’est la Résurrection. J’ai été heureux que mes enfants m’affirment qu’un de leurs souvenirs le plus fort d’enfance c’était la nuit pascale à Saint-Leu, avec notamment la proclamation de l’Exultet du Père André Gouzes. J’ai toujours pensé que la plus profonde sensibilité se dessinait in hymnis et canticis. Je ne dirai pas pour cette fois qui m’a mis cela en tête. Car la littérature est seconde par rapport à l’essence de la vie spirituelle. Il arrive qu’écrivains et poètes nous indiquent le mot, l’expression qui convient le mieux à un secret. Un secret, c’est-à-dire quelque chose d’ancré au plus profond de soi, qu’on ne peut jamais complètement révéler. C’est vrai aussi qu’on peut le trahir, non forcément en le divulguant mais en lui étant infidèle en esprit et en vérité.
12 AVRIL
Les éditions genevoises Ad Solem, remarquablement dirigées par Grégory et Isabelle Solari, rééditent John Henry Newman ! Il est vrai que Le Cerf s’est attelé depuis longtemps à l’édition des sermons : j’en compte 5 volumes dans mon rayon newmanien ! Mais ici il s’agit de reprendre la collection de Textes newmaniens jadis publiée chez Desclée de Brouwer sous la direction de Louis Bouyer, Maurice Nédoncelle et Henry Tristram. J’en ai une bonne partie, incomplète néanmoins, ne serait-ce qu’à cause de l’absence de l’Apologie, son autobiographie dont je me suis procuré une édition plus ancienne que celle réalisée par Ad Solem. Merci ! Merci pour cette œuvre de salut public… Il est paradoxal que soit indisponible en français un des plus grands théologiens de l’Eglise catholique. Je me souviendrai toujours qu’au chevet du cardinal de Lubac, durant ses derniers mois, il y avait la photo de l’auteur de L’Essai sur le développement, qui lui correspond si profondément. Ce n’est pas pour rien que Jean Guitton l’appelait le « Newman français ». Mgr Olivier de Berranger, l’actuel évêque de Saint-Denis a écrit une belle étude sur la parenté entre ces deux grands docteurs.
Les deux volumes d’Ad Solem reprennent les Sermons universitaires et Esquisses patristiques, avec leurs commentaires de la précédente édition. J’ai lu ceux-ci avec un vif intérêt car, tout en nous ramenant à une culture pas toujours familière, ils s’insèrent dans les débats et les soucis les plus actuels, qui sont, il est vrai, parfois récurrents. Prenons le thème du rapport de la foi et de la raison, celui de la Révélation et de la science qui lui est associé. Ils font l’objet de longues réflexions dans les Sermons universitaires et celles-ci sont venues conforter et éclairer de manière supérieure ce que j’avais tenté d’indiquer à propos de la guérison de la sœur Marie-Simon-Pierre. « Si la volonté libre oriente l’acte de foi, la grâce ouvre les yeux du croyant et donne à son esprit la lumière neuve au sein de laquelle, il aperçoit la vérité chrétienne. » C’est Maurice Nédoncelle qui écrit ces lignes, en soulignant que Newman est déjà implicitement catholique quand il prononce ces sermons, alors qu’il n’a pas encore sauté le pas institutionnel. Dans la démarche vers la foi « l’homme prépare d’une certaine façon son assentiment surnaturel et il y coopère. La nature n’est pas tellement mauvaise, il n’y a pas de serf-arbitre : l’homo sapiens n’est pas aveugle et paralysé, il ne se confond pas entièrement avec ce vieil homme dont parle l’Ecriture”. Voilà pourquoi, dans le signe, la part de vérification scientifique ne saurait être éludée, parce que l’aspect extraordinaire relève d’une vérification positive, objet d’intelligence rationnelle et étape préalable avant l’authentification en tant que « miracle ». Le motif essentiel du signe, c’est Dieu qui le donne, et si la raison n’est pas ouverte à cette pure gratuité du don, elle est incapable de le reconnaître.
J’ai été heureux de retrouver aussi dans l’introduction de Nédoncelle le parallèle qu’il fait entre Newman et Rousselot. Le nom de Pierre Rousselot m’est familier à cause de mon oncle et parrain, qui était prêtre et avait fait ses études théologiques au séminaire universitaire de Lille, où il avait découvert, ébloui, les écrits de ce jeune jésuite (mort à 37 ans en 1915 à la crête des Eparges).
J’ai depuis toujours L’intellectualisme de saint Thomas, le seul livre de Rousselot publié, et qui nous offre de l’Aquinate une conception beaucoup plus dynamique de l’intelligence, à l’opposé de ce que dénoncerait Etienne Gilson, dans un certain rationalisme prétendument thomiste. Mais ce n’est pas à cause de l’intellectualisme que Rousselot est demeuré principalement dans l’histoire de la pensée chrétienne. C’est à cause de sa longue étude publiée en 1910, dans les Recherches de science religieuse, sous le titre “Les yeux de la foi”.
Rousselot a dit lui-même l’influence que Newman avait exercée sur lui pour formuler sa conception des rapports de l’intelligence et de la foi qui ne vont jamais sans la médiation de l’amour : « Nous croyons parce que nous aimons ». Le problème spéculatif concerne l’articulation précise de l’intelligence et de la foi qui, pour Rousselot, est essentielle. C’est la grâce qui permet la clairvoyance de l’intelligence, car elle guérit la raison de son aveuglement. La foi donne des yeux à l’intelligence : « La lumière de la grâce tombant sur un indice aux yeux de la raison naturelle, qui n’est que probable, en fait un instrument d’assentiment certain. » La difficulté est que Rousselot pensait que Newman lui avait suggéré une solution à laquelle il n’était pas parvenu lui-même. Ce que conteste Nédoncelle qui allègue d’autres textes comme celui-ci proprement indiscutable : « Vous demandez ce qu’il vous faut, en plus des yeux, pour voir les vérités de la Révélation. Je vais vous le dire. Il vous faut la lumière. Les yeux les plus pénétrants ne peuvent voir dans l’obscurité. Votre esprit, c’est l’œil, la grâce de Dieu, c’est la lumière… Vous voyez donc ce que peut faire l’homme selon la nature : il peut sentir, il peut imaginer, il peut inférer ; de toutes les façons, il lui est loisible d’avancer et de recevoir, totalement ou en partie, la vérité catholique. Mais il ne peut pas voir, il ne peut pas aimer. »
Tout cela peut paraître un peu subtil. Et on n’est certes pas obligé de rentrer dans ces problématiques pour être un bon chrétien. Mais une récente conversation avec des interlocuteurs traditionalistes, qui m’ont proposé de la prolonger pour approfondir la pensée du Père de Lubac sur le Surnaturel, m’incite à reprendre les choses très sérieusement.
Il m’est arrivé, dans les pages précédentes, d’évoquer l’opposition faite couramment entre la justice et la charité ainsi que l’immense question de la satisfaction. Philosophiquement et théologiquement, elles sont en tension difficile et nécessaire. J’en trouve plus que l’écho dans ces Sermons universitaires, singulièrement le sermon VI, intitulé « De la justice comme principe du gouvernement divin ». Il nous est beaucoup moins commun de considérer la justice comme une exigence inflexible de Dieu. C’est à nous, individuellement, qu’il doit être rendu justice à titre d’ayant-droit non moins inflexibles. Lorsqu’il s’agit de la justice des tribunaux, la réquisition peut être néanmoins terrible, vindicative, réparatrice, impitoyable, et il y a des motifs sérieux pour le justifier. La conscience morale retrouve alors sa centralité. Et il faut être profondément chrétien pour oser parler de pardon lorsque c’est votre enfant qui a été atrocement assassiné.
Newman ne veut rien perdre de la justice, mais la miséricorde s’impose avec la rédemption – un acte irréversible – un événement de l’histoire. Dans une note, Nédoncelle rappelle que le philosophe républicain Charles Renouvier tenait la justice pour supérieure à l’amour, car rationnellement plus déterminable et plus encore avec la constitution d’agents libres et responsables. Newman ne le contredit nullement sur ce motif ; il n’en affirme pas moins une sorte de dépassement supérieur, conforme à l’être-amour divin. Cela rappelle sainte Thérèse de Lisieux si bien actualisée par le Père Bernard Bro.
15 AVRIL
Précisément, j’ai été appelé hier soir à participer à une veillée pour la Miséricorde organisée à l’Eglise Saint-Sulpice. Assez intimidé d’intervenir ainsi, j’avais réfléchi au sujet en revenant à l’enseignement de Jean-Paul II et en consultant les Paraboles du Père Bro qui sont toujours à portée de main depuis que les quatre volumes ont paru (Cerf-Edifa-Mame), mais je n’ai pu développer ce que j’avais entrevu et qui aurait demandé trop de temps. J’ai surtout parlé de Jean-Paul II et de sa prédilection pour le Dieu riche en miséricorde. Le mieux était de s’effacer vite pour l’adoration de la nuit.
(à suivre)