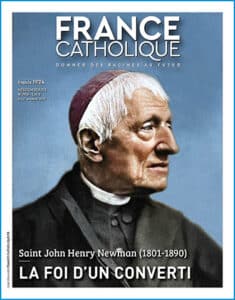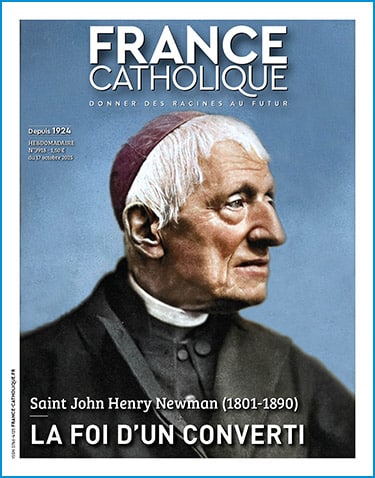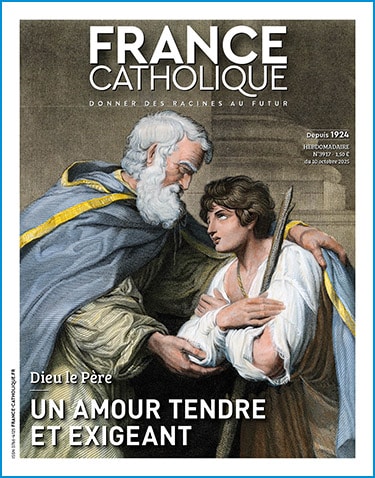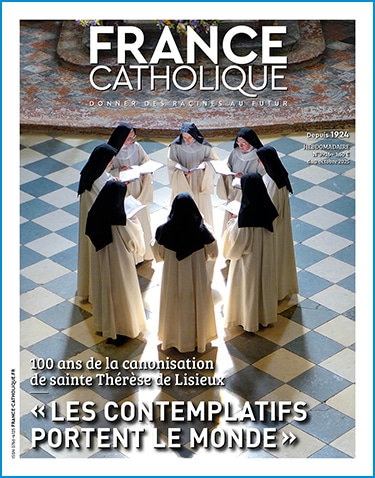25 novembre
Je ne voudrais pas qu’on pense que je veuille régler un compte quelconque avec Emmanuel Mounier. C’est quelqu’un dont je me sens souvent proche et dans bien des domaines. S’il est arrivé au fondateur d’Esprit de se tromper, c’est pour avoir eu le cran de s’engager, en affrontant les difficultés de son temps. Au fond, il dessine la figure de l’intellectuel chrétien dont je regrette aujourd’hui souvent l’absence. J’ai aussi suffisamment connu Jean-Marie Domenach pour savoir avec quelle lucidité, l’école de Chatenay-Malabry a su opérer parfois ses autocritiques. Je reste à ce propos très impressionné, presque assommé, par une conférence donnée par le successeur de Mounier dans le cadre d’un club que dirige le sociologue Jean-Pierre Le Goff. Il faut avoir un sacré courage pour se mettre en cause d’une façon si rude !
Je me souviens d’un échange avec Domenach sur un essai de Tony Judt plutôt féroce pour Mounier. Il m’avait donné des éléments d’information qui corrigeaient la thèse de l’historien, très unilatéral dans son réquisitoire. Cela m’avait éclairé. N’empêche que les blessures continuaient à brûler à propos de ce que Michel Winock a appelé la période philo-communiste d’Esprit. Pour ma part, je n’ai ni le goût ni le loisir des polémiques rétrospectives. Et mon rapport avec Mounier et sa postérité se pose d’abord en termes de proximité et de dialogue.
28 NOVEMBRE
Croisement des lectures. Je m’intéressais donc à l’histoire du christianisme, à la chrétienté toujours problématique, quand je me suis mis à lire le dernier ouvrage de Marie-François Baslez, dont j’avais tant apprécié le Saint Paul (réédité chez Fayard). Historienne rigoureuse, cette spécialiste des origines chrétiennes n’est pas préoccupée d’enjeux idéologiques ; Dans Comment notre monde est devenu chrétien (CLD-éditions), elle s’attache à reconstituer les faits, à ordonner les évolutions, à se poser des problèmes qui permettent souvent de reprendre autrement certains débats contemporains, tel celui des racines chrétiennes de l’Europe, tel le rapport de l’Église et de l’État, ou encore la connivence du christianisme avec la liberté religieuse. La mutation chrétienne de l’Empire romain doit être perçue dans sa complexité. Par exemple, elle suppose, de la part de ceux qui se convertissent, une adhésion personnelle et non plus cette appartenance de naissance qui caractérisait les religions traditionnelles.
Il est un peu étrange de comparer la revendication à la liberté religieuse d’un Tertullien et d’un Lactance aux oppositions résolues des papes du XIXe siècle à cette notion. Il est vrai que le climat intellectuel et les circonstances différaient, et que ce qui était reçu ici comme une exigence morale et spirituelle, était conçu là comme une menace pour la foi. Mais, tout de même, la menace relativiste et le danger non imaginaire d’éradication des convictions pouvaient-ils faire oublier l’exigence originaire et universaliste qui a fait bouger le droit romain, en y faisant reconnaître la spécificité du « croire » ? A contrario, Marie-Françoise Baslez rappelle qu’il y a dans l’édit de Milan, qui lève l’interdit sur le christianisme, un réel relativisme religieux. Ce n’est que plus tard, avec Constance, que le paganisme sera interdit et que la religion nouvelle deviendra l’officielle.
Tout autant que les moines du Moyen Âge, les premières générations chrétiennes n’ont eu nullement l’intention d’inventer une nouvelle culture ou de bâtir une nouvelle civilisation, ne serait-ce qu’en investissant les milieux dirigeants. N’empêche qu’ils se sont conduits de telle sorte qu’ils ont abouti à l’une et l’autre. Marie-France Baslez note qu’ils n’avaient pas de volonté de rupture, et que, persécutés, ils n’entendaient pas porter atteinte à la légitimité de l’Empire. C’est une des raisons pour lesquelles, il y eut l’entreprise de Constantin : « L’empereur Constantin a transféré sur le christianisme la quête d’une légitimité sacralisante, que menaient ses prédécesseurs depuis plus d’un siècle pour affirmer le caractère divin du pouvoir : l’idée s’était déjà imposée que l’Empereur était désigné par la divinité qui lui léguait son pouvoir. De leur côté, les chrétiens, affirmaient, avec Paul, que l’autorité publique était légitime, car établie par Dieu : c’est peut-être en fonction de cette théologie politique que Constantin, unique détenteur depuis 324 de l’autorité légitime et de la puissance publique, se sentit autorisé et à présider le concile. L’Empereur est reconnu par les intellectuels chrétiens comme « égal aux apôtres », formule de sacralisation charismatique, certes, mais qui marque aussi des limites et des bornes aux prétentions impériales. »
Il y a donc une très délicate confrontation, une mise au point difficile, avec le risque du césaropapisme et la confusion des ordres. Cependant, il s’agit bien d’une étape importante et décisive pour le christianisme, celle de l’accession aux responsabilités publiques. Je sais que l’ère constantitienne continue à avoir fort mauvaise réputation, moins sans doute qu’aux alentours de Vatican II où un Yves Congar contribuait à répandre l’idée que cela avait été une vraie catastrophe pour l’Église, qui ne s’en remettrait qu’en redevenant « servante et pauvre ». J’ai toujours résisté à ce réquisitoire, car la logique d’incarnation chrétienne exigeait cet investissement dans le temporel, avec tous les risques que cela comportait. Mais éviter l’épreuve, c’était manquer à sa vocation historique, voire sacramentelle. Se vouloir minoritaire ou en contre-société à perpétuité, c’est manquer du courage de la « consecratio mundi ». Certes, cette consécration ne devait pas de faire à n’importe quel prix, et la leçon de l’Ancien Testament dénonçant les dangers d’une monarchie en Israël ne pouvait être oubliée. Mais Françoise Baslez le rappelle aussi : « Dans la tradition biblique, le roi n’est pas dieu, mais l’instrument de Dieu ; il a des comptes à rendre à Dieu, ce que lui rappellent les prophètes et ne saurait prétendre à l’absolutisme ». Mais il a aussi une mission incontestable : « Le pouvoir est légitime par les vertus et la religion de celui qui l’exerce et le principe d’imitation du Christ, qui régit la vie de tout chrétien, est étendu au souverain. »
Mais il est vrai aussi que l’Histoire s’avance avec ses figures contingentes qui se succèdent. De ce point de vue, Mounier ne se trompait pas, même s’il est toujours difficile de s’y reconnaître dans une marche des choses qui ne vérifie pas nécessairement les prévisions.
2 DÉCEMBRE
Décidément, la philosophie politique ne me quitte pas. Elle m’a occupé cet été. Elle me rattrape du fait de l’actualité et des livres qui paraissent. Je me prête d’autant mieux à cette sollicitation qu’elle correspond à une interrogation qui n’a pas cessé depuis mes lectures de jeunesse, avec des questions toujours reprises, toujours en attente. On célèbre, par exemple, le soixantième anniversaire des droits de l’homme (1948). Deux Français célèbres furent associés à la rédaction de ce texte : René Cassin et Jacques Maritain. Ces deux seuls noms ne sont-ils pas symboliques d’une sorte d’unanimité morale, celle d’une humanité se rassemblant sur des conviction et des commandements pratiques, aux lendemains de l’épouvantable cataclysme de la Seconde guerre mondiale ? Ainsi, les désaccords philosophiques et religieux du siècle précédent auraient-ils été soldés et les affrontements entre l’Église et l’individualisme libéral auraient-ils été dépassés par la perspective d’un service commun en faveur des valeurs universelles. C’est une interprétation tout à fait plausible. Et elle correspond à ce que Maritain a pu écrire sur le moment. D’une certaine façon, cet unanimisme subsiste avec un langage commun, puisqu’il a été adopté par Jean-Paul II. Cela peut en agacer plus d’un. Tel mon ami Éric Zemmour, farouche contempteur du droit-de-l’hommisme, c’est-à-dire d’une bien-pensance démentie par le monde tel qu’il va. Bernard Kouchner, notre ministre des Affaires étrangères, n’est-il pas contraint, dès lors qu’il est investi de responsabilités directes, d’en rabattre sur son idéalisme humanitaire ? Mais la contestation s’approfondit avec un Alain Finkielkraut s’indignant des revendications perpétuelles d’individus ne cessant de réclamer de nouveaux droits.
Par ailleurs, il ne faut pas creuser longtemps pour s’apercevoir que cet unanimisme est fondé sur des malentendus et masque des désaccords philosophiques radicaux. Jacques Maritain en était conscient dès 1948 et insistait sur le caractère pratique de la Déclaration. Il acquiesçait par avance à la théorie de John Rawls sur un accord par recoupement, c’est-à-dire un accord-compromis entre des convictions très différentes de systèmes philosophiques parfois diamètralement opposés. Mais de sérieuses objections se formulent dès lors que l’opposition de ces systèmes s’approfondit au point d’être sans fond. Et l’on s’interroge sur l’effort du même Maritain pour trouver la formule d’un nouvel humanisme intégral qui prendrait pleinement en compte le mouvement de la modernité. Sans doute se justifiait-il par le refus d’un manichéisme maladif, dont il soulignait les dommages encore dans Le Paysan de la Garonne. Mais comment échapper à une contradiction aussi déterminante que celle qui oppose sa philosophie politique à l’ensemble de la philosophie politique moderne ? Quelles que soient ses tentatives pour réconcilier la liberté moderne avec une vision théologique et la morale telle que l’entend un disciple de saint Thomas, il faut bien constater un échec sanglant. Comment Maritain aurait-il pu nier cet échec, lui qui donnait une si grande importance à la recherche spéculative de la vérité : « Plus nous fraternisons dans l’ordre des principes pratiques et de l’action à conduire en commun, plus nous devons durcir les arêtes des convictions qui nous opposent les uns aux autres dans l’ordre spéculatif et sur le plan de la vérité première servie ».
Réfléchissant à tout cela, je suis tombé sur les fortes pages que Pierre Manent a consacrées aux antinomies de la philosophie politique et du christianisme et j’y ai discerné tout de suite l’explication de l’impossibilité pour Jacques Maritain de trouver une sortie à ses antinomies. Pierre Manent a le mérite de ramener le débat à des propositions rigoureuses devant lesquelles la fuite n’est pas possible. Exemple : « L’homme des Lumières implique, ou présuppose, qu’il n’y a pas de Dieu, ou que Dieu se désintéresse des hommes, puisqu’il rejette ou tout au plus considère comme facultative, privée, l’obéissance à la loi de Dieu. On pourrait dire encore, s’il y a un Dieu, la volonté humaine ne saurait être autonome, ou « souveraine » affirmer cette autonomie ou cette « souveraineté » c’est nier l’existence de Dieu ».
Autre proposition : « L’histoire de la philosophie moderne, de Machiavel à Nietzsche apparaît comme orientée et animée par l’élaboration du concept de volonté. Ensuite, le cœur intellectuel de la démocratie moderne est constitué par la notion de volonté rationnelle, mise au point, au centre de cette histoire, par Rousseau, Kant et Hegel. » Le point d’aboutissement de cette logique de la toute puissance de la volonté consiste en une « polémique débondée contre le christianisme » Conclusion : « Il est difficile de trouver dans l’histoire humaine, réseau symptomatique plus serré ».
Pierre Manent, pour montrer la nouveauté explosive de cette liberté souveraine la met en tension avec l’analyse aristotélicienne du Politique. Celle que l’Église reconnaissait si aisément à la suite de saint Thomas et à laquelle on comprend que Maritain se soit quasiment identifié. Mais Aristote ne vaut plus, en dépit de son incomparable intelligence de la vie de la cité, depuis que la volonté souveraine commande l’ensemble du dispositif social.
Or je constate qu’en dépit du désir de Maritain d’intégrer complètement l’homme moderne dans l’organisation nouvelle de la cité, sa philosophie lui interdit de soustraire la volonté au bien qui la justifie et la mesure. En dépit de son évolution manifeste, il n’a jamais renié la critique de Rousseau qu’il avait développée dans Trois réformateurs, et ses derniers travaux confirment sa condamnation définitive de la notion de souveraineté dont il découvre l’origine chez Bodin. Son opposition à la volonté moderne est donc frontale, absolue, non susceptible d’être amodiée. Ou alors, elle composera non pas spéculativement, mais pragmatiquement, pour tenter de définir les conditions minimales d’un vivre ensemble. Peut-être trouvera-t-elle quelque argument du côté des libéraux soucieux de brider la violence de la volonté souveraine, en alléguant avec Benjamin Constant : « Il y a des masses trop pesantes pour la main des hommes » ? Mais il est à jamais impossible de le ranger dans le camp libéral, sa pensée étant incompatible avec un cadre conceptuel si contraire.
J’ajoute qu’il n’était pas raisonnable avant-guerre, de le ranger dans le camp révolutionnaire philocommuniste. Louis Salleron, qui s’y risqua, n’avait guère que quelques affirmations isolées d’Humanisme intégral pour fonder une opinion si fragile. Sans doute la tentation communiste s’insinuera très fort dans le monde catholique, surtout après la guerre, mais il me paraît incongru d’en attribuer la responsabilité à Maritain. Pour conclure provisoirement ce chapitre, je m’interroge sur le jugement que le philosophe thomiste aurait porté à propos de la conclusion tirée par Pierre Manent du long bras de fer entre l’État libéral et l’Église : « En affirmant sa souveraineté indéterminée sur elle-même, l’humanité démocratique déclare en somme qu’elle se veut mais qu’elle s’ignore. » D’où ce partage étrange mais conséquent : « A la démocratie, la souveraineté politique et l’impuissance dialectique ; à l’Église la soumission politique et l’avantage dialectique. La relation qui enclencha le mouvement des Lumières est aujourd’hui en somme inversée. Nul ne sait ce qui produira quand la démocratie et l’Église s’en apercevront. » (Pierre Manent, Enquête sur la démocratie, Tel-Gallimard).