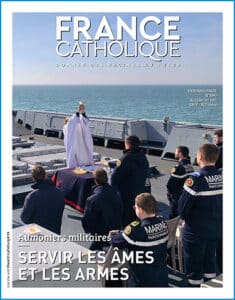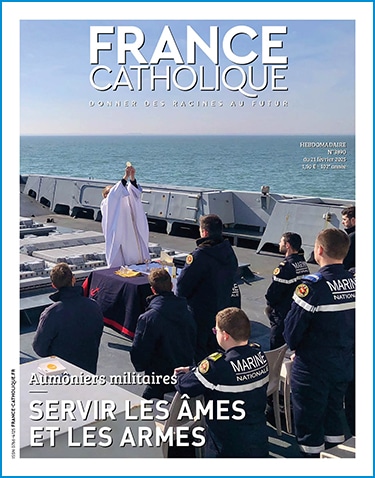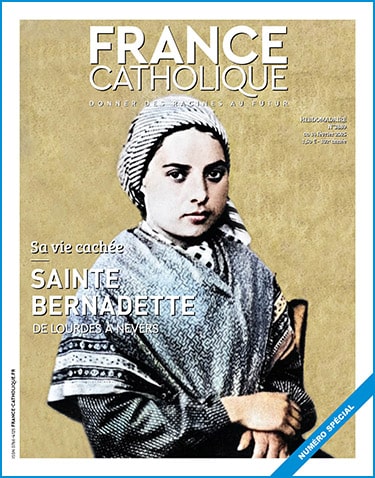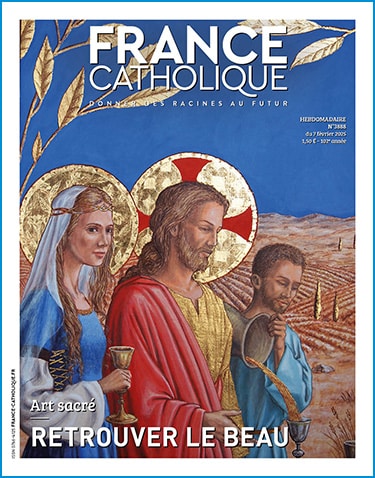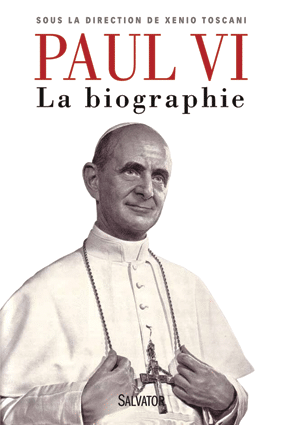Il y a cinquante ans, le 8 décembre 1965, le bienheureux pape Paul VI clôturait le second concile du Vatican, au terme de sa quatrième session. Cet événement mémorable de l’histoire de l’Église au XXe siècle ne fut rendu possible qu’en raison de l’engagement total de ce pape, qui n’en avait pas pris l’initiative — elle revient à son prédécesseur, saint Jean XXIII — mais qui le mena à terme, en dépit de bien des difficultés, après en avoir précisé les finalités et les contenus. Un demi-siècle plus tard, le souvenir de Jean-Baptiste Montini s’est un peu estompé dans la conscience des nouvelles générations, qui sont nées et ont vécu sous le pontificat extraordinaire de saint Jean-Paul II. Mais pour comprendre l’action et les initiatives du pape polonais, qui participa lui-même activement au concile, il est indispensable de se référer à l’action de son prédécesseur, sans laquelle la plupart des initiatives des décennies suivantes n’auraient pu se concevoir.
Paul VI, dit-on, a fait entrer l’Église catholique dans la modernité. Il s’agit de bien saisir le sens de cette formule. Elle n’est compréhensible que par l’existence d’un homme qui a traversé les deux tiers du XXe siècle, en affrontant une série de défis : défis doctrinaux et intellectuels avec l’effort de développement nécessaire de la pensée chrétienne au-delà de la crise moderniste ; défis politiques caractérisés par l’affrontement avec les régimes totalitaires et puis les mutations de l’après-guerre auxquelles l’Église s’est associée ; défis civilisationnels avec l’avènement d’un monde globalisé, à la suite de l’émergence des continents appelés à sortir de leur sous-développement.
Si Paul VI a été capable de mettre l’Église en phase avec ces évolutions, c’est qu’il s’y était préparé dès ses années de jeunesse, à l’orée du siècle, en associant son intense vocation spirituelle et son engagement ecclésial au plus vif intérêt pour les enjeux culturels, sociaux et politiques de son époque. Il avait aussi été formé aux responsabilités suprêmes, par ses fonctions d’aumônier de la jeunesse catholique étudiante italienne et son parcours dans l’administration du Saint-Siège où il accèdera aux premiers rangs. C’est tout l’intérêt de la grande biographie, parue l’an dernier en Italie, et disponible désormais en français grâce aux éditions Salvator, de nous faire accéder à l’intelligence d’un pontificat qui a inauguré une nouvelle ère de l’histoire du christianisme.
C’est Jean XXIII qui a voulu le concile Vatican II, qui l’a réuni et qui a présidé sa première session. Mais c’est Paul VI qui a supporté la charge principale de son déroulement, de son développement doctrinal, de ses conclusions et de ses implications. Ainsi peut-on l’appeler sans crainte le pape de Vatican II, car il en aura porté le projet, qu’il a précisé dans ses articulations fondamentales et dont il a dirigé l’exécution avec une extrême maîtrise, sachant garder son rôle de gardien de l’unité, en respectant les diverses sensibilités et sans jamais perdre de vue l’objectif essentiel. C’est sans doute le mérite principal d’une biographie rédigée par les plus éminents universitaires, spécialistes de la vie et de l’œuvre de Jean-Baptiste Montini, que de nous montrer comment le futur pape a été préparé à cet immense labeur du concile, autant par ses origines, sa formation, son ministère auprès de la jeunesse étudiante italienne que par ses fonctions curiales de plus en plus importantes auprès de Pie XI et de Pie XII. Sans compter son épiscopat à Milan.
Dès que Jean XXIII annonce la convocation de Vatican II, le cardinal Montini est immédiatement au diapason de l’événement, comme s’il l’avait anticipé et médité depuis toujours. Du siège de saint Ambroise et de saint Charles Borromée, il peut expliquer, avant même que le concile ait commencé, en quoi il consistera, parce qu’il a dans la tête et dans le cœur toute la tradition conciliaire de l’Église et parce qu’il a réfléchi sur ce que pourrait être, dans les circonstances historiques du XXe siècle, le contenu de ses travaux. Il énumère précisément les principaux chapitres du corpus conciliaire alors que les énigmes de l’orientation initiale de Vatican II ne sont pas encore dénouées : « Le complément désiré de la doctrine de l’Église en ce qui concerne l’épiscopat, la position des laïcs, la question très difficile et compliquée de la recomposition de l’unité de l’Église, la puissante tentative de dialogue avec le monde moderne. » Il ne faut toutefois pas se tromper de genre. Une assemblée œcuménique n’est pas un congrès politique, même au sens large du terme. C’est une forme du magistère suprême, présidée par le Pape, et qui répond à la nature du mystère de l’Église. Aussi bien convient-il de se garder des illusions. L’assemblée ne décrétera pas « de réformes radicales et renversantes » elle ne sera pas « une panacée magique et immédiate ». Le cardinal Montini, s’il est un intellectuel raffiné, capable d’imaginer des mutations importantes, est en même temps un évêque responsable, qui connaît trop l’appareil ecclésial, de la base au sommet, pour se laisser aller à des projections utopiques. Il est aussi trop au fait des évolutions de la société pour ne pas mesurer les difficultés d’intégration du christianisme aujourd’hui. Jean XXIII, qui l’estimait beaucoup et avait de profonds liens d’amitié avec lui, le voyait comme une sorte d’Hamlet, le personnage shakespearien, toujours angoissé, dans le milieu ecclésial. L’expérience milanaise, où il a dispensé toute son énergie, l’a fait buter sur les limites des possibilités d’évangélisation au sein d’un monde qui s’éloigne de plus en plus de l’influence chrétienne. À un universitaire de ses proches, le professeur Vian, il a même confié qu’il était en état d’agonie, parce que dans une grande solitude, avec le sentiment qu’il manquait des moyens proportionnés à sa tâche. Non, Jean-Baptiste Montini n’est pas un optimiste, au sens où on reprochera à Vatican II de l’avoir été, dans une consonance teilhardienne.
Mais pour bien comprendre le personnage, il faut le resituer dans son époque. Jean-Baptiste Montini est né le 26 septembre 1897 à Concession, près de Brescia, en Lombardie. Charles de Gaulle est né sept ans auparavant, le futur cardinal de Lubac, l’année précédente. Il est donc son exact contemporain. Mais l’Italie n’est pas la France. Si l’épreuve de la Première Guerre mondiale frappera les deux pays, la péninsule italienne est marquée par les suites de l’unité réalisée en 1871 et de la rupture avec le Pape. Comment allier une profonde fidélité à l’Église à une entrée progressive et nécessaire dans les structures politiques du pays ? Ce sera l’horizon du père du futur pape, Giorgio Montini, avocat de profession, mais directeur de journal catholique et parlementaire par la suite. Il est le représentant typique d’un certain catholicisme social, aux initiatives foisonnantes. Le jeune Jean-Baptiste a donc été à bonne école, dès le plus jeune âge, et il se révèlera très précocement lui aussi un esprit en mouvement, plein de fougue, pénétré d’intelligence, de culture et de sagesse. Pourtant, atteint par la maladie, il aurait pu se retrancher de toute activité extérieure. Son tempérament, au contraire, le pousse sans cesse à l’engagement. Passionné par les débats métaphysiques essentiels, rien ne lui est étranger de la vie sociale et des enjeux politiques qui le passionnent.
Il ne faut donc pas s’étonner de son rapide accès aux responsabilités. Comme Xenio Toscani l’explique dans la première partie de la grande biographie
1, désormais accessible en français grâce aux éditions Salvator, ses supérieurs lui ont tout de suite reconnu « non seulement une intelligence aiguë, vertu “naturelle” mais aussi une formation intellectuelle importante et précoce et une spiritualité profonde, en même temps qu’une expérience peu commune de l’Église italienne et de son contexte politique (…) toute chose qui ne pouvait venir que de son éducation, des personnes et des milieux qu’il avait côtoyés, en un mot du “capital culturel et familial” de cet homme doté par la nature d’une intelligence et d’une capacité de travail hors du commun malgré une santé précaire. »
La vocation au sacerdoce, Jean-Baptiste la découvre comme naturellement, durant son adolescence, grâce au milieu qui la favorise, sa famille singulièrement mais encore tout l’entourage ecclésial de Brescia. La confiance de l’évêque lui permettra de suivre les cours, tout en étant dispensé d’habiter au séminaire. De Paul VI, on dira plus tard qu’il avait « une mauvaise santé de fer ». C’est dire que l’homme, toujours fragile, saura néanmoins surmonter ses handicaps, armé de sa volonté inflexible. On doit aussi retenir de cette période de formation la façon dont le jeune clerc va s’initier aux sciences religieuses. Il aurait pu subir certains effets déstabilisants de la crise moderniste, mais sans doute en raison de l’excellence des études et des maîtres du séminaire de Brescia, il franchira les obstacles intellectuels en choisissant les meilleures orientations, les plus fécondes, les moins susceptibles d’enfermer dans des impasses. Il sera toujours doué de cette faculté de discernement qui lui permettra d’être lui-même un éducateur de premier ordre, lorsqu’il sera en charge de la FUCI (Fédération Universitaire Catholique Italienne).
Xenio Toscani résume parfaitement ce qu’a été la décennie passée à la FUCI (1924-1933), en montrant qu’elle a été d’une importance capitale pour l’Église et pour le monde : « En collaboration avec un groupe de jeunes aux qualités exceptionnelles, qu’il sut animer et éduquer, son ministère transforma la FUCI en cette grande école de formation religieuse et intellectuelle qui allait façonner la meilleure part, et la plus dynamique de la classe dirigeante catholique du pays des années 1940-1970. » On retient évidemment le nom d’Aldo Moro, au sein de cette pléiade de futurs responsables de la Démocratie chrétienne, tant il résume la formation Montini et symbolise aussi le destin d’une génération… et d’un pontificat. Comment oublier que c’est Paul VI, qui célèbrera les obsèques de son ancien étudiant, assassiné par les Brigades rouges, à Saint-Jean-du-Latran. Ce fut le dernier acte significatif du Pape qui, à cette occasion, prononça une inoubliable prière dans une langue italienne d’un raffinement supérieur : « En cet instant, nos lèvres, fermées comme par un énorme obstacle, semblable à la grosse pierre roulée à l’entrée du sépulcre du Christ, veulent s’ouvrir pour exprimer le De profundis, c’est-à-dire le cri et la plainte de la douleur indicible de la tragédie récente, qui étouffe notre voix. Seigneur écoute-nous ! »
Mais de l’aube des années vingt aux années soixante-dix du XXe siècle, il y a le demi-siècle qui va permettre au jeune aumônier universitaire de franchir les degrés qui le mèneront au siège de Pierre et à ses années de pontificat (1963-1978). Parallèlement à la direction de la FUCI, il travaille à la Secrétairerie d’État, ce qui est pour lui inconfortable. Il aurait aimé être totalement libre pour son ministère. Mais il est très apprécié pour son travail de minutante, où déjà il côtoie les grandes figures du Saint-Siège, dont certaines l’accompagneront encore après son élection papale. C’est le cas du futur cardinal Ottaviani, préfet du Saint-Office au moment de son élection et durant le concile. Le chapitre consacré à cette période est particulièrement dense, bien qu’il ne livre pas toutes les clés qu’on aimerait y trouver. Mais c’est la position singulière de Montini qui explique certaines incertitudes. Collaborateur dévoué des grands responsables, il ne participe pas aux décisions fondamentales. Et puis c’est l’époque du fascisme en Italie. Mussolini a su habilement négocier le traité du Latran qui règle ce qu’on appelait la question romaine. Il obtient ainsi une sorte d’armistice avec l’Église catholique. Mais Montini sait bien qu’il s’agit d’une paix armée, lui dont les troupes étudiantes ont été sans cesse en proie à la violence fasciste. La prudence diplomatique commande, mais au fur et à mesure que la menace totalitaire monte en puissance, la position du Pape évolue vers un franc désaveu de l’idéologie du régime. Fulvio de Giorgi peint le tableau tout en nuance de situations équivoques. Ainsi à l’égard de la guerre d’Espagne et du franquisme, les positions, dit-il, sont aujourd’hui encore difficiles à déchiffrer. D’évidence, Montini penche pour une position médiane, en quoi il se distingue un peu de son cher Maritain, à qui il reproche de ne relever de crimes que du côté du franquisme.
Il y aura évidemment la période tragique de la Seconde Guerre mondiale, où Montini assiste Pie XII dans ses tâches les plus caritatives pour secourir toutes les détresses. Par la suite, il sera indigné par les accusations lancées contre le silence du pape Pacelli à propos de l’extermination du peuple juif. Il sait mieux que quiconque comment le Saint-Siège a protégé les juifs de Rome et a agi partout où cela lui était possible en Europe pour s’opposer à la monstruosité nazie. Mais ce n’est pas l’objet de cette biographie de reprendre le dossier de la guerre dans son ensemble. Il s’agit de suivre la progression de celui qui est devenu le plus proche collaborateur de Pie XII, parce que le Pape n’a cessé de se louer de ses services efficaces. Pourtant, il y aura rupture de cette collaboration en 1954, quand Mgr Montini sera envoyé à Milan, le plus grand diocèse d’Italie et même de la chrétienté. S’agit-il d’une promotion-sanction qui écarte provisoirement un papabile de la succession romaine, puisqu’il n’est pas procédé immédiatement, comme on pouvait s’y attendre, à une entrée au collège cardinalice ? Il est difficile de se faire une idée exacte des raisons du Pape. Montini a des adversaires à la Curie, qui ont probablement agi contre lui.
Ce qui est sûr en revanche, c’est que l’épiscopat milanais (1954-1963) sera d’une rare intensité. L’activité développée par l’archevêque est prodigieuse sur tous les terrains. Mgr Montini entend prendre à bras-le-corps la déchristianisation dans tous les milieux, aussi bien celui des dirigeants économiques que celui des travailleurs. Confronté à une migration considérable issue du sud de la péninsule, il se lance dans la construction de nouvelles églises. Il en fera bâtir 123 ! L’événement phare de cet épiscopat sera la mission extraordinaire qui aura lieu à Milan du 5 au 24 novembre 1957. 1288 prédicateurs y seront engagés. Jamais on ne vit dans l’histoire de l’Église une entreprise de cette nature !
C’est dire à quel point l’élection du cardinal Montini au siège de Rome en 1963, pour succéder à Jean XXIII, constitue le point d’arrivée d’une étonnante trajectoire. Les chapitres de la biographie qui concernent le pontificat, et qui sont dus à Ennio Apeciti, se rapportent sans doute à la période aujourd’hui la plus présente de notre histoire ecclésiale. Ils n’en sont pas moins très utiles pour distinguer une action personnelle d’un évêque de Rome, si bien préparé à sa mission. Nous nous inscrivons aujourd’hui encore dans la suite et dans l’héritage de celui qui est devenu, par la grâce du pape François, depuis le 19 octobre 2014, le bienheureux Paul VI. Nous ne pouvons qu’espérer une canonisation qui constituera pour la mémoire chrétienne le repère lumineux du pape de Vatican II.