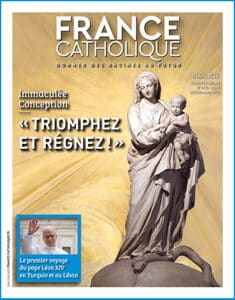On pourrait dire que le « constructivisme » réfute la démonstration ancienne du déni de la chair inhérent à une tradition qui, dès l’aube du christianisme, s’est signalée par la valorisation du « renoncement ». (Peter Brown, Le renoncement à la chair, Gallimard, 1995) C’est qu’entre-temps nous avons assisté à une mutation radicale de l’antichristianisme qui a modifié complètement l’arsenal de ses justifications et sa philosophie même. Cette métamorphose impose un surcroît de réflexion anthropologique, qui peut s’avérer d’ailleurs précieux, s’il permet de mieux comprendre la perception biblique de l’homme et de la femme, en évitant les pièges que l’adversaire vous tend, afin de caricaturer, par exemple, un « essentialisme » ou un « naturalisme » auxquels s’oppose une perception beaucoup plus fine de la réalité existentielle en cause.
Pour mémoire, on rappellera simplement qu’il y avait un énorme paradoxe à accuser le christianisme de mépriser le corps, parce que, précisément, il l’avait exalté avec la doctrine de l’Incarnation. Saint Jean dit bien : Et Verbum caro factum est : « Et le Verbe s’est fait chair ». Le réalisme de l’expression renvoie à toute la conception biblique qui ignore le dualisme de l’âme et du corps. Ce dualisme que l’on trouve dans l’hellénisme, singulièrement chez Platon, et qui resurgira plus tard avec Descartes au XVIIe siècle. Bien sûr, on a opposé à cela un certain puritanisme, voire un jansénisme qui ont incontestablement donné une orientation pessimiste à la sexualité et même à la condition corporelle. Ce sont, néanmoins, des déviations par rapport à l’inspiration axiale du christianisme. Lorsque je me suis intéressé à ce type de difficulté il y a une quinzaine d’années, j’ai pu citer l’opinion d’un Michel Foucault, peu suspect de complaisance à l’égard de la morale chrétienne, à propos de l’erreur fondamentale qui consiste à opposer pensée antique et pensée chrétienne en ce qui concerne la régulation des mœurs.
Ce qui me permet une précision bien utile. La réflexion théologique avec les conséquences morales, voire ascétiques qu’elle développe, a toujours été forcément en relation avec les philosophies et les sagesses qui lui étaient contemporaines. C’est ainsi qu’on a pu rapprocher les préceptes moraux du premier christianisme des conceptions développées par l’école stoïcienne. Ce n’est pas faux en soi. La pensée des Pères est imprégnée d’influences néo-platoniciennes et même aristotéliciennes. Il peut y avoir des affinités avec le stoïcisme. Et même plus encore. Comment s’en étonner, pour peu que l’on se souvienne que, dès le départ, les chrétiens se réclament d’une morale commune, justifiée par une raison droite et une connaissance approfondie de la nature humaine ? Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas une « différence » de sensibilité morale, en lien avec l’esprit évangélique et la loi de perfection qu’appelle la ressemblance divine. à certains égards, il est même possible que « l’éthos évangélique » produise une perception nouvelle, notamment du rapport à l’autre et de la distance éthique que requiert un respect supérieur. L’historien Paul Veyne a observé que la classe supérieure romaine, celle des milieux proches de l’autorité impériale, avait été attirée par le christianisme en vertu du raffinement moral qui était le sien.
On doit donc être particulièrement attentif à cette « différence chrétienne » et aux modifications qu’elle apporte dans les comportements, et aussi dans la perception de l’amour conjugal. J’ai noté que celui qui était encore l’abbé Joseph Ratzinger avait beaucoup insisté là-dessus, dans ses remarques sur la mise au point de la constitution Gaudium et Spes durant la dernière session du Concile. On doit se reporter à son livre écrit sur le moment, et où il a consigné ses impressions et ses réactions sur le cours des discussions auxquelles il assistait et souvent participait. Sur ce sujet précis, il écrit quatre pages très suggestives, qui pourraient être au départ d’un réexamen de toute la théologie morale, et qui pourraient éclairer les problèmes actuels, non sans recourir à une complexification salutaire (Joseph Ratzinger, Mon Concile Vatican II, Artèges, 2011).
Je citerai un paragraphe entier qui fait plus que suggérer la difficulté de l’entreprise : « Le Nouveau Testament ne contient pas de morale détaillée, mais juste une série d’impératifs concrets, ainsi qu’une orientation nouvelle et capitale qui découle de l’antithèse entre loi et grâce. À l’égard des préceptes, c’est-à-dire du contenu de la morale, il en reste à des allusions, et la dualité entre loi et grâce met davantage en évidence les limites d’une pure morale qu’elle ne sert de point de départ à une présentation d’ensemble de la morale. Cela pourrait bien être l’une des causes principale du fait de la cristallisation de la forme concrète du Nouveau Testament dans le christianisme des origines s’est inspirée largement des modèles contemporains de la pensée morale, et en particulier de l’éthique stoïcienne. » Il y aurait lieu de commenter chacune des phrases de cette sorte d’exposé préliminaire, destiné à souligner les difficultés propres à la perception chrétienne de la morale, qui ne se conçoit pas sans l’éclairage complet de la théologie et même de son histoire. La simple allusion à la dualité entre loi et grâce pourrait renvoyer à la tâche constante de la théologie à propos des relations entre la nature et la grâce. Relations conçues plutôt paisiblement dans la tradition thomiste, encore qu’il y ait un considérable espace de débat dans les textes de saint Thomas et les commentaires de ses disciples. Relations plus tourmentées chez saint Augustin, et qui deviennent carrément tragiques avec l’interprétation de Luther et de la Réforme.
Au minimum, on reconnaîtra qu’il y a des naturalia, des éléments naturels qui peuvent se traduire en propositions philosophiques (ou philosophèmes). Le théologien ou le moraliste pourront s’en saisir afin de donner une base concrète à des développements doctrinaux où la vocation humaine sera envisagée dans son ensemble et du point de vue de la sanctification et des fins dernières. Mais c’est encore plus compliqué que cela! La théologie n’est pas sans modifier la matière philosophique, à laquelle elle apporte une visée intérieure exigeante. Et dans le cas précis du mariage, force est de constater avec Joseph Ratzinger que les naturalia du stoïcisme sont complètement réinterprétés dans le sens d’un personnalisme qui met plus en évidence les dimensions de l’existence et de la liberté. Cela va à l’encontre d’un certain naturalisme fixé sur la seule perspective biologique et reproductrice de l’espèce. La norme morale se réduisait alors à l’action « selon la nature », formule insatisfaisante et piège dont il faut se sortir.
La rédaction que choisirent les concepteurs de Gaudium et Spes s’éloignait résolument du naturalisme stoïciste pour adopter la problématisation personnaliste. Mais celle-ci se devait de prendre garde, à son tour, de ne pas négliger la dimension sociale du mariage, que rappelaient alors fermement les évêques africains. C’est qu’entre naturalisme et individualisme, il y a tout l’espace où se déploient l’instance de la conscience, l’interpellation de la parole de Dieu et tout le discours d’une Église attentive à sa tradition et à son expérience. « Ce n’est pas la même chose de se demander si l’agir d’un individu correspond à la catégorie du naturel, ou bien s’il correspond à sa responsabilité devant les hommes avec lesquels la communauté matrimoniale entre en rapport, si elle se montre responsable face à la parole d’un Dieu personnel qui a donné comme modèle à l’amour des époux la perfection de son amour, perfection révélée dans celui du Christ pour l’Église (cf. éphésiens 5,25 33). ».
Dans la querelle actuelle à propos du gender, on peut aussi se rendre compte que la théologie ne saurait correspondre au naturalisme étroit qu’on lui reproche, pas plus d’ailleurs qu’au constructivisme débridé qu’on lui oppose. Mais ce pourrait bien être le signe de l’effort intense de problématisation anthropologique qui s’impose et qui trouve ses points d’appui dans un immense réservoir doctrinal, à commencer par la Bible, et à poursuivre dans le long et large fleuve de la littérature chrétienne. Sans compter que la confrontation avec tous les autres courants en philosophie et en sciences humaines peut se révéler extrêmement féconde.
Je me suis rendu compte que j’avais commencé le travail il y a une quinzaine d’années en rédigeant mon essai Pourquoi veut-on tuer l’Église ? (Fayard-Jubilé, 1996). C’est en prenant la mesure des objections que l’on avait adressées à l’encyclique de Jean-Paul II sur la morale (Veritatis Splendor, 1993), que je me suis avisé de l’urgence d’une investigation exhaustive qui prenait en compte toute la richesse de ce qu’on appelle communément « la nature humaine ». La réponse aux multiples objections et attaques — pas aimables du tout — qui pleuvaient sur le texte du pape exigeait une ouverture au contexte sans lequel il n’était pas vraiment intelligible. Aussi m’apparaissait-il que la plupart des contradicteurs ne savaient absolument rien du parcours propre à l’universitaire Karol Wojtyla, qui avait enseigné la théologie morale à l’université de Lublin après qu’il avait sérieusement confronté l’héritage de saint Thomas à la phénoménologie de ce disciple très particulier d’Husserl qu’était Max Scheler. À ignorer cela, lesdits contradicteurs se trouvaient dans l’incapacité de comprendre en quoi les prescriptions normatives ne s’imposaient pas comme des oukazes arbitraires mais s’expliquaient par le vœu profond d’une humanité en attente de son accomplissement intégral.
Mais qu’est-ce que cette humanité qui nous constitue, comment peut-elle se définir ? C’est là que nous retrouvons la querelle dont nous sommes partis. Le naturalisme dont le christianisme est accusé se rapporte à notre constitution biologique, et plus exactement au corps sexué qui nous échoit et dont la notion est qualitativement supérieure à toute définition scientifique, que ce soit par la génétique ou par l’anatomie. « Le corps humain est une pensée plus surprenante que l’âme de naguère », disait Nietzsche. Il est plusieurs façons d’en rendre compte, la première étant peut-être celle de la poésie parce qu’elle correspond à notre perception spontanée, qui a peu à voir avec une description physiologique. Ce que nous percevons est une forme en mouvement, une silhouette qui se déplace dans l’espace, avec grâce ou maladresse. Le corps est une présence habitée. Lisez à ce propos Alexis Jenni, le dernier Goncourt ; ses évocations valent parfois plus que la meilleure description phénoménologique : « Il convient par politesse de préférer l’être à la forme, mais l’être ne se voit pas, sinon par le corps. Son corps me réjouissait l’âme par voie anagogique et je désirais ardemment la peindre, car ce serait la montrer, la désigner, affirmer sa présence et ainsi la rejoindre » (L’art français de la guerre, Gallimard, 2011). Je n’insiste pas plus sur cette première esquisse.
Je retrouverai la phénoménologie, dont je ne médis pas, pour compléter la perception poétique car, avec Michel Henry, il me semble qu’il y aurait un intérêt majeur à se mettre à l’école de cette phénoménologie de la chair pour rendre à celle-ci sa dignité ontologique et son véritable statut. Les réquisitoires contre le naturalisme biologique se heurtent, en effet, à cette éminente dignité, à ce caractère personnel, à cette qualité de sujet qui nous éloignent de l’objectivité brutale d’une extériorité physique qui soumettrait notre liberté et notre affectivité. Refuser notre corps sexué, ce n’est pas refuser une détermination physique imposée par une nature impérieuse ou tyrannique, c’est se refuser soi-même dans son incarnation personnelle. Ce serait donc un déni de soi-même dont les conséquences s’avèrent ruineuses et suicidaires. La haine du corps conduit à sa réduction à un artefact dont on peut user à volonté. C’est dans cette ligne que se détache le mythe du cyborg. C’est-à-dire d’un être de plus en plus artificialisé.
Je me souviens avoir écrit un article où j’opposais la pensée de Michel Henry à la barbarie biologique manipulatrice. Il m’avait envoyé un mot de remerciement, où il paraissait toutefois étonné de ce rapprochement qu’il n’avait pas envisagé spontanément. Pourtant, c’était bien dans la ligne de ce qu’il avait lui-même dénoncé dans son bref essai La barbarie. Il est vrai qu’alors, il envisageait plutôt les dégâts dans l’ordre de la culture et celui des arts. Mais c’est bien aujourd’hui cette chair qu’il a magnifiquement mise en évidence qui se trouve en péril extrême.
Je pourrais prolonger cet aperçu philosophique par d’autres incursions. Ainsi, me suis-je laissé aller à relire Pierre Boutang sur La Fontaine et Descartes, Vico et Bossuet, et j’aurais pu en tirer un développement sur les dommages causés par « ce mortel dont on eût fait un Dieu chez les païens ». Mais j’y renonce, cela entraînerait trop loin au risque de faire perdre, un peu, le but de ma démarche. J’en retiens pourtant l’unité plénière de l’homme dans une constitution dont il ne faut rien retrancher et dont il faut se garder de séparer le corps, l’âme et l’esprit, qui « fonctionnent » ensemble. Tout schisme anthropologique se paiera d’une désintégration à l’infini.
Je n’en poursuis pas moins mon chemin, en reprenant la question de la différence sexuelle. Celle-ci est bien inscrite dans la chair, mais elle ne s’offre pas comme une simple détermination biologique. Elle perdrait sa signification et sa saveur à s’enfermer dans un naturalisme qui la priverait de son caractère proprement humain, celui qui s’intègre à l’existence et à la liberté de la personne. S’engager dans cette direction, c’est refuser de se laisser enfermer dans le dilemme ruineux qui oppose naturalisme à constructivisme, même s’il y a une vérité dans chacun de ces termes. La vérité du naturalisme, c’est que nous recevons de naissance un corps sexué, masculin ou féminin. C’est une donnée manifeste, incontournable, inexpugnable. La vérité du constructivisme, c’est que nous nous construisons nous-mêmes, nous élaborons notre personnalité à travers le temps, responsables que nous sommes de la conduite de nos vies. Cela implique la façon dont nous habitons notre corps ou vivons en notre chair. L’opposition frontale du donné et du construit peut avoir quelques avantages spéculatifs, mais sa radicalisation conduit à l’impasse et surtout à l’erreur sur nous-mêmes. Si l’on observe phénoménologiquement notre mode d’existence proprement humaine, on s’aperçoit que nous ne sommes ni fixés dans une « nature », ni détachés de notre incarnation par notre liberté. L’existence réfléchie et libre suppose d’assumer cette incarnation qui n’est ni tyrannique, ni arbitraire, afin qu’elle serve à l’accomplissement plénier de la personne. De ce point de vue, nous retrouvons la différence personnaliste du christianisme, rappelée par Joseph Ratzinger, qui oblige à prendre ses distances avec le physicisme stoïcien.
Je retrouve là les quelques lignes anthropologiques que j’avais esquissées dans un chapitre de Pourquoi veut-on tuer l’Église ? Je m’étais efforcé de montrer que l’obstination de Sartre et de Beauvoir à opposer le « pour soi » et « l’en soi » aboutissait à une véritable phobie de l’incarnation biologique, très sensible dans Le deuxième sexe, avec l’aveu d’une répulsion à l’égard de la féminité et de la maternité. Déjà, en réaction contre cette phobie, une tendance, naturaliste sans complexes se dessinait, par exemple du côté de l’écologie profonde, avec l’exaltation d’une nature féminine plus proche de la nature maternante et en opposition avec une virilité prédatrice de cette même nature. J’avais creusé plus encore cette thématique dans L’amour en morceaux ? En opposant à Sartre et Beauvoir la philosophie de leur ancien complice, Maurice Merleau-Ponty. « L’existence n’est jamais nue » affirmait l’auteur de Phénoménologie de la perception, qui rétablissait ainsi l’intégrité de la personne, corps et âme.
C’est donc bien l’exigence anthropologique qui conduit à récuser l’opposition arbitraire de l’incarnation et de la liberté. Il y a une structure métaphysique du corps, disait encore Merleau-Ponty, qui le constitue à la fois « objet pour autrui et sujet pour moi ». Oui, mais il faut aller plus loin encore, en découvrant que l’extériorité du corps d’autrui est aussi un piège. On ne peut abstraire l’expression du corps de sa signification éthique, qui résulte à la fois du sens qu’il recèle au-delà de la biologie et de « l’injonction » qu’il manifeste de la part d’autrui (Lévinas).
On perçoit peut-être à quel point l’incarnation humaine se distingue profondément du code biologique animal. Cette distinction ne doit pas aboutir à éluder la corporéité, à la manière d’un Jean-Jacques Rousseau dans un texte souvent commenté par Luc Ferry. La différence ontologique entre l’homme et l’animal est sans aucun doute manifeste dans le fait que le premier n’est pas conduit par l’instinct comme l’est le second. Et il y a plus que de l’équivoque à utiliser, même de manière analogique, le terme de nature à propos de l’un et de l’autre. Non, l’homme n’accomplit pas sa nature comme l’animal accomplit la sienne. Toujours l’équivoque stoïcienne !
Pour autant, il est absurde de ne pas envisager l’incarnation comme une dimension fondamentale de l’existence humaine et essentielle à l’exercice d’une liberté réfléchie. Ce n’est pas vrai qu’on peut faire n’importe quoi avec son corps. Un corps qui est non seulement « une pensée surprenante » mais un complexe d’exigences éthiques particulières. Il y a là la matière de tout un traité philosophique qui met en cause le système kantien avec le rapport au sensible. La philosophie du corps de Claude Bruaire (Le Seuil) est-elle encore disponible ? C’est, en tout cas, un essai que je recommande à ceux qui veulent approfondir cet aspect du problème. Il n’est pas possible pour l’homme de penser sans son corps et le langage lui-même est le signe du lien irrécusable de l’intelligible et du sensible.
Il est une autre approche métaphysique du problème, qui renvoie à saint Thomas d’Aquin. Sartre, en effet, n’est pas le premier à avoir décrété la primauté de l’existence par rapport à l’essence. Oui, le propre de l’homme c’est sa liberté qui prend, en quelque sorte, possession de sa « nature » pour la surdéterminer. Nous ne sommes pas des êtres naturels, nous naissons à notre propre existence grâce à la liberté. Dans cette perspective, nous sommes des personnes, des sujets que la nature n’a pas faits et qui n’en sont même pas des émergences. Je ne puis que reprendre ici ce que j’exprimais déjà il y a quinze ans : « C’est parce que l’homme convoque sa masculinité qui fait sens pour lui, et que la femme convoque sa féminité qui fait sens pour elle, que l’un et l’autre peuvent dire Je et Toi dans une relation d’intimité et d’amour. Saint Thomas explique quelque part dans la Somme théologique que, si la femme a été tirée de la côte de l’homme c’est parce que Dieu a voulu la faire surgir de l’intimité même, là où le corps du Christ a été percé par la lance du soldat et où a jailli la source d’eau vive et de salut. Dès le départ, la relation de l’homme et de la femme est une relation éthique. Et si celle-ci se formule dans le langage des corps, c’est que ceux-ci constituent la médiation nécessaire et non insupportable de l’échange. »
Encore une fois, la primauté de la liberté n’implique pas le rejet de l’incarnation du sujet, et son assomption qui s’accomplit à travers une maturation psychologique et physique. C’est la vérité pervertie d’un constructivisme qui a bien raison d’affirmer que l’homme se construit. Mais il ne peut le faire qu’en assumant sa propre constitution et non en adoptant à son égard une sorte de rejet névrotique extrêmement dommageable. C’est vrai qu’il y a un véritable travail à accomplir sur soi-même pour parvenir à cette maturité qui est une sorte de conquête de soi. On le voit bien avec l’indétermination relative de l’adolescence qui est le moment clé de l’appropriation de l’identité sexuelle. Bien sûr, le langage de la philosophie ne saurait à lui seul circonscrire la difficulté et la complexité de cette démarche où se déploie la liberté. Mais on pressent à quel point elle peut s’enrichir en se gardant en même temps de la phobie de soi-même et d’une contrainte résignée. La phobie pourrait bien correspondre à l’attitude constructiviste qui se distingue par son refus de la corporéité. La résignation se rapporterait plutôt à un naturalisme incapable d’accéder à l’aventure d’une existence libre et réfléchie.