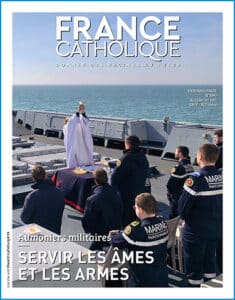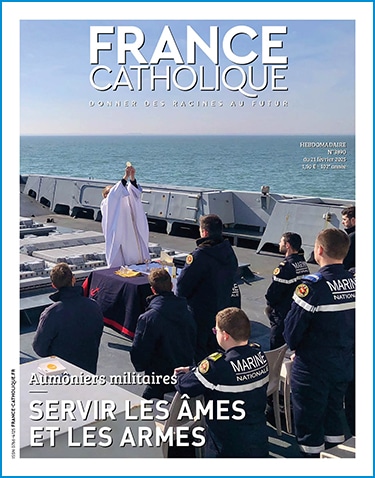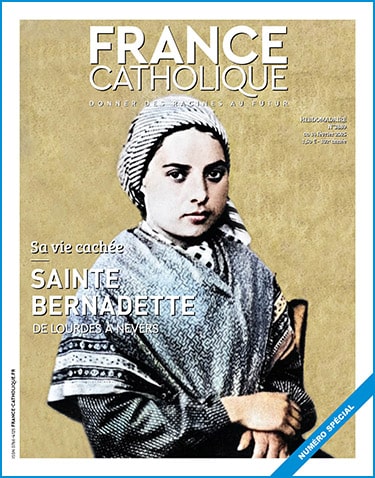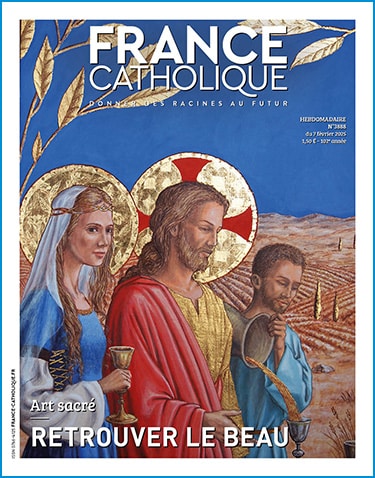IL FAUT QUE LES LECTEURS de ce journal me pardonnent. En juin dernier1, bavardant à Londres avec Arthur Koestler2, nous avons tous deux remarqué combien la science, par des voies absolument nouvelles, remettait au cœur le plus sensible et le plus profond de l’homme l’essence des grandes questions fondamentales, désormais traitées avec dédain par les philosophes ou paraphilosophes, « sémanticiens », « structuralistes », que sais-je ? Et je lui posais, « by joke », la question : quelles raisons avons-nous de croire les philosophes quand ils nous disent que ces grandes questions sont « mortes » (« Dieu est mort », etc.) ?
Réponse : « Leurs raisons ? il n’y en a pas ! puisque ces mêmes philosophes nous disent qu’il n’y a plus de philosophie ! Dont acte ! Il n’y a plus de philosophie, donc fichez-nous, s’il vous plaît, la paix ! Taisez-vous ! Laissez les choses continuer de se produire comme elles le font depuis Galilée : laissez la science ressusciter à sa manière ce que vous n’avez pas su faire vivre. Vous dites que continuer de s’interroger sur la nature de l’homme, sur ses fins dernières, sur sa place dans l’univers, sur la signification de l’être, c’est du blablabla. Soit ! Fermez donc, s’il vous plaît, votre robinet à blablabla, et si votre âge vous le permet, retournez à l’école pour y faire de vraies études. »
Mais revenons-en à ce pardon que je sollicite, sans prétendre qu’il m’est dû. Dans quelques-uns de mes derniers articles (Celui qui pleurait à Pasadena, F.C. n° 1553 ; Le Dieu des Savants, F.C. n° 1554 ; Le Pot au Noir de l’ascendance humaine, F.C. n° 1555. etc.3), j’ai touché à plusieurs de ces questions fondamentales. Elles sont si peu « mortes » qu’avec les lettres reçues je pourrais bientôt faire un livre. Essayons d’en faire un article.
Plusieurs lecteurs, à propos du Dieu des Savants, me font remarquer que ce monde animal que je dis gouverné par une sorte d’antidécalogue n’est pas du tout le chaos que cela supposerait : certes, les animaux passent leur temps à se manger entre eux, mais il y a des règles, et Lorenz a pu parler du « code moral » du loup.
C’est vrai. Mais reconnaissons que le « code moral » du loup n’est guère gouverné par l’amour ! Il est fondé sur le triomphe du fort mutuellement accepté et remis en question en toute occasion favorable.
D’autres soulignent que l’amour n’est pas absent du monde animal, et citent, les uns l’héroïsme de la chatte défendant ses chatons, les autres telle espèce d’oiseaux. C’est vrai. L’amour, peut-on même dire, à condition de renoncer à toute connotation humaine de ce mot, est présent partout dans le monde animal. Mais la présence de l’amour ne peut nous cacher celle, concomitante, de la férocité. Pourquoi la férocité est-elle partout dans la nature ?
Le problème posé par ces remarques est que l’ordre de la Nature comptabilise et utilise comme l’un de ses moteurs essentiels la consommation du faible par le fort. Les trois règles d’or de la nature vivante sont : ne pas être mangé trop tôt (on finit toujours par l’être), manger, se reproduire.
Allant plus au fond, jusqu’aux « drives » ou stimuli qui déclenchent et guident ces comportements, on trouve le plaisir et la peur. En analysant les hormones sécrétées par le fauve qui joue cruellement avec sa proie (le chat et la souris, le lion et la gazelle), on constate que ces hormones ne sont pas celles du stress, de la « haine », de la « colère ». Pas du tout ! Ce sont les hormones qui préparent au jeu et à la digestion.
Certains lecteurs, qui savent bien tout cela, me disent : « Oui, mais ces êtres agissent mécaniquement, par le jeu du stimulus et de la réponse ; vous faites de l’anthropomorphisme en supposant qu’ils souffrent ; ont-ils même une conscience » ?
Entendons-nous sur l’emploi du mot conscience, sinon les philosophes, qui s’y sont cassé les dents, vont nous tirer les oreilles comme à de mauvais élèves qui disent n’importe quoi.
Si ces lecteurs veulent dire par là que l’animal qu’on torture ne sent rien, pas plus qu’une machine (ainsi que le croyait Malebranche, me rappelle l’un de vous), la réponse scientifique est simple. On connaît très bien les syndromes de la douleur chez l’homme. Ces syndromes sont des réactions physiologiques très précises, mesurables avec des appareils. Eh bien, tout simplement, on retrouve ces syndromes chez l’animal supérieur, physiologiquement semblables aux syndromes de la douleur humaine quand l’animal exprime la douleur à sa façon (cris, agitation, etc.).
Malebranche, c’est vrai, donnait des coups de pied à sa chienne et disait, très philosophiquement : « Cela crie, mais cela ne sent point. »4 Si la machine de Wells existait, j’aurais plaisir à retourner au XVIIe siècle pour rosser ce profond cartésien en lui faisant remarquer que « cela crie, mais que cela ne prouve rien, car personnellement je ne sens rien. »
Mais allons, nous savons bien que même la douleur morale existe chez la bête. Observez donc une chatte privée de ses chatons !
Quelques-uns me demandent : « Et vous ? êtes-vous donc végétarien ? ».
Hé non ! et nous sommes ici au cœur du problème. Ne parlons pas du végétarisme lui-même, d’autant moins que certains savants, et non des moindres (a), affirment la présence d’une sorte de « conscience » végétale et nous feraient pleurer à chaudes larmes sur la destinée des salades, non sans preuves troublantes5. Donc, ne nous égarons pas dans ce labyrinthe, et prenons l’essence de la question qui m’est posée : « Et vous n’êtes-vous pas féroce comme le lion, le chat, et même la mésange et la musaraigne, qui sont les plus féroces des animaux ? »
Précisément, je le suis, quoique moins. Je le suis moins pourquoi ? Parce que je résiste du mieux que je peux à l’antidécalogue imprégnant le crocodile que je porte en moi, hérité de mon passé pré-humain. Si je m’écoutais, je veux dire si j’écoutais la bête préhistorique qui survit dans mon rhinencéphale6, fruit longuement mûri du coupe-gorge pré-humain, ma carrière serait parsemée de cadavres, de viols et de déprédations dont je m’honorerais fort, comme Ulysse et Agamemnon. « J’attaquai la ville, dit fièrement Ulysse, j’en tuai tous les hommes, et je fis si honnêtement le partage des femmes que j’en fus universellement loué. » Ce bon Ulysse !
Le ténébreux mystère de l’univers préhumain d’où notre ascendance humaine nous a accouchés grâce à sa constante supériorité dans le maniement de l’antidécalogue, c’est que, précisément, notre être dans sa plus secrète et intime substance est né de là. C’est cela qui nous a faits tels que nous sommes.
À ce point, je rencontre un autre groupe de lecteurs dont voici en substance les propos : « Cette vision des choses est terrifiante, elle porte au doute de la foi, est-il besoin que ce soit vous qui disiez cela ? »
Eh bien, elle ne porte pas au doute, au contraire. Il est vrai qu’elle nous oblige à renoncer à toute orgueilleuse simplification concernant le mystère de nos origines. Nous sommes fils du mystère, et ceux qui croient être en mesure de lire dans la pensée divine oublient le sarcasme divin après la faute : « Les voilà devenus comme l’un de nous ! »
Ceux qui sentent vaciller leur foi chaque fois que le Créateur semble n’avoir pas pris préalablement conseil de leur petit entendement pour faire ce qu’il lui plaît (éternellement), ceux-là me rappellent ma chatte Grisonne, avec qui j’ai souvent de profonds colloques philosophiques : « Je sais, me dit-elle, comment tu te procures à manger : tu le prends dans le frigidaire ; je sais aussi ce que tu fais là, immobile devant cette table, à gratter avec un petit objet : tu t’amuses ; moi aussi, j’aime m’amuser avec de petits objets ; cependant, tu fais aussi des choses absurdes ; par exemple, au lieu du manège incompréhensible et pénible auquel tu te livres dans la chaufferie, pourquoi, pour te chauffer, ne dors–tu pas sur le radiateur ? Et au lieu de ce désagréable vacarme que tu répands avec ta chatte et tes chatons, pourquoi ne parles-tu pas comme tout le monde ? Miaou, et tout est dit.
Ainsi ma chatte Grisonne-t-elle avec son Dieu. Je l’écoute, et me dis : ce que me cache l’antidécalogue de la nature, je le saurai peut-être un jour (s’il plaît au Dieu des hommes) dans un monde meilleur, quand ma petite pensée de bipède quaternaire sera gratifiée d’une lumière plus grande. Mais dès maintenant, voici ce que je sais :
– Je sais que, de tout mon être, j’aspire à l’amour.
– Je sais que, de tout mon être, j’aspire à la conscience et à la vérité.
– Je sais que, de tout mon être, j’abomine la violence, le mensonge, l’erreur, le mal sous toutes ses formes.
Je sais que ce sont là les mouvements les plus profonds de mon être. Tout le reste n’est que bavardage7.
Alors, eh bien ! si tout cela est en moi, si tout cela est moi au point qu’à côté la mort même ne me semble qu’une péripétie sans importance, et si, d’autre part, mon être est le fruit longuement mûri du coupe-gorge cosmique, qu’est-ce que cela prouve, sinon que depuis le fond des âges, depuis la naissance des étoiles, ce coupe-gorge, inlassablement, navigue dans les ténèbres vers le Vrai, le Beau et le Bon ?
Dans ces ténèbres où ma raison se perd, Quelqu’un dont mes aspirations témoignent savait où tout allait.
Et plus on me prouve que tout se produit par le jeu aveugle des causes, plus clairement je vois que ces causes attestent un plan et que leur jeu n’est pas aveugle.
Puisque je vois où elles vont, je sais d’où elles viennent.
Et sachant cela, voyant cela, soudain mon étrangeté s’efface. Dans mon cœur toute angoisse s’apaise. Ce monde mystérieux et cruel vient de l’amour et y retourne. Avec une infinie lenteur, mais infailliblement, il y retourne. Ma brève vie est un pas vers l’amour (b).
Aimé MICHEL
(a) Par exemple Shandra Bose, le Bose de la statistique Bose-Einstein, et d’autres plus récents.
(b) Cette fois, ce sont des lecteurs que je dois citer en bibliographie, en les remerciant de toutes leurs précieuses réflexions et en priant ceux que je pourrais oublier de bien vouloir me pardonner cela aussi : MM. les abbés Sulmont, Lepoutre (dont j’ai admiré le beau latin cicéronien), Mme J. Patier, M. P. Devillers, Mme L. Harreau, M. G. Petithory, M. M. Bados, M. J. Louvet, M. B. de Dinechin, Mme et M. J. Raguier, M. Hervé Rousseau, auteur d’un livre d’excellente érudition historique sur Le Dieu du mal (P.U.F., collection Mythes et Religions, Paris 1963).
Chronique n° 262 parue initialement dans F.C. – N° 1561 – 12 novembre 1976. Reproduite dans La clarté au cœur du labyrinthe, Aldane, Cointrin, 2008 (www.aldane.com), chapitre 24 « Ce que la science ne mesure pas », pp. 613-617.
Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 8 avril 2013
- Cette visite chez Arthur Koestler a eu lieu en juin 1976. L’entrevue a été racontée par Louis Pauwels dans « Un homme universel : A. Koestler » (Le Figaro, 10 juillet 1976). « Pierre Debray-Ritzen, professeur à la faculté de Médecine, écrivain, amateur d’art, créateur d’une psychologie de la création littéraire, Aimé Michel, personnage de la Renaissance (mélange de Pic de la Mirandole, de Giordano Bruno, de Raymond Lulle) et moi, avons passé une journée de juin chez Koestler. Des journées comme ça justifient l’existence. Il y avait un programme. Première partie : existe-t-il des phénomènes, dans l’homme et autour de l’homme, qui violent la nature ? Si oui, est-il scientifique de les négliger ? Aimé Michel était venu de sa retraite dans les Alpes pour dire l’essentiel de vingt ans d’enquêtes sur les mystérieux objets célestes et les faits parapsychologiques. (…) La seconde partie, que nous abordâmes après le dîner, avait pour thème : que faire pour que la liberté ne meure pas ? »
Cette visite ne fut pas sans conséquence si on en juge par le dernier livre de Koestler Janus, A Summing Up, achevé en septembre 1977, publié en 1978 et en traduction française par Georges Fradier l’année suivante sous le titre Janus. Esquisse d’un système, Calmann-Lévy, 1979. En effet il est dédié par son auteur « à Pierre Debray-Ritzen, bien amicalement ». Surtout, son dernier chapitre aborde la question des civilisations extra-terrestres et la dernière de ses quatre annexes traite la question des ovnis. Elle emprunte à la fois son titre « Les OVNI : festival de l’absurde » et sa citation finale à un article d’Aimé Michel « Le problème du non contact » paru en anglais en 1974.
Michel et Koestler avaient échangé une correspondance depuis 1975 au moins. Elle se prolongea jusqu’à la mort de Koestler en 1983 (voir la chronique n° 372, Prière pour Arthur Koestler, dans La clarté au cœur du labyrinthe, Aldane, Cointrin, 2008 ; www.aldane.com; chapitre 28, pp. 732-735).
- Il a été souvent question d’Arthur Koestler (1905-1983) dans ces chroniques, soit sous la plume d’Aimé Michel, soit dans mes commentaires en note. C’est toute la seconde moitié de l’œuvre de l’écrivain qui a été ainsi citée et parfois résumée :
Les somnambules. Essai sur l’histoire des conceptions de l’univers (Calmann-Lévy, Paris, 1960, récemment réédité) en marge des chroniques n° 199, Plus loin que la vie et que la mort (25.05.09) et n° 38, La petite lampe de Prague – La relation cerveau-machine (12.04.2010).
Le cri d’Archimède. L’art de la Découverte et la découverte de l’Art (titre original : The Act of Creation, Calmann-Levy, Paris, 1965 ; récemment réédité aussi) en notes de la chronique n° 75, L’insondable source des songes – La science des rêves 4 (26.04.2011) et de la chronique n° 154, Penser ensemble – Deux modes de pensée : algorithmique et heuristique (5.11.2012)
Le cheval dans la locomotive (The Ghost in the Machine, 1967) dans la chronique n° 142, Notre crocodile intérieur – Les bases neurophysiologiques de la dualité de notre nature, mise en ligne la semaine dernière.
L’Etreinte du crapaud (Calmann-Lévy, Paris, 1972) est l’objet d’une recension dans les chroniques n° 77, La science sauvage – Koestler, Kammerer, la loi des séries et l’hérédité des caractères acquis (16.05.2011) puis n° 82, La question et le carcan – Poseurs de questions et spécialistes de la non-spécialisation (12.08.2011)
Face au néant (Calmann-Lévy, Paris, 1975 ; titre original : Le talon d’Achille) est également porté à l’attention des lecteurs dans la chronique n° 223 La ci-devant matière ? – L’inachèvement de la science en général et de la physique en particulier (22.11.2011).
Le Hasard et l’infini (avec Alister Hardy et Robert Harvie, Tchou, Paris, 1977 ; titre original : The challenge of chance. A mass experiment in telepathy and its unexpected outcome, 1973) fait l’objet de la chronique n° 101, Le scientisme disparaît – Les phénomènes qui relèvent de la pensée et l’avenir de la science (14.01.2013).
Tous ces titres portent sur la philosophie des sciences à laquelle Koestler se consacra à partir de la fin des années 50. À cette époque il était déjà un auteur célèbre, comme journaliste, pamphlétaire et romancier. Né à Budapest, d’origine juive, formé à Vienne, il adhéra au parti communiste et passa un an à Moscou puis rompit avec le parti. Journaliste en Espagne, il fut condamné à mort par les troupes de Franco, en réchappa, s’engagea dans la Légion étrangère française, puis dans l’armée britannique et devint citoyen britannique. Se succédèrent alors romans et essais, tous écrits en anglais, qui connurent un grand succès : Le Zéro et l’Infini, La Tour d’Ezra, Spartacus, Le Yogi et le Commissaire, La Corde raide, Le Lotus et le Robot, etc.
Comme l’écrit Murray A. Sperber en introduction d’un recueil de critiques consacré à l’œuvre de l’écrivain, « sans aucun doute, l’hommage le plus frappant rendu à Arthur Koestler est l’éventail des critiques que réclame l’analyse de son œuvre. Il inclut des critiques littéraires, des spécialistes et théoriciens de la politique, des spécialistes des sciences naturelles, des philosophes, des psychologues et des chercheurs en religion. Aucun de ces auteurs n’est capable de se focaliser sur plus d’un ou deux des domaines traités dans l’œuvre de Koestler » (Arthur Koestler. A Collection of Critical Essays, M.A. Sperber ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1977).
- La chronique n° 257, Le Dieu des Savants – Les horreurs de la nature et la loi morale dans un univers animé par une pensée, a été mise en ligne le 25.02.2013. Nous publierons ultérieurement les deux autres chroniques citées.
- Voir la chronique n° 10, Le coup de pied de Malebranche, mise en ligne le 15.04.2009.
- Il y a trois personnalités indiennes du nom de Bose, un homme politique (Subhas Chandra Bose, 1897-1945) et deux hommes de science. Aimé Michel confond les deux derniers. Celui auquel il fait allusion en note est le plus célèbre des deux, Satyendra Nath Bose (1894-1974). Ce mathématicien et physicien, né à Calcutta, fut le premier en 1924 à proposer une théorie quantique décrivant comment des photons présents en grand nombre dans une cavité se répartissent à l’équilibre entre les différents niveaux d’énergie. L’autre Bose, dont Aimé Michel parle dans le corps du texte, est le physicien et physiologiste Jagadish Chandra Bose (1858-1937) qui fut le premier scientifique indien à être élu à Royal Society en 1920. C’est ce dernier, pionnier de la radio avant Marconi semble-t-il, qui fit les expériences montrant que des tissus végétaux répondent à des stimulations variées par des variations de potentiel électrique tout comme les tissus animaux (http://www.areplantsconscious.com).
Ajoutons que ces variations de potentiel ne sont pas si surprenantes car le milieu intracellulaire de toutes les cellules, végétales et animales, a une composition en atomes et molécules électriquement chargés (ions) fort différente du milieu extracellulaire. En tout état de cause ces mesures de potentiel ne confirment nullement la thèse védique d’une conscience végétale.
- Allusion à la théorie du cerveau « trois en un » de Paul MacLean qui a fait l’objet de la chronique n° 142, Notre crocodile intérieur – Les bases neurophysiologiques de la dualité de notre nature, mise en ligne la semaine dernière.
- Aimé Michel précise ainsi ce qu’il écrivait dans la chronique Dieu des savants (25.02.2013) : « Car si l’homme, dernier produit d’une évolution qui n’a jamais cessé de marcher vers lui, se trouve porteur d’une loi morale qui condamne le passé de l’univers, il faut bien que cette loi morale ait été voulue et projetée dès la naissance des choses. » Il donne ainsi un contenu concret à ce que, conformément à la tradition, on appelle assez abstraitement « loi morale » que Kant la tenait pour présente en chacun de nous et pour fondement du respect dû à autrui.
Dans la première partie de son livre classique Les fondements du christianisme (traduction de Mere christianity par Aimé Viala, éditions LLB, Valence, 2006), intitulé « Le Bien et le Mal, clef du sens de l’univers », C.S. Lewis analyse également la signification de cette loi morale sans faire référence à une révélation religieuse (sur Lewis, converti réticent et auteur célèbre, notamment des Chroniques de Narnia, voir la chronique n° 2, La quarantaine des dieux, publiée ici le 03.05.2010, notamment la note 3). Il conforte dans ses grandes lignes la réflexion d’Aimé Michel. Voici en bref les cinq articulations principales de sa pensée dont chacune correspond à un chapitre du livre :
1/ La loi de la nature humaine. Les êtres humains par toute la Terre ont cette idée curieuse qu’ils doivent se comporter d’une certaine façon. Si on compare les enseignements moraux des anciens Égyptiens, Babyloniens, Indiens, Chinois, Grecs et Romains, on ne peut qu’être frappé de leur ressemblance entre eux et avec les nôtres. Si les hommes ne s’accordent pas sur les applications pratiques, par exemple envers qui il faut faire preuve d’altruisme, ils sont par contre d’accord qu’il ne faut pas être égoïste. Cependant, dans les faits, ils ne se comportent pas selon la loi morale : ils la connaissent mais ne la respectent pas, ce qui distingue la loi morale des lois physiques. Pour Lewis, ces deux faits, la connaissance de la loi et son non respect, sont « au fondement de toute réflexion lucide sur nous-mêmes et sur l’univers dans lequel nous vivons. »
2/ Quelques objections. Certains objectent que cette loi n’est qu’un instinct qui s’est développé comme les autres instincts, l’amour maternel, le désir sexuel ou le besoin de nourriture. Cette analyse ne tient pas. Par exemple, lorsque quelqu’un est en danger, on est partagé entre le désir de l’aider et celui de fuir. Ce qui en nous juge l’instinct à encourager ne peut être un instinct. D’autres objectent que la loi morale n’est qu’une convention sociale apprise dès l’enfance. Mais ce n’est pas parce qu’une chose est apprise que c’est une simple convention, comme le montrent les mathématiques par exemple. Il y a deux raisons de rapprocher la loi morale des mathématiques : son universalité et notre aptitude à estimer qu’une morale (celle des Nazis par exemple) peut être moins bonne qu’une autre.
3/ La réalité de la loi. Avec les hommes apparaît ainsi une distinction entre les faits (ce que les hommes font) et quelque chose d’autre (ce qu’ils devraient faire), alors que dans le reste de l’univers seuls les faits existent. Certains pensent que la bonne conduite peut ne pas bénéficier à l’individu mais qu’elle bénéficie à l’humanité et que c’est pour ça que les hommes se conduisent bien. Mais ce n’est pas une bonne explication de ce que nous ressentons. Si à la question « Pourquoi ne dois-je pas être égoïste ? » nous répondons « Parce que c’est bon pour la société », on peut nous rétorquer « Que m’importe le bien de la société si j’y trouve mon bénéfice personnel », à quoi nous répondrons « Parce qu’il ne faut pas être égoïste », ce qui ramène au point de départ. Au bout du compte, il faut admettre que la loi morale est une réalité indépendante de nous et qui s’impose à nous au-delà des faits.
4/ Ce qu’il y a derrière la loi. Depuis que les hommes pensent ils ont soutenu deux conceptions de l’univers. Selon la conception matérialiste la matière a toujours existé sans qu’on sache pourquoi et a produit par hasard des êtres vivants qui ont évolué jusqu’à nous. Selon la conception religieuse, ce qui se cache derrière l’univers est plus proche d’un esprit que de toute autre chose connue de nous ; autrement dit, ce serait une conscience qui a des buts et qui préfère certaines choses à d’autres ; qui a créé l’univers en partie pour des raisons que nous ignorons et en partie pour faire des êtres comme elle (dans la mesure où ils sont pourvus d’un esprit). La science ne peut trancher entre ces deux conceptions parce que la question du pourquoi des choses ou de savoir s’il existe quelque chose derrière ce que la science observe n’est pas une question scientifique. La situation serait désespérée sans la constatation suivante : il est une chose et une seule dans l’univers sur laquelle nous en savons plus que nous ne pouvons en apprendre par l’observation extérieure : l’homme. C’est la seule chose que nous connaissions de l’intérieur. C’est ainsi que nous savons que les hommes connaissent la loi morale, ce qu’un observateur extérieur ne pourrait pas deviner. De même, s’il existe quelque chose derrière l’univers, au-delà des faits, on ne peut pas le savoir en observant simplement les faits. On ne peut le savoir que dans notre cas, or précisément en examinant l’intérieur de nous-mêmes nous trouvons que nous n’existons pas seul, que quelqu’un ou quelque chose veut que nous agissions d’une certaine manière.
5/ Nous avons des motifs d’être mal à l’aise. Nous avons deux indices sur cet Être : l’un est l’univers qu’il a fait, d’où on déduit que c’est un grand artiste sans pitié (car l’univers est un lieu très dangereux et terrifiant) ; l’autre est la loi morale qu’il a mise dans notre esprit. C’est un meilleur indice de même qu’on en apprend plus sur un homme en l’écoutant qu’en regardant la maison qu’il a construite. On en déduit que désintéressement, courage, honnêteté, véracité l’intéressent par-dessus tout. Par contre rien n’indique qu’il est « bon » au sens d’indulgent, doux ou sympathique, car la loi morale est dure, sans considération pour la souffrance, le danger ou la difficulté qu’il y a à la suivre. Rien n’indique non plus qu’Il soit une personne. S’il est un esprit impersonnel, il n’y a pas lieu d’attendre qu’il fasse cas de nous ou qu’il nous pardonne. D’où une terrible situation : si l’univers n’est pas gouverné par une bonté absolue, nos efforts sont désespérés à long terme ; mais s’il l’est, nous nous faisons chaque jour les ennemis de cette bonté et notre cas est à nouveau sans espoir. Dieu est à la fois le seul réconfort et la terreur suprême. C’est en prenant en compte ces faits désagréables que le christianisme fait sens, que la question à laquelle il répond devient compréhensible, mais il commence dans la consternation non dans le réconfort…
Ce résumé schématique, ce squelette qui ôte la chair du texte original, ne saurait évidemment le remplacer, simplement inciter à le lire et à y réfléchir. Remarquons toutefois que la réflexion sur les seules données naturelles ne conduit pas C.S. Lewis à y découvrir un Dieu d’Amour, contrairement à A. Michel. Ce dernier, on s’en souvient, à la question « ce monde a-t-il été créé par un Dieu d’Amour, malgré les apparences exactement contraires ? » répondait sans hésiter « oui (toute foi mise à part ; et la science étant seule en considération). Oui, évidemment. » (Dieu des savants, 25.02.2013). Cette différence tient sans doute à ce que pour Aimé Michel la loi morale est naturelle car « présente dans le code génétique de l’homme » et fruit d’une longue évolution.