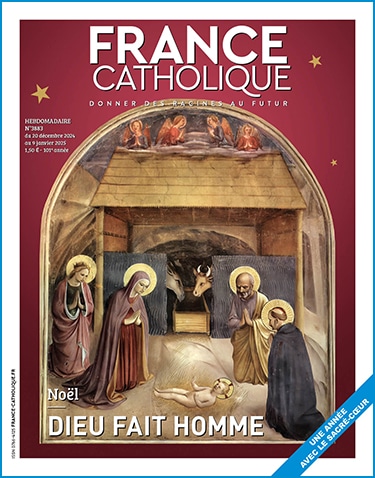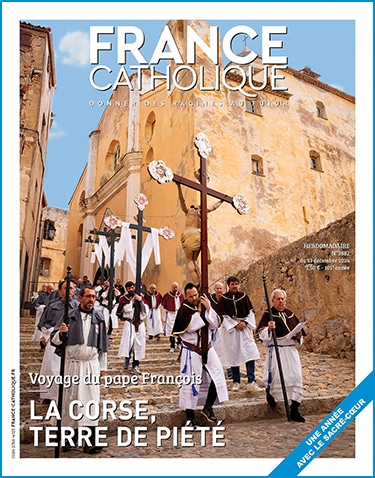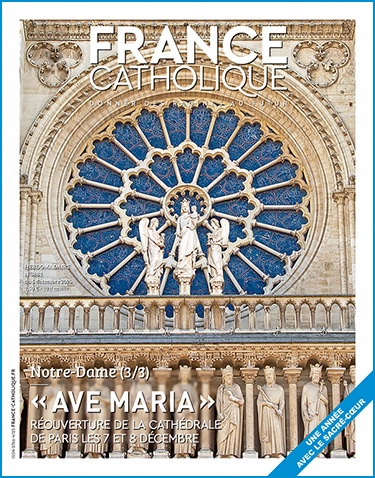Que représente désormais la Vierge Marie à vos yeux ?
Thierry Demaizière : Plusieurs aspects nous ont saisis. La dimension maternelle de la Vierge, tout d’abord. Marie est la maman de tous ces pèlerins. Les gens viennent vraiment se réfugier dans les plis de sa robe ou dans ses bras et ils y vivent un moment universel. C’est très frappant chez les Gitans qui lui portent un amour enthousiaste. Il est vrai que pour beaucoup, la Vierge est moins impressionnante que Dieu ou Jésus !
Beaucoup de ceux que nous avons rencontrés ont mentionné un second aspect très important : les gens très malades et leurs familles se sentent proches de cette femme qui a perdu un fils crucifié. La Vierge a souffert comme eux. C’est une dimension essentielle chez les pèlerins.
La souffrance qui s’expose à Lourdes laisse-t-elle percevoir ce qu’il y a de plus beau en l’homme ?
TD : Bien sûr. Il n’y a d’ailleurs pas qu’à Lourdes que l’on peut ressentir cela. Dans les conflits que j’ai pu couvrir comme reporter de guerre, j’ai assisté à des moments de vérité incroyables. À Lourdes, ce qui nous a frappés, c’est combien la fameuse phrase prêtée à Bernadette Soubirous à propos de la Vierge – « Elle m’a regardée comme une personne » – était vécue en vérité par les malades. Le rapport entre l’hospitalier et le malade constitue un noyau central d’une densité inouïe.
Alban Teurlai : Lourdes va à contre-courant de l’époque qui partout met en avant le corps jeune et vaillant. C’est l’endroit où l’on célèbre le malade. La question du miracle y est secondaire. Plus on s’approche de Lourdes, plus on s’éloigne du miracle. Rares sont ceux qui arrivent en fauteuil en espérant repartir en courant ! Les gens viennent pour quelques jours d’apaisement, à la recherche d’un regard nouveau.
Au regard de cette expérience, peut-on dire que toute vie vaut la peine d’être vécue ?
TD : Nous ne souhaitons pas aborder ce domaine, car ce n’était pas du tout l’objet de notre film. Ce que je peux juste dire, c’est que j’ai été épaté par l’un de nos personnages, Jean, atteint de la maladie de Charcot. J’envie sa « chance » de n’avoir éprouvé de la terreur que pendant les dix minutes qui ont suivi l’annonce de ce terrible diagnostic : il est habité par une force qui nous a impressionnés. Pour lui, jusqu’au bout, la vie méritera d’être vécue. La maladie, il le dit lui-même, l’aura même rendu meilleur et plus humain. Mais il s’agit là d’un cas singulier, celui de Jean, et je me garderai bien de le généraliser.