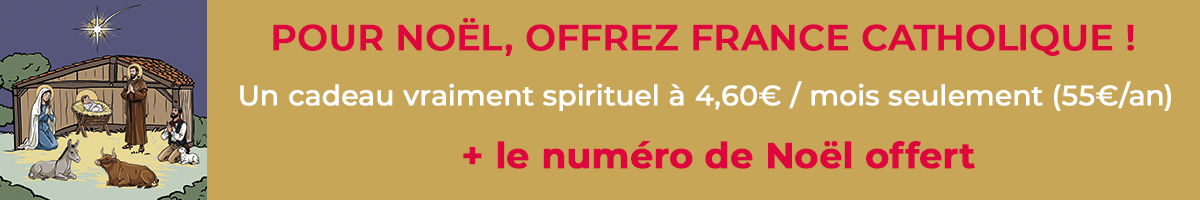18 MARS et suivantes
Bruno Charmet, qui est pour moi un ami de longue date, a dirigé deux numéros de la revue Sens publiés par l’Amitié judéo-chrétienne de France, en hommage au cardinal Jean-Marie Lustiger. Je les lis avec passion, car ils nous mettent au centre même de cette identité vive du Cardinal dont le christianisme se rapportait à l’origine juive, d’une façon qui étonnait parfois, bousculait souvent les idées toutes faites, mais qui est à la fois un acquis et un aiguillon pour le présent et le futur. Je me souviens que dès sa nomination à paris, cette identité faisait énigme et prêtait à discussion. La question avait été agitée au Quotidien où j’étais alors, suscitant des réponses contrastées. Dans la communauté juive, il devait y avoir des réactions parfois vives, notamment celle de Raphaël Drai dans un livre provocateur. En dépit de l’action pacifiante du Cardinal et de la bienveillance affectueuse qu’il avait acquise par exemple auprès des juifs de Paris – il fallait voir la vénération qui l’entourait au sortir d’une cérémonie à la synagogue de la rue de la Victoire – la controverse ne s’est pas éteinte quant à la singularité de son identité. Sens a repris le dossier, avec l’article du rabbin Josy Eisenberg paru dans Actualité juive du 6 septembre 2007.
On pourrait appliquer à Josy Eisenberg le terme d’intransigeance, nullement dans une acception péjorative mais dans celle explicitée par Émile Poulat pour le catholicisme du dix-neuvième siècle et de ses surgeons. Sa conclusion peut nous paraître raide mais elle n’est que cohérente : « Bref : un Juif converti et, de surcroît, dignitaire d’une autre religion, s’exclut de la vocation juive, qui exige l’obéissance aux lois de la Torah, et est exclu de la communauté juive et de ses diverses formes de « communion ». C’est d’avantage qu’une excommunication : c’est une radiation. On prête à de Gaulle, apprenant la conversion de Maurice Schumann au catholicisme la boutade suivante : « Cela fera un chrétien de plus, cela ne fera pas un juif de moins ». On saisit bien ce que le Général a voulu dire. Mais pour le judaïsme, c’est exactement le contraire. Le Cardinal était un chrétien de plus, mais bien un juif de moins. »
Qu’on ne s’y trompe pas. Avec Josy Eisenberg, le cardinal Lustiger n’avait pas en face de lui un adversaire malveillant. Il avait un interlocuteur exigeant qui, au surplus, reconnaissait que « le nouveau regard jeté sur les juifs par le christianisme de l’après Shoah tant dans ses institutions et ses hiérarchies » constituait « une révolution des esprits et des cœurs ». Il s’agit pour lui de la seconde bonne nouvelle pour le judaïsme après la renaissance d’un État juif. Ce changement profond a déterminé une immense floraison de recherches historiques et théologiques dont le rabbin se félicite sans réserve. Et il reconnaît le rôle éminent du Cardinal dans le rapprochement des juifs et des chrétiens. Il va même très loin dans la reconnaissance en affirmant que « rien n’interdit d’imaginer que Dieu ait voulu donner le juif Aaron Lustiger à l’Église ad majorem Dei gloriam ».
Cependant, l’intransigeance de sa foi – qui n’a rien à voir avec ce que d’aucuns stigmatiseraient à l’aune de l’intolérance d’on ne sait quel fondamentalisme – ne lui permet pas de transiger sur l’essentiel. Il n’y a pas de compromis possible quant à l’appartenance au peuple juif, qui repose sur une absolue obéissance à la Loi et ne saurait admettre l’achèvement de la Promesse dans le messie Jésus de Nazareth… Il convient pourtant de la possibilité « qu’une nouvelle religion se soit greffée, comme disait Saint Paul, sur l’ancien olivier » et qu’il y ait « deux voies parallèles de Salut ». Mais l’inadmissible est de faire du judaïsme « une forme archaïque et dépassée » par le christianisme.
Le Cardinal, à mon sens, avait déjà prévenu ce genre d’objections lorsqu’il déclarait à deux journalistes du Yediot Aharonot en janvier 1982 : « Je n’ai jamais prétendu que j’allais être simultanément un bon juif selon la définition des rabbins, et un bon chrétien, selon la définition de l’Église. Mais vous comprenez que je ne puisse pas, sans perdre ma propre dignité et la dignité que je dois à mes parents et celle que je dois à tous ceux dont je suis irrévocablement solidaire, ne pas revendiquer ma condition de juif. Dans les temps de persécution comme dans les temps de paix. Je l’ai fait non pour blesser, mais par respect pour la vérité et pour ce qui lui est dû. » Une telle déclaration agrée sans doute d’ailleurs à Josy Eisenberg. Elle coupe court à toute tentative simplificatrice ou à je ne sais quelle trop facile syncrétisme.
Tout comme Josy Eisenberg se veut juif dans une fidélité intégrale à la Torah, de même Jean-Marie Lustiger se veut intégralement chrétien et fils de l’Église. Mais le chrétien entend demeurer fidèle à sa filiation juive, qui, par ailleurs, a un sens religieux déterminant pour sa foi chrétienne. Ce que le Rabbin, au demeurant, peut admettre à condition que soit levé l’équivoque d’une double appartenance religieuse. Mais les choses se compliquent un peu, car le cardinal est très conscient du symbole très fort qu’il porte, du fait de son origine publiquement et fièrement assumée : « Ce que je constate, c’est que je suis porteur de beaucoup plus de signification que ma personne elle-même. Ce n’est pas seulement l’individu que je suis qui est en jeu, c’est tout ce dont je suis chargé historiquement. Je vois bien que, pour beaucoup de chrétiens, le geste qui a consisté à me donner des responsabilités aussi voyantes est pour eux un rappel de cette réalité historique et spirituelle que j’ai appelée « les racines ». Un rappel vivant de la part d’Histoire qu’ils ont souvent été tentés de se cacher à eux-mêmes. » (Propos tenus aux mêmes journalistes israéliens).
Par ailleurs, le Cardinal a toujours rappelé que la première Église était une Église juive, qui disparut à la suite de la chute du Temple et la prise de Jérusalem. Et il fut de ceux qui furent associés directement à la refondation en Israël de cette même Église juive dite de la circoncision, avec des fidèles se voulant juifs chrétiens. Reconnaissons qu’il y a de quoi troubler Josy Eisenberg, car même s’il ne saurait y avoir d’équivoque sur le fait qu’une telle communauté n’entend nullement se substituer au judaïsme, elle se situe dans une logique d’accomplissement forcément redoutée par les juifs pieux. J’ajoute que des mouvements, qui ne semblent pas être de surface, comme les Juifs pour Jésus dessinent tout un contexte qui peut accroître ce trouble. Ce qui est acquis parmi les fils de la communauté juive c’est toutefois une assurance de sympathie voire d’amitié à leur égard de la part de l’Église, dont l’apport est inestimable. Le Cardinal déclarait cette amitié « voulue de Dieu » en gage d’un travail désormais possible de compréhension mutuelle. Je reprends ces remarques à Mgr Francis Deniau, évêque de Nevers, qui fut longtemps le responsable de l’épiscopat français pour les relations avec le judaïsme. Je reprends aussi cette déclaration du Cardinal qui me paraît absolument décisive sur le fond de la question : « L’avenir commun entre juifs et catholiques ne se réduit pas à limiter le contentieux possible. Il ne peut se contenter d’une pacifique compréhension mutuelle, ni même d’une solidarité dans le service de l’humanité. Cet avenir demande un travail sur ce qui est commun comme sur ce qui sépare. Que les différences et les tensions deviennent un stimulant pour un approfondissement toujours attentif et docile aux mystères dont l’histoire constitue les héritiers en indivis. »
Je verrais assez dans ces paroles une sorte de testament spirituel qui indique la direction à prendre pour la suite de l’Histoire qu’il a contribué à fonder. Cela m’incite d’ailleurs à ouvrir une discussion avec le cher Paul Thibaud, président de l’amitié judéo-chrétienne de France, qui apporte sa réponse personnelle au rabbin Josy Eisenberg dans la même revue. Après avoir rappelé les données de la difficulté dans des termes assez proches de ceux que je viens d’employer, Paul Thibaud s’emploie à argumenter une objection à l’égard du Cardinal : celle de se placer hors du temps, ce qui peut paraître étrange eu égard à un homme qui m’a toujours paru, tout au contraire, habité par l’Histoire. Il est vrai que la perspective de Jean-Marie Lustiger était en quelque sorte mystique, voire apocalyptique, en attente de ce moment où « les juifs et les nations formeront la véritable Église catholique ». Paul Thibaud estime qu’une telle attente ignore l’épreuve de vivre la proximité dans le temps de l’histoire. Une histoire qui ne plaiderait guère en faveur de l’harmonie dans la proximité : « On le sait depuis le Nouveau Testament, où les textes les plus antijuifs viennent de milieux judéo-chrétiens. On sait aussi comment l’ouverture de Luther au judaïsme s’est retournée. » Et d’invoquer Franz Rosenzweig avec sa définition des rôles, de la place de chacun dans l’histoire du Salut, qui serait « peut-être un meilleur moyen de pacification ».
L’objection par l’Histoire se renforce alors par une brève analyse des graves problèmes qu’eut à affronter l’Église de Jacques avec « les condamnations, les invectives, les exclusions, le recentrement du judaïsme sur la loi écrite et orale ». Mais, selon Thibaud, Jean-Marie Lustiger aurait voulu fuir tout ce passé détestable, ainsi que la calamité de l’antisémitisme chrétien en se réfugiant dans l’utopie du « chrétien-juif ». Il s’agissait de récuser plutôt que d’analyser, ne serait-ce qu’à cause de son attachement viscéral à cette Église hier si coupable.
Et pour exorciser en quelque sorte le passé, le Cardinal aurait imaginé une cause très particulière de la persécution des juifs par les chrétiens avec « une structure atemporelle, la persistance, en dessous, d’un paganisme opposé à la Révélation et à ceux pour qui elle venait, pervertissant aussi le christianisme réel. Ainsi l’Église est-elle exemptée et peut être rapprochée de la synagogue, alors que le monde, avec sa nature païenne, est accablé ». À partir de là, se définirait une pensée Lustiger très hostile à la modernité et qui mépriserait le politique (réduit à l’idolâtrie du pouvoir). Mais il faudrait que je cite intégralement « le réquisitoire final de Paul Thibaud, qui est certainement très construit, très cohérent et qui évoque pour moi la polémique de Mounier jadis développée dans « Feu la chrétienté ». Je n’ai pas cet essai sous la main, en ce moment, ce qui est bien dommage, car je pourrais évaluer la parenté de la pensée à propos du rôle historique du christianisme et de l’émancipation de la modernité.
Mais la querelle est trop grave pour que je me contente de la signaler. J’ai envie d’y mettre mon grain de sel, d’autant qu’il est vrai qu’on a vivement reproché au cardinal Lustiger ses griefs contre les Lumières, son pessimisme concernant certaines évolutions. Je ne prétends pas, par ailleurs, que tout soit faux ou contestable dans l’analyse que nous propose Paul Thibaud d’un christianisme qui aurait prétendu au « monopole du sens » en commençant par délégitimer le judaïsme et en suscitant par la suite « une ivresse d’émancipation qui n’arrête pas de nous déconcerter ». Mais l’affaire est d’une complexité telle que je ne voudrais être ni sommaire ni réducteur, tout en répondant sans détour à l’imputation centrale quant à « ce piège que le christianisme historique s’est construit et où il reste pris ».
Au préalable, je voudrais pourtant tordre le cou à ce reproche de mépris du politique. Je m’insurge de toutes mes forces à l’encontre de ce que je considère être un préjugé, contraire à toutes mes informations de journaliste, à tout ce que j’ai observé et jusqu’aux confidences du Cardinal. Il se trouve, en effet, que j’ai vécu de façon assez intense la période initiale du premier septennat de François Mitterrand, notamment au moment de la fameuse querelle de l’école qu’avait provoqué le projet d’unification scolaire du programme socialiste. J’ai même eu d’ailleurs le témoignage personnel du président Mitterrand sur ses relations privilégiées avec le Cardinal. Mais ce qui m’a frappé sur le moment, c’est l’étonnante connivence de l’archevêque de Paris avec la politique et ses responsables. J’ose dire que le Cardinal s’y comportait comme un virtuose, impressionnant d’ailleurs tous ses interlocuteurs : Mitterrand ou Chirac. Ce qui m’a le plus étonné, c’est la façon dont il s’adressait à eux, sans jamais rien cacher de ses convictions, mais en se montrant toujours extrêmement respectueux de leurs prérogatives et de leur liberté de décision. Certes, dans cette affaire de l’école, il défendait, en un certain sens, les intérêts d’un « lobby catholique », mais il ne le faisait nullement de façon arrogante et encore moins partisane. Il s’expliquait patiemment, préférant lui aussi convaincre plutôt que de contraindre.
Il est vrai qu’à certains moments il est monté au créneau, avec toute son autorité et une particulière pugnacité. Pierre Mauroy se souvient probablement encore d’un certain entretien au Monde qu’avait recueilli Bruno Frappat, et qui le fit sursauter. Je ne pense pas pourtant qu’il en ait voulu au Cardinal avec lequel il eut, par la suite, une substantielle explication. Les choses avaient au moins le mérite de se dire et de se faire dans la clarté, loin des faux-semblants et des intrigues de couloir ou de sacristie…
Mais j’en reviens au fait à propos du piège dans lequel le christianisme se serait pris, selon Paul Thibaud. Je dirais d’abord qu’il me paraît téméraire de résumer un passé de vingt siècles avec une telle formule choc. Je serais d’ailleurs tenté de retourner à son inventeur son reproche d’écraser l’Histoire. Si le christianisme s’est emparé du bassin méditerranéen, puis de l’Europe, c’est en vertu de contingences temporelles auxquelles un Péguy a rendu hommage. L’Église s’est trouvée, sans l’avoir cherché, en charge des conséquences de la chute de l’Empire romain, pour assumer une relative régence politique. Le régime de chrétienté qui est né, par la suite, correspondait moins à une pulsion impérialiste qu’à une donnée massive. Seul le christianisme conférait une identité à cet espace qui se reconnaissait en lui. L’éclatement religieux, qui a suivi au XVIe siècle, a conduit à une autonomisation de l’État dont la montée en puissance dans les siècles suivants dessine un système de séparation progressive d’avec l’Église. On attribue un peu vite à cette dernière des vues hégémoniques, sans mesurer à quel point elle a été souvent instrumentalisée par le temporel. Et le grand mouvement de première mondialisation, celui des conquêtes coloniales, qui permettra l’expansion missionnaire ne peut se ramener à une simple séquelle colonialiste.
Je souligne ce dernier aspect parce qu’il me semble correspondre à la pensée peu explicite de Paul Thibaud. Il apparaît, en effet, avec son grief de « prétentions injustifiées de l’Église », « d’appropriation chrétienne de l’Histoire », de captation du « monopole du sens » que c’est l’essence même du christianisme dans son dynamisme pentécostal qui est en cause. L’impératif évangélique de baptiser toutes les nations n’est pas récusable. C’est vrai qu’il a été associé très longtemps à l’expansion politique et économique du monde occidental, d’autant que la dimension universelle chrétienne lui conférait une sorte de légitimité. Je remarque cependant que ce n’est pas l’Europe chrétienne qui a inventé l’impérialisme et les processus de colonisation. Ils sont inhérents à l’Histoire elle-même. Et on peut mesurer, difficilement, en quoi ils ont représenté ou non des gains en terme de civilisation. J’ajoute qu’avec la christianisation, l’apport des valeurs évangéliques a pu adoucir les effets des conquêtes.
Enfin l’autonomisation qui est, de fait, le grand vecteur de l’évolution moderne, a produit des changements radicaux que l’Église a d’autant mieux reconnus, à Vatican II, qu’ils étaient l’aboutissement du destin de l’Occident et du monde. Entre temps, les religions séculières et leurs projets totalitaires avaient fait comprendre qu’un certain usage du « monopole du sens » émancipé de l’Évangile pouvait nous submerger.
Nous en sommes là. L’Église a conduit son aggiornamento, en reconnaissant l’autonomie des réalités terrestres, tout en affirmant que sa mission lui imposait de poser au monde des questions qu’il ne s’adressait pas à lui-même. D’où une nouvelle articulation des relations du temporel et du spirituel où ce dernier ressort renforcé dans sa propre autonomie et sa propre légitimité. Il est vrai qu’au moment du Concile et à sa suite, la remise en cause ecclésiale a été d’une telle violence qu’on s’est posée la question de la continuité même de l’Église, alors que certains considéraient avec une vraie jubilation son éclatement, voire sa crise terminale. Je suis persuadé, quant à moi, que c’est l’attitude et les propos de son ancien élève Michel de Certeau qui ont conduit le père de Lubac à écrire son dernier grand ouvrage « La postérité spirituelle de Joachim de Flore ». En dénonçant l’illusion récurrente d’une Église de l’Esprit qui succéderait à l’Église du Fils, il désignait directement la tentation très présente, dans les années soixante et soixante-dix, d’un adieu aux structures constitutives du christianisme, au profit de la dissémination du sens, de la disparition de tout magistère et jusqu’à la notion de sacerdoce ministériel.
De ce point de vue, le ressaisissement qui se produit dans l’Église catholique avec l’avènement de Jean-Paul II en 1978, et l’arrivée de Jean-Marie Lustiger à Paris en 1981, marque un coup d’arrêt spectaculaire à la logique implacable de l’éclatement et de l’épuisement. On me dira que cela n’a pas empêché la continuation du processus de déchristianisation de l’Europe. Sans doute, mais la christianisation du monde entier est toujours en marche. Et surtout, la détermination des Jean-Paul II et Jean-Marie Lustiger a montré que le défi d’une nouvelle évangélisation pouvait être soutenu et que l’Église pouvait trouver en elle-même les énergies d’un renouveau et d’une parole toujours prophétique.
Les conditions de l’évangélisation et de la visibilité de l’institution ont radicalement changé. Il est vrai que dans un espace culturel « pluraliste » – sur lequel il y aurait beaucoup à dire tant la force d’un univers d’appauvrissement mémoriel produit une évidente conformisation des esprits – le christianisme se prête à une annonce plus respectueuse de ses interlocuteurs. Mais n’est-ce pas conforme à son génie même, qui est celui de l’interpellation de la personne au cœur même de sa détermination devant Dieu ?
Et s’il faut revenir, in fine, à la mission personnelle de Jean-Marie Lustiger en tant que « juif chrétien », ne peut-on pas dire qu’il a ravivé une interrogation théologique, qui avait pratiquement disparu depuis saint Paul, en en faisant une sorte de structure obligée de la pensée ? C’est, de fait, l’Histoire qui avait produit une exténuation de la question, voire son écrasement, du fait d’une tentation spirituelle que le Cardinal appelle païenne, nullement pour botter en touche, mais pour désigner précisément la propension à se débarrasser de l’olivier franc sur lequel est greffé le christianisme. Ce faisant, l’archevêque de Paris ne désirait pas que judaïsme et christianisme se définissent seulement par des rôles, selon le vœu de Franz Rosenzweig, mais qu’ils confrontent leurs attentes du Salut. Dans le respect et l’amitié, mais aussi la tension féconde. Ce n’était nullement échapper à l’Histoire, oublier les affrontements du passé. C’était la relancer en remettant au centre des relations communes le mystère de l’Alliance jamais épuisée. (La revue Sens. Amitié Judéo-Chrétienne de France 60 rue de Rome 75008 Paris. Numéros 2 et 3 de 2008).