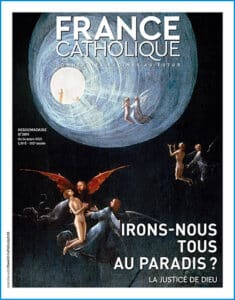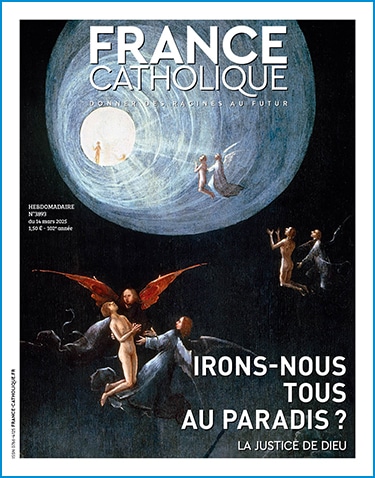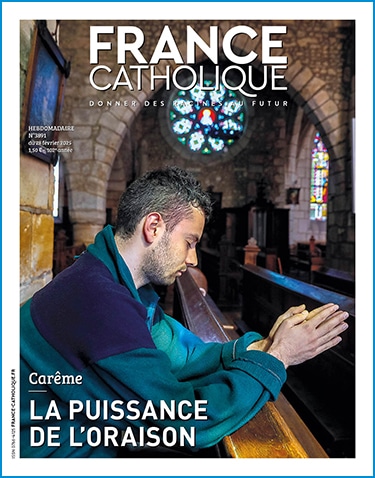Nul n’est sans doute en mesure de dire quel sera l’avenir de la réforme liturgique amorcée par Pie XII, poursuivie par Jean XXIII, voulue par le Concile Vatican II, mise en œuvre par Paul VI, retouchée par Jean-Paul II, et aujourd’hui si attaquée. Ceux qui croient savoir et émettent des jugements catégoriques en ce domaine (« elle est condamnée à disparaître tôt ou tard », « ses fruits merveilleux finiront par s’imposer » etc…) prouvent par là même qu’ils n’ont rien compris à la vie de l’Eglise, plus imprévue que nos projections et plus large que nos exclusives.
Mais, sans faire fond sur l’avenir que nous ignorons tous, nous pouvons déjà sur plus d’un demi siècle faire quelques réflexions utiles sur la manière, bien étonnante, dont les choses se sont passées et continuent d’évoluer.
Que s’est-il passé ?
On peut dire que l’idée moderne de « réforme », particulièrement lorsqu’elle est appliquée au domaine de la liturgie, suppose une notion de l’Eglise née après le Concile de Trente. Ce n’est pas que l’on ne parlait pas jusque là de Réforme, on en parlait même souvent, mais il s’agissait alors d’un renouvellement interne de l’Eglise, puisé aux sources de sa tradition, dans une conformité plus complète au dynamisme surnaturel qui l’habite, il s’agissait donc d’éliminer les adaptations au monde, qui surgissent sans cesse et par lesquelles l’Eglise se prend à ressembler à n’importe quelle société humaine. Or voilà que réforme s’entend de plus en plus comme recherche d’une adaptation plus grande aux nouvelles conditions de vie, aux données de la culture, aux besoins et aux attentes de l’ »homme moderne », pour faciliter sa mission. Malgré tout, ces deux sens ne sont pas forcément contradictoires, car on peut penser qu’un progrès intérieur permettra aux hommes d’Eglise d’être plus libres pour faire les aménagements requis par les circonstances. On voit en tout cas que la constitution conciliaire Sacrosanctum Concilium sur la sainte liturgie les juxtapose dans son préambule : Puisque le saint Concile se propose de faire progresser la vie chrétienne de jour en jour chez les fidèles ; de mieux adapter aux nécessités de notre époque celles des institutions qui sont sujettes à des changements ; de favoriser tout ce qui peut contribuer à l’union de tous ceux qui croient au Christ, et de fortifier tout ce qui concourt à appeler tous les hommes dans le sein de l’Eglise, il estime qu’il lui revient à un titre particulier de veiller aussi à la restauration et au progrès de la liturgie. (1963 S C 1).
Quand on se propose de « réformer la liturgie » en ce sens, on suppose que l’Eglise est comme une armée rangée en bataille, docile aux ordres venus d’en haut, et où chacun est prêt à suivre les inflexions dictées par l’intérêt général, dont les supérieurs (en l’occurrence le Pape et la Curie romaine) sont les seuls interprètes autorisés. On n’a pas eu de peine à y faire correspondre une certaine notion de l’obéissance ecclésiale, d’inspiration ignacienne. Puisqu’il était entendu que la liturgie était du domaine de la discipline et non de la foi, chacun devait être prêt, quels que soient ses goûts, sa sensibilité, ses antécédents, à suivre ce qui était demandé sans se poser de questions. On pouvait autoriser demain ce qui était défendu hier, comme l’inverse d’ailleurs. Question de docilité à ce qui est demandé. On n’avait pas plus à retarder le mouvement qu’à l’anticiper, il fallait agir dans le sens souhaité par notre Sainte Mère l’Eglise hiérarchique. C’était cela être catholique, c’était cela être fidèle au Christ.
Or c’est cela qui est devenu problématique pour plusieurs raisons. Tout d’abord a surgi la résistance de certains à la « nouvelle messe », résistance qui s’est cristallisée autour de Mgr Lefebvre. Elle reposait au fond sur cette conviction que tout dans la liturgie n’était pas remis à l’arbitraire des réformes et qu’il y avait un noyau dur qu’on ne pouvait impunément bousculer, sans perdre la cohérence de la foi catholique. La question est évidemment de savoir si ce jugement portait seulement sur des dérives limitées ou sur le fond même de l’entreprise. Quoi qu’il en soit, la résistance fut longtemps incompréhensible à beaucoup qui n’y virent qu’une désobéissance, d’autant plus scandaleuse qu’elle émanait de ceux qui faisaient profession de fidèle docilité au Pontife Romain, mais une première brèche était faite dans la vision irénique d’une Eglise avançant en bon ordre au-devant d’un avenir radieux.
L’autre difficulté survint du fait du caractère chaotique de la réforme, qui multiplia les démarches ad experimentum, dans un chassé-croisé de permissions et de mises au point, avec des traductions malheureuses, avant que les choses ne se stabilisent peu à peu dans un cadre plus organisé, mais non exempt d’aberrations. L’idée d’une obéissance de tous à la loi liturgique en fut gravement atteinte. Que devait-on suivre ? L’édition typica publiée à Rome en latin ? L’édition française établie par la commission ad hoc, supervisée en principe par les évêques français et publiée avec l’aval de la Congrégation romaine pour le Culte divin ? Tant d’erreurs et de déformations s’y glissèrent que beaucoup de prêtres prirent l’habitude de modifier certaines rubriques, voire certains textes liturgiques. Quant aux simples fidèles, il aurait fallu pour qu’ils s’y retrouvassent remonter des piètres adaptations qu’on leur servait aux textes officiels, à commencer par les documents de Vatican II. Ils n’en avaient souvent pas le moyen. L’argument péremptoire de leurs pasteurs : « le Concile l’a voulu ainsi », ou « le Concile l’a interdit » suffisait le plus souvent à justifier les décisions les plus arbitraires. Beaucoup, malgré leur répugnance, finirent ainsi, par exemple, par accepter de communier debout et dans la main, croyant de bonne foi que c’était la volonté de l’Eglise, alors que Paul VI n’en avait concédé la permission à quelques épiscopats qu’avec beaucoup de restrictions, étant entendu que la pratique de l’Eglise devait rester inchangée sur ce point (« : sur les lèvres et à genoux »)…
La vision ignacienne d’une obéissance militaire en matière liturgique était donc doublement battue en brèche. Ce qui acheva peut-être de la rendre problématique, ce fut l’affirmation glissée tranquillement par Benoît XVI dans le Motu Proprio Summorum Pontificum (2007), selon laquelle la messe dans le rite tridentin, d’après le Missel de 1962, « n’a jamais été abrogée ». Jamais été abrogée ? Alors que tout le raisonnement employé pour défendre la réforme, c’était justement que le nouveau missel avait remplacé l’ancien, rendant caduque le rite antérieur. De là résultait son caractère obligatoire. Si un rite n’en remplace pas un autre, comme une disposition législative peut annuler la précédente, c’est qu’on n’est pas dans une optique purement juridique, où l’autorité compétente peut à sa guise modifier les données. C’est qu’il y a un ordre liturgique qui préexiste à toutes les dispositions légales et dont le législateur ne peut pas faire fi, même s’il a le pouvoir d’en orienter le cours.
Il faudra sans doute du temps pour qu’on retrouve une attitude juste face à la législation liturgique, qui reste tout aussi nécessaire, mais qui ne peut pas tout dire à elle seule. Elle a d’autant plus de chance d’être suivie d’effet que son objectif reste limité et consiste non pas à créer de toute pièce une pratique nouvelle, mais à éliminer des abus de celles qui existent.
Et aujourd’hui ?
Mais, pour l’instant, la situation est celle qu’on vient de voir : une réforme à laquelle beaucoup se réfèrent toujours, mais en ne mettant pas le même contenu sous les mêmes mots, tandis que d’autres la rejettent plus ou moins complètement, se sentant autorisés à cela par certaines déclarations du Saint-Père, même s’il n’a jamais rien affirmé de tel. On peut dire qu’il y a dores et déjà trois positions en présence et pas seulement deux.
Il y a bien sûr ceux qui ont accueilli avec joie la possibilité de la célébration selon la forme extraordinaire du rite romain, soit parce qu’ils y ont toujours été attachés, soit parce qu’ils s’y sont ralliés peu à peu par lassitude, ayant fini par désespérer d’un redressement dans la forme ordinaire. En principe, pour ceux qui ont fait ce choix, tout est clair et limpide, encore que la référence au Missel de 1962 ne satisfasse pas tout le monde et que là encore une guerre des missels soit possible, dans un avenir plus ou moins lointain.
Il y a, en face, ceux pour qui la Réforme conciliaire, et surtout son « esprit », sont des dogmes intangibles, des conquêtes non négociables, même si dans la pratique ils ne suivent que de très loin le texte du Missel de 2002. Il est intéressant de chercher quelle fidélité ceux-ci revendiquent. Le plus souvent, c’est une fidélité négative : le rite liturgique se définit en grande partie en opposition à l’image qu’on se fait du passé, et tout ce qui peut faire référence à l’ordre ancien est perçu comme un retour en arrière, ou en tout cas comme quelque chose de blâmable. Telle paroisse s’insurge contre son curé qui veut faire chanter un chant en latin, tout renseignement pris il s’agit d’un refrain de Taizé, mais c’est égal : on n’a pas fait la révolution pour en venir à cela ! Je me suis pour ma part souvent demandé pourquoi beaucoup de gens étaient si persuadés que je disais la messe de saint Pie V, alors que, de notoriété publique, je célèbre la liturgie en français, face aux fidèles, et bien sûr selon l’ordo missae post-conciliaire. La réponse est claire : il suffit de mettre un peu de hiératisme, de suivre scrupuleusement les rubriques, de permettre aux fidèles de s’agenouiller pour la communion, pour être aussitôt classé comme un séide de Mgr Lefebvre ! La fidélité à l’esprit du Concile Vatican II passe par un style bon enfant, de perpétuelles adaptations, un constant face-à-face du prêtre et des fidèles. Certains ecclésiastiques qui célèbrent la messe selon les deux formes du rite latin se croient obligés, quand ils sont dans la forme ordinaire, de changer quelques mots dans la finale des oraisons, de dire bonjour et au revoir, d’aller porter la paix dans les rangs, de rester en chasuble à la fin pour serrer des mains. Rien de tout cela évidemment n’est dans la lettre du missel de 2002 et lui est même assez contraire, mais il n’empêche : c’est cela la messe d’aujourd’hui et, à défaut de rubriques écrites, celles-ci sont très contraignantes.
Enfin, il y a une position qui est loin d’être dominante, mais qui mérite d’être considérée. Elle est le fait de clercs et de laïcs qui ont accepté sans mauvaise grâce le Missel de Paul VI, voire qui n’ont connu que lui, qui y ont coulé leur piété, qui ont essayé d’en dégager toutes les richesses et qui s’étonnent de le voir traité comme il l’est d’un côté comme de l’autre. Pour eux, le respect des textes et des rubriques n’est pas facultatif, il est la condition pour se laisser peu à peu former intérieurement par la prière de l’Eglise. Ils ont constaté que la simplicité suggérée n’était pas la grise uniformité autour du minimum, que le missel prévoyait parfaitement des amplifications pour les jours plus solennels, que la génuflexion y avait gardé sa place, qu’il n’avait rien contre un grand concours de servants, qu’il avait conservé la structure propre aux offices de la Semaine Sainte, et même que l’emploi du latin au moins pour certaines parties y était conseillé etc.
Certes, ils ont dû constater, lorsqu’ils ont essayé de rendre à la liturgie toute son ampleur, que tout n’était pas dit dans le missel de 1969 revu en 2002, mille détails restaient à régler : on ne parlait pas au début au moins de la clochette au moment de la consécration, la bourse pour le corporal n’était plus mentionnée, on admettait que la grande hostie soit mise dans une coupelle avec les autres et pas nécessairement sur une patène, on ne décrivait pas les encensements, même s’il y était fait allusion, la manière de transmettre le baiser de paix n’était pas précisée, etc., etc. Ils ont pu croire un moment que ce silence valait une suppression pure et simple de l’usage ancien, Mais la Congrégation pour le culte divin s’est chargée de les détromper dans plusieurs de ces cas. Et ils ont peu à peu compris que si le missel « rénové » ne disait pas tout (le Ritus servandus qui accompagnait le missel ancien ne disait pas tout non plus, mais il entrait dans beaucoup plus de détails), il n’interdisait pas non plus tout ce dont il ne parlait pas. Une formule libératrice figure maintenant dans la Présentation du Missel Romain : « on sera attentif à ce qu’établissent cette Présentation générale et la pratique léguée du Rite romain » (PGMR § 42), ce qui ouvre incontestablement des perspectives. Pour tous ceux qui se sont engagés dans cette voie, le rite de 1969 n’est plus un aérolite, un commencement absolu, il faut le prendre dans une continuité, où il aménage sans doute des inflexions nouvelles, mais sans rupture. Il ne s’agit donc pas d’écrire de nouvelles rubriques, ni de faire un mixte des deux « formes » du rite romain, mais il faut avoir assez de discernement et de fidélité au véritable esprit liturgique pour retrouver cette continuité à l’œuvre dans le rituel que l’Eglise nous offre aujourd’hui. Telle est au moins la conviction de ceux qui, dans certains monastères et dans quelques églises françaises, ont cherché à donner à la liturgie « ordinaire » de l’Eglise une forme belle et cohérente, dans la fidélité à son histoire millénaire.
Bien malin qui pourrait dire ce qui est devant nous. On peut imaginer bien des schémas de sortie de crise. Le Saint Esprit a sans doute ses plans. Mais on sait qu’il agit rarement par à-coups et ruptures. C’est pourquoi il serait quand même étonnant que l’Eglise se déjuge au point de rayer d’un trait de plume tout ce qui s’est fait depuis cinquante ans avec sa bénédiction la plus officielle, mais il faudra sans doute encore du temps pour que se dégagent les conditions d’un renouveau et que le tri s’opère entre le bon grain et l’ivraie. Cela n’empêche pas, en attendant, de travailler…