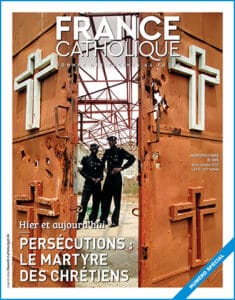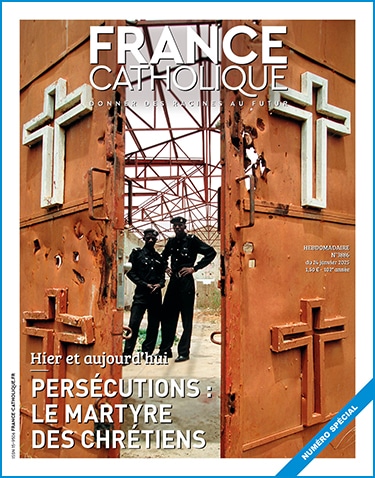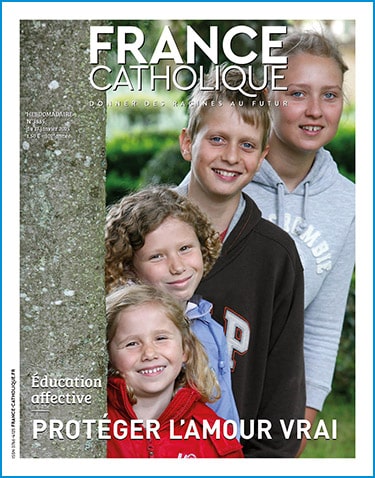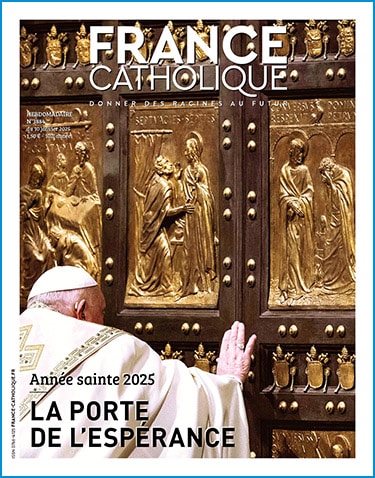C’est une consécration, car il exerçait déjà une influence prépondérante : le chef de la majorité parlementaire libanaise, Saad Hariri, a été nommé le 27 juin Premier ministre. Sa « coalition du 14 mars », soutenue par les capitales occidentales, a enlevé 71 sièges sur 128 lors des législatives du 7 juin — contre 57 pour le camp dirigé par le Hezbollah et appuyé par la Syrie et l’Iran. Désigné par tous les députés de son camp, il a également reçu l’appui de ceux du mouvement chiite Amal dirigé par le président du Parlement Nabih Berri — ce qui exprime une forme de rupture par rapport au Hezbollah chiite et à son allié chrétien Michel Aoun, qui se sont l’un et l’autre abstenus lors du vote pour proposer le nom du chef du gouvernement.
Le fils de l’ancien Premier ministre assassiné le 14 février 2005, Rafic Hariri, a déclaré vouloir mettre au point « un gouvernement d’union nationale dans lequel tous les principaux blocs sont représentés et qui est harmonieux, opérationnel et protégé de toute forme d’obstruction et de paralysie ». Cela signifie concrètement que, dans ce cabinet, la minorité ne disposera plus du droit de veto qui lui avait été reconnu en 2008 et qui bloquait la vie politique : la défaite du Hezbollah aux dernières législatives l’a rendu plus conciliant.
Au départ peu attiré par la politique, Saad Hariri y est venu en consacrant toute son énergie à rechercher les auteurs de l’attentat qui avait coûté la vie à son père. Bénéficiant de la coalition entre les sunnites, la majorité des chrétiens et les Druzes, il s’est servi d’une formidable machine politique et d’un énorme capital de sympathie. Les campagnes électorales de 2005 et 2009 ont d’ailleurs montré sa proximité avec la population. Laissant la gestion du pouvoir au Premier ministre Fouad Siniora, un fidèle collaborateur de son père, il a, depuis quatre ans, parcouru le monde où il a été reçu, notamment aux États-Unis, comme un chef d’État. Entre 2005 et 2007, alors que se multipliaient les assassinats visant des personnalités antisyriennes, chrétiennes ou musulmanes, il a passé la plus grande partie de son temps hors du Liban, limitant ses apparitions publiques. Traitant le pouvoir syrien de « régime d’assassins », il aura en retour été qualifié de « valet » des Occidentaux par le président Bachar al-Assad.
La formation du gouvernement va entraîner de longues négociations. Au puzzle politique se superpose en effet l’enchevêtrement des communautés religieuses, qui leur attribue minutieusement les postes importants et maintient des proportions intangibles — alors que les chrétiens sont devenus minoritaires. Derrière, se profile le jeu des puissances régionales — Syrie et Iran, mais aussi Israël et Arabie saoudite — et internationales — États-Unis et Europe, spécialement la France liée depuis des siècles au Liban. Il faut aussi mentionner les Palestiniens, traditionnellement un État dans l’État, mais que le président actuel, le général Michel Sleimane, lorsqu’il était le chef de l’armée, n’hésita pas à contrer en 2007 en mettant au pas le camp de Nahr el-Bared.
Jean Étèvenaux