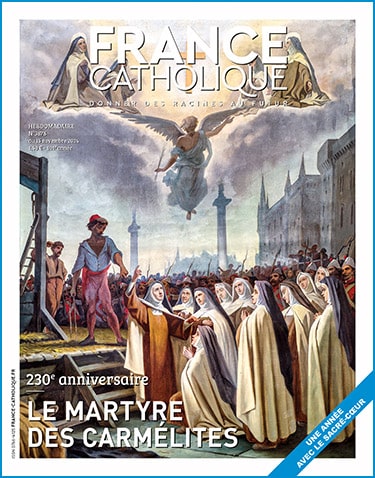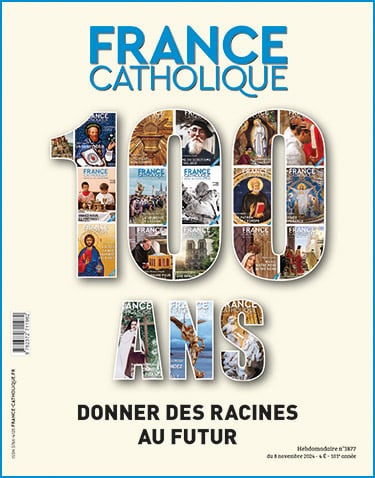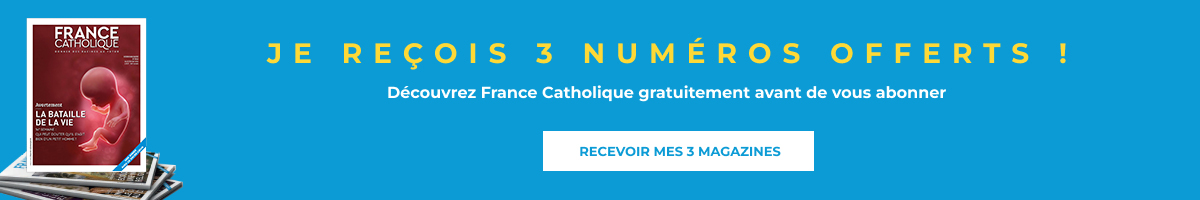Cela s’est fait très vite. J’ai reçu fin juin une invitation à me rendre au XXVes rencontres Pétrarque de Montpellier aux débats sur le thème de l’actuelle défiance vis-à-vis des institutions. Ces rencontres sont organisées conjointement par France Culture et Le Monde, représentés par Emmanuel Laurentin et Jean Birnbaum.
A l’origine, leur création s’est faite sous l’égide de ce personnage étonnant qu’est Georges Frêche, alors maire de Montpellier, qui voulait offrir à sa ville une place reconnue au milieu des festivals d’été. C’était un pari en faveur de la culture. Il m’est arrivé, à diverses reprises d’écouter la retransmission différée sur France Culture de ces rencontres Pétrarque, les années passées. J’avais apprécié le caractère spontané des débats à plusieurs voix, où Georges Frêche s’insérait parfois, avec son autorité d’universitaire. Comment vais-je faire entendre mon ton propre, cette année, je ne le sais encore. Il me faudra probablement être au cœur de l’événement pour trouver ma place, d’autant que je ne saisis pas encore vraiment le sujet dans son ampleur.
Heureusement, Le Monde daté du jeudi 15 juillet vient à mon secours, en publiant de larges extraits de « la leçon inaugurale » que prononcera Dominique Schnapper lors de l’ouverture des rencontres. Ce jour-là, je ne serai pas encore arrivé dans la capitale languedocienne. Je ne suis donc pas fâché de pouvoir méditer sur cette leçon, où la fille de Raymond Aron fournit une sorte de fil directeur pour la réflexion commune. La référence tocquevillienne n’est pas pour étonner, non seulement parce qu’elle est typiquement aronienne, mais aussi parce qu’elle est bienvenue pour éclairer de l’intérieur les difficultés et les paradoxes propres à la civilisation démocratique: « Il n’y a pas de si grand philosophe qui ne croie un million de choses sur la foi d’autrui et qui ne suppose beaucoup plus de vérités qu’il n’en établit (…) Il faut donc toujours, quoi qu’il arrive, que l’autorité se rencontre quelque part dans le monde intellectuel et moral. Sa place est variable mais elle a nécessairement sa place. »
Cette citation tirée de « La démocratie en Amérique » marque la relativité de l’individualisme moderne. Aussi libre et autonome qu’il se veuille, l’individu est contraint de se fier à des autorités investies d’un savoir qu’il ne saurait détenir. On dira que de telles autorités se distinguent de l’ordre des sociétés anciennes parce qu’elles n’ont plus rien à voir en la confiance aveugle en la Tradition et l’obéissance inconditionnée aux pouvoirs sacralisés.
Mais est-on vraiment sûr que la « raison », avec ses exigences de rigueur, préside à toutes les démarches de l’homme moderne? Il suffit d’explorer un peu les curieuses conversations d’internet pour chasser ce genre de préjugé. N’empêche que pour vivre ensemble et faire vivre une communauté plus ou moins vaste, il faut une certaine cohérence intellectuelle et morale. Et la démocratie elle-même est censée reposer sur une sorte de pacte de confiance, sans lequel elle se bloque ou se disloque.
Cela me rappelle qu’Alain Peyrefitte avait fondé toute sa pensée politique sur le concept de « société de confiance » et qu’il en avait exploré toutes les dimensions, depuis sa jeunesse jusqu’à ses dernières années. Il a 22 ans, en 1947, lorsqu’il publie un essai intitulé Le sentiment de confiance. L’année suivante, il dépose en Sorbonne deux sujets de thèse sur « la phénoménologie de la confiance » et « Foi religieuse et confiance ». Mais il faudra attendre 1995 pour qu’il publie la synthèse de ses recherches dans un gros ouvrage qui a été précédé d’une soutenance de thèse devant un jury, où siégeaient notamment Pierre Chaunu et Michel Crozier. (On trouve un résumé de ce parcours dans une conférence prononcée par Michel Albert à l’Académie des Sciences Morales et Politiques lors d’une séance solennelle en date du 17 novembre 2008).
Il est bien intéressant de se référer à Peyrefitte en contre-point des rencontres Pétrarque qui se concentrent sur la crise de défiance des sociétés contemporaines. L’auteur du « Mal français » était persuadé que la confiance était le point de départ de toute organisation sociale et politique. Il insistait aussi sur sa primauté en économie: « La mentalité économique moderne repose sur le crédit, c’est à dire sur la confiance faite par le préteur à l’emprunteur en sa propre capacité de rembourser et sur la rentabilité de l’investissement dont il prend le risque. Ces confiances entrecroisées ont fait jaillir le développement et fondé le monde moderne. » L’économie est reliée ainsi à une dimension anthropologique qui oblige à considérer les relations sociales en amont de l’organisation politique. Si cette dernière est omniprésente au point d’enserrer étroitement le corps social, elle ne le définit pas entièrement pour autant.
J’y insiste, car je réfléchis au sujet, avec une certaine insistance, depuis quelques années. Dieu sait si j’ai toujours été sensible à l’extrême, à la médiation politique, à l’importance des institutions. Cela ne m’a jamais empêché d’affirmer la primauté des relations sociales, celles qui sont les plus caractéristiques de la sociabilité précisément. C’est Philippe Ariès qui m’a particulièrement sensibilisé à cette dimension que je pourrais également référer à ce que Norbert Elias appelait « la civilisation des mœurs ».
Troisième référence, pour préciser encore l’objet considéré: Jean-Claude Michéa fort de l’œuvre et du témoignage de George Orwell: « Il suffit d’observer durant 24 heures la vie quotidienne effective de la majorité des êtres humains – à commencer par leur vie familiale, leur jeux de l’amour et de l’amitié, ou encore leurs relations de voisinage (fondement essentiel de toute sociabilité réelle, notamment dans les quartiers populaires) – pour découvrir que le don, l’entraide, et la civilité continuent de marquer une part non-négligeable des rapports concrets entre les individus. » (Impasse Adam Smith, Climats, 2002). Je n’en démordrai pas, c’est à partir de là qu’il faut envisager l’homme, et non pas à partir des visions démiurgiques de la régénération républicaine et de la fabrication d’un homme nouveau, fût-il issu de l’imaginaire de la propagande publicitaire. C’est ici que nous retrouvons la thématique de la confiance. Je ne crois pas que celle-ci puisse se développer au sein d’un consensus civique global. Elle naît et se développe à partir d’une sociabilité vécue par des gens qui partagent une « commune décence ».
C’est pour moi un problème central de la philosophie politique, car la conception moderne qui met en avant le Contrat social et le Marché se fonde sur le déni de la sociabilité fondamentale et de la civilisation des mœurs. Là-dessus aussi, Michéa énonce des principes essentiels: « Cette double déduction des pouvoirs modernes (celui de l’Etat et celui du Marché) implique une rupture radicale avec les analyses antiques (notamment aristotélicienne) de l’homme comme animal politique. » C’est une option anthropologique. Dans l’état de nature rousseauiste (notion au demeurant extrêmement floue et hasardeuse) l’individu n’a pas de dimension politique, il est livré à ses seules pulsions d’être centré sur lui-même. Ce n’est que le saut révolutionnaire et ontologique du contrat social et de l’entrée dans le Marché qui marque l’avènement politique. Mais, de ce fait, il n’y a pas de raison pour que ne se reproduise, dans d’autres conditions, la guerre de tous contre tous. La monadologie économique des libéraux ne peut que reproduire ou déplacer à un autre niveau les conditions anthropologiques de cette guerre.
Faut-il invoquer Pierre Clastres et sa « société contre l’Etat »? Pourquoi pas, si le recours à l’ethnologie est le seul moyen possible pour sortir l’état de nature de son indétermination et permet de se rendre compte d’un donné anthropologique indispensable à la connaissance de notre essence politique. Il pourrait alors apparaître que la coercition n’est ni le premier, ni le dernier mot de la relation sociale, et que la violence n’est pas non plus la clé universelle dont Max Weber s’emparait pour affirmer que les groupes humains consistent en « un rapport de domination de l’Homme sur l’Homme » fondé sur le moyen de la violence légitime (Le savant et le politique). Bien sûr, il ne s’agit pas de tomber dans l’angélisme et d’ignorer la violence dans l’Histoire ce qui serait aberrant. La question est de savoir, à mon sens, si la violence est primitive, dans cette acception où elle rendrait impossible le lien social naturel qui ne serait que pure fiction, ou si elle est seconde parce qu’elle vient affecter ce même lien social dont est tissé l’humanité. Ce qui renvoie à une énigme métaphysique, celle du mal, qui n’est jamais qu’un défaut ou un manque qui affectent un bien, c’est à dire un être.
On peut donc transposer le débat à propos de la confiance sur ce terrain là. La société de confiance d’Alain Peyrefitte doit s’entendre au sens où, avant toute coercition, les hommes et les femmes forment ces amitiés aristotéliciennes qui définissent beaucoup mieux la relation politique que la coercition étatique. Mais la construction de l’Etat est un fait, largement fondateur et créateur, et les sociétés sans Etat appartiennent à une période révolue. A ce stade, coercition et violence prennent une ampleur nouvelle et de plus en plus redoutable, à mesure que la puissance des appareils centraux s’accroit avec une aire de domination de plus en plus étendue et une concurrence mutuelle, qui, d’après Clausewitz, tend à monter aux extrêmes. Nous sommes entrés dans une logique girardienne, dès que cette violence est omniprésente et que la rivalité mimétique s’inscrit définitivement dans le rapport avec l’autre. Cet autre défini par Carl Schmitt comme l’ennemi.
Cependant l’Etat, sauf s’il se veut théoriquement et pratiquement totalitaire, ne saurait comprendre le corps social en sa totalité. A ceci près qu’il existe toujours une potentialité de plus en plus grande coercition. Voilà qui renvoie à une dimension qui m’a beaucoup occupé cette année, à la suite de l’étude de William Cavanaugh sur « le mythe de la violence religieuse ». Michéa aborde également la difficulté, très explicitement: « Il me paraît difficile de comprendre la configuration des philosophies politiques modernes si on ne prend pas en compte l’effet des guerres civiles religieuses (« le pire des maux » selon Pascal) qui en dévastant l’Europe du XVIe siècle ont ancré dans la vie quotidienne des contemporains la peur et la défiance réciproque. » Cela n’est pas faux, si on y ajoute l’apport de Cavanaugh, selon lequel c’est le politique qui instrumentalise le religieux dans le processus de montée en puissance de l’Etat moderne et du phénomène d’opposition des forces qui la refusent. Il n’en est pas moins vrai que l’effet de division spirituelle est tout à fait redoutable et contribue à étendre le climat de défiance et d’incompréhension dans un tissu social déchiré.
Me suis-je éloigné du thème des rencontres Pétrarque? Oui, sans doute parce que ses organisateurs veulent une approche présente de la défiance à l’égard des institutions. Un détour par les sociétés sans Etat et hors de l’histoire apparaîtrait plutôt décalé. Néanmoins, il y a bien lieu de creuser du côté des dispositions sociales à la connivence, à l’entente et à la solidarité. Celles-ci ne sont pas indifférentes aux dispositions des uns et des autres à l’égard des institutions, même si une distance s’interpose entre ce qu’on appelle la société civile et l’appareil institutionnel. La civilisation des mœurs concerne étroitement ce qu’on entend par démocratie. C’est la thèse de Tocqueville ! Il est vrai qu’il n’avait pas encore – et pour cause – évalué les effets de développement de la participation de l’opinion au travers de l’expansion démesurée de la communication. Cela sera, sans aucun doute, au programme des journées de Montpellier !