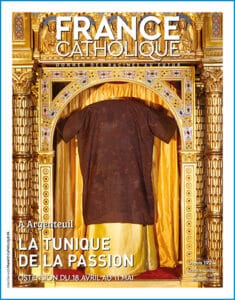29 MAI
Ayant lu, ces temps-ci, quelques livres d’Histoire sur des sujets fort divers, j’ai été envahi du sentiment de la relativité du jugement de l’historien, qui tient d’abord à sa propre situation dans le temps. Voilà qui n’a rien de bien original en soi, et qui se trouve thématisé chez tous les penseurs qui ont tenté depuis bien longtemps de réfléchir au caractère singulier de la connaissance historique. Mais il arrive que ce sentiment atteigne une intensité à donner le vertige. L’intérêt pour une période donnée serait moins polarisé par le désir de s’immerger dans ce qui échappe à la perception directe que par notre disposition intérieure à nous justifier, à mieux tenir prise dans nos convictions par un ancrage qui nous soutient et nous rassure.
Ne suis-je pas prompt à m’emparer d’ouvrages qui confortent des jugements de longue date préétablis et qui ne feront que prolonger un peu plus un parcours apologétique ? Ce qui vaut pour moi, non-historien, s’applique aussi aux professionnels. Il suffit pour s’en convaincre de relire les pages d’Henri-Irénée Marrou (De la connaissance historique, Seuil, 1954), où le caractère existentiel de la discipline est largement reconnu et analysé. Mais Marrou permet aussi de donner des limites à la subjectivité et au souci de s’autojustifier : “Une enquête dominée par l’urgence existentielle, trop axée sur les préoccupations présentes, sur le problème qui se pose, hic et nunc, à l’historien et à ses contemporains, et comme obsédée par la réponse attendue, perd rapidement sa fécondité, son authenticité, sa réalité.”
L’auteur allègue l’exemple du XVIIe siècle, avec les querelles augustiniennes. La volonté de trouver à tout prix des arguments dans saint Augustin, pour contredire l’adversaire et le rendre coi, se fait au détriment du docteur de la foi, qui n’est pas interrogé pour lui-même et se trouve instrumentalisé : “L’Histoire, poursuit Marrou, elle aussi, suppose une attitude intérieure non plus égocentrique, mais centrifuge, une ouverture sur autrui qui exige que nous mettions en quelque sorte la sourdine à nos occupations existentielles.”
Mais à travers l’ascèse d’un désintéressement, c’est bien la personne singulière qui se débat pour mieux saisir le fond des choses : “L’historien ne travaille pas, en premier lieu, ni essentiellement, pour un public, mais bien pour lui-même et la vérité de ses résultats sera d’autant plus passionnément cherchée, plus purement dégagée, plus sûrement atteinte que le problème étudié est bien consciemment, comme nous l’avons montré qu’il l’est toujours, son problème, celui dont dépend en définitive sa personne elle-même et le sens de sa vie.”
La vérification historique passe d’abord par soi-même, au tribunal de sa propre conscience.
Cette image du tribunal, je l’ai spontanément conçue, mais je suis heureux de constater que le grand Mabillon l’utilise pour illustrer sa conception du travail de l’historien : “Comme l’amour de la justice est la première qualité d’un juge, aussi la première qualité d’un historien est l’amour et la recherche de la vérité des choses passées. Un juge est une personne publique établie pour rendre la justice, tout le monde suit son jugement sur les faits qu’on lui met en mains et il est coupable d’un grand crime lorsqu’il ne fait pas son possible pour rendre à chacun ce qui lui appartient. C’est aussi l’obligation d’un historien, qui est une personne publique, sur laquelle on se repose pour examiner les faits de l’Antiquité. Comme tout le monde n’a pas le temps de les examiner, on s’en rapporte au jugement qu’il en fait et il trompe le public, s’il ne fait pas toutes les diligences possibles pour former un juste jugement des choses.” (Mabillon, Brèves réflexions sur quelques règles de l’Histoire).
Je tire cette citation d’un beau volume de la collection “Bouquins”, de Robert Laffont, qui vient d’être publié : Le moine et l’historien, Dom Mabillon, œuvres choisies, précédées d’une biographie, par Dom Henri Leclercq. Cette édition a été établie par Odon Hurel, qui s’occupe du Centre européen de recherches sur les congrégations et ordres religieux. C’est dire qu’on a toutes les garanties de sérieux scientifiques et d’érudition. Il n’est pas inutile d’ajouter que c’est l’écrivain Daniel Rondeau, qui dirige la collection “Bouquins”, ce qui m’inspire un soupçon très précis.
Daniel Rondeau est, en effet, l’ami de longue date du Père Serge Bonnet, cet étonnant fils de saint Dominique, qui fut, je crois, de la même année de noviciat que le Père Bernard Bro. Retiré aujourd’hui dans sa chère Lorraine, ce religieux éminent, est aussi un érudit qui, à sa manière, a poursuivi la tradition des bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. N’a-t-il pas réalisé, avec son histoire de la Sidérurgie lorraine, un monument de facture originale qui nous a changé des problématisations marxisantes ? Il s’est fait connaître aussi par sa prédication très remarquable et son attachement à la religion populaire à un moment où elle était décriée, moquée et éradiquée.
Mais si je pense à lui en ce moment, c’est à cause de Mabillon et d’un court entretien qu’il avait donné, il y a peut-être vingt ans et plus, au Nouvel Observateur. J’avais été médusé par la force du portrait qu’il avait fait du moine de Saint-Germain des Prés. J’avoue que la station de métro Mabillon et le restaurant universitaire du même nom n’avaient suscité jusqu’alors en moi que de vagues notions. C’est la publication de la thèse de Blandine Kriegel, sur Les historiens et la Monarchie (Presses Universitaires de France) qui répondit plus tard à ma curiosité. L’extraordinaire évocation qu’elle fait de Mabillon est, à elle-seule, un hommage qui se grave dans la tête du lecteur.
J’ai aussi le souvenir d’avoir parlé de cette évocation au Père Bonnet lors d’un colloque organisé par Rémy Montagne à l’abbaye royale de Royaumont. Il me dit illico son admiration pour ce travail qui répondait à son vœu ancien d’un bon livre sur l’auteur de la Diplomatique. […]
Je ne peux m’empêcher de mettre en relation Daniel Rondeau et Serge Bonnet pour la publication de ce volume qui a d’ailleurs des précédents. C’est au même éditeur qu’on doit la publication des deux volumes du magistral Port-Royal de Sainte-Beuve. Encore le Grand Siècle, suffisamment vaste pour que des aventures intellectuelles et spirituelles s’y déploient parallèlement sans vraiment interférer. J’ai vainement recherché dans l’index des noms du Mabillon, des références aux personnalités de Port-Royal.
Et pour revenir à Daniel Rondeau, qui signe la présentation de quatrième de couverture, il me faut préciser que cet écrivain, qui ne cache pas sa foi, vit habituellement dans une ferme champenoise, non loin des origines ardennaise de Dom Mabillon. Après un engagement gauchiste qui correspondit à la flamboyance soixante-huitarde, et qu’il assuma d’ailleurs avec générosité, il devait se mobiliser pour la sauvegarde du Liban et d’autres causes, tout en poursuivant une œuvre de belle ampleur. Quand il m’arrive de lui parler – trop rarement – c’est lui qui, toujours, me rapporte fidèlement des nouvelles du cher Père Serge Bonnet. Mais puisque c’est Mabillon qui est à l’origine de cette réflexion, je reprendrai les deux dernières phrases de la couverture : “Les cendres de Mabillon unies à celles de Descartes ont été déposées dans une tombe scellée dans un mur de l’église Saint-Germain des Prés. Le visiteur peut le lire sur une plaque de marbre noir, située, dans la deuxième chapelle absidiale”. (Cela me rappelle que, je me suis recueilli, dans la même abbatiale, sur la tombe d’un ancien roi de Pologne, Jean-Casimir, qui termina ici son existence comme moine…)
30 MAI
Je n’ai pas dit le point de départ de ma perplexité existentielle sur l’Histoire. Il se trouve qu’on m’a demandé de participer à un ouvrage collectif sur la Révolution française et que j’ai eu la faiblesse d’accepter. Non historien, je ne puis qu’alléguer ma passion pour l’Histoire où je ne m’aventure pourtant qu’avec précautions. Au moment du bicentenaire, en 1989, j’ai beaucoup travaillé sur la décennie révolutionnaire, au point de constituer un embryon de bibliothèque qui ne saurait rivaliser avec la documentation des spécialistes, mais doit rassemble tout de même, quelque 200 volumes. Avec l’accumulation des piles qui effraient plus d’un maniaque du rangement, ces rayons ont été recouverts d’autres livres aux sujets les plus divers et qui masquent presque complètement ce qui fut la passion d’un moment. J’ai même eu un projet de livre largement amorcé avec une centaine de feuillets dactylographiés qui doivent se trouver je ne sais où dans mes dossiers.
C’est un peu ce travail qui retrouve brusquement un intérêt avec l’étude demandée. Du coup, j’ai extrait un volume qui n’avait pas bougé depuis une vingtaine d’années et qui m’avait intrigué au moment de sa parution. Je l’ai mentionné ici il y a quelques jours, mais cette fois, je l’ai repris complètement, ce qui me permet de comprendre l’importance que je lui avais donnée en son temps. Serge Bianchi, en composant La Révolution culturelle de l’An II (Aubier, 1982) avait forcément en point de mire, la révolution culturelle entreprise en Chine par Mao Tsé Toung. D’ailleurs l’auteur établit un lien explicite entre le bref et intense moment qu’il restitue et l’avenir, en reprenant la formule d’un personnage de la conspiration des Egaux : “La Révolution française n’est que l’avant-courrière d’une autre révolution… qui sera la dernière”.
Et Bianchi de noter : “L’expression révolution culturelle n’apparaît qu’au vingtième siècle pour qualifier les mutations des révolutions contemporaines. Lénine estime, en 1922, qu’une révolution culturelle est indispensable pour fonder les révolutions politiques et sociales de l’URSS. En 1965, débute la révolution culturelle chinoise”. C’est donc une dénomination postérieure qui permettra de qualifier a posteriori la période intense que décrit notre historien, avec la claire volonté de la réhabiliter à l’encontre d’une tradition historiographique qui l’aurait déformée et vilipendée. Le premier responsable en serait Hypolite Taine dont Les origines de la France contemporaine, rédigées entre 1876 et 1893, sous le choc de la Commune, auraient fait école “malgré le caractère polémique et circonstanciel de son œuvre”.
Je dois dire qu’en dépit de mon désaccord total avec Serge Bianchi, je lui suis reconnaissant de son livre, à cause de la cohérence de son explication et de la sincérité de son engagement. Le point de vue bienveillant a ce mérite de nous faire entrer dans la tête des acteurs, pour comprendre ce qui les faisait agir et le type de société qu’ils convoitaient. De plus, à un quart de siècle de distance, nous pouvons aussi comprendre comment des jeunes gens formés à l’école communiste pouvaient se fonder sur un modèle pour développer leur idéologie et leur programme politique. C’est la période d’avant François Furet, où domine encore un classicisme universitaire, que seuls les réactionnaires à la Gaxotte osent vraiment mettre à mal. Il y a une thèse qui est transmise aux générations et que le marxisme-léninisme a acclimatée avec son arsenal intellectuel.
La révolution française demeure inachevée. Elle a proposé aux peuples du monde un modèle qui n’a pu s’établir durablement mais qui demeure comme seul accomplissement de l’histoire progressiste.
Ma petite bibliothèque en fait foi : la projection de l’espérance révolutionnaire durera jusqu’à ces années 70 et même 80 où elle devra céder à une autre école qui refusera la logique terroriste inhérente au processus absolu de la Révolution. A ce moment, Albert Soboul pouvait reprendre encore les mêmes motifs que son prédécesseur, Albert Mathiez. Pour ce dernier, les thermidoriens, avec l’exécution de Robespierre, avaient enterré pour un siècle la République démocratique. Soboul remarque que, malgré son échec final, la tentative de l’An II, a pris valeur d’exemple et anticipe sur l’avenir. Ce que croyait aussi fermement un Ernest Labrousse. “La République égalitaire demeura du domaine des anticipations, Icarie jamais atteinte, mais toujours poursuivie”.
Le même Soboul s’était distingué par une étude très approfondie du phénomène des sans-culottes avec son livre paru en 1968, à l’heure où il domine encore les études historiques en Sorbonne. Ces sans-culottes sont la préfiguration du prolétariat révolutionnaire, parce qu’ils constituent, à côté des élites bourgeoises qui mènent la révolution, une catégorie originale qui veut aller jusqu’au bout de la transformation absolue qu’exige la passion de l’égalité.
Ce sera cette formation sociale originale qui sera la plus cohérente, la plus résolue. Et voudra l’éradication totale de l’ordre ancien, notamment religieux. C’est pourquoi l’entreprise de “déprêtrisation” est si essentielle. Il faut arracher le pays au catholicisme, voire au christianisme, en prenant les moyens ad hoc. La déprêtrisation, c’est l’exigence où se perdront les marques de l’ordre le plus ancré dans les mentalités. C’est pourquoi, un Serge Bianchi, dresse le tableau sans trembler. Il fallait que rien ne subsiste du christianisme pour que naisse au forceps le monde nouveau.
Depuis 1982, sa bibliographie atteste qu’il a poursuivi sa tache en tournant autour des mêmes sujets en dépit du retournement imprimé par François Furet et ses amis. Mais il est remarquable que cette révolution culturelle demeure dans la mémoire commune comme enfouie, indicible. Les rappels fréquents à l’esprit républicain, au culte de la République, récurrent dans la rhétorique actuelle, sont toujours exclusifs de ce moment qui était considéré par les purs des purs comme le joyau de la Révolution. Il faut à la fois s’en féliciter et s’en inquiéter. Se féliciter que la République se ramène à la recherche du bien commun et de quelques précieuses vertus civiques. S’inquiéter d’un non-dit qui ne permet pas de comprendre l’anti-christianisme récurrent qui rejoint un passé que l’on n’ose plus évoquer pour lui-même.
2 JUIN
J’avais lu diverses recensions sur l’essai de Paul Veyne Quand notre monde est devenu chrétien (312-394) (Albin-Michel). Mais j’ai regretté de ne pas l’avoir lu plus tôt quand je me suis plongé dans cette étude passionnante. Je savais déjà l’originalité et l’acuité de l’historien. Son portrait de Constantin m’a persuadé un peu plus de ses mérites, ne serait-ce qu’en réhabilitant pour moi ce grand empereur dont les études anciennes m’avaient donné une idée ambiguë. C’était à un tel point que j’éprouvais de la gêne à le voir canonisé – et de quelle façon ! – par mes amis orthodoxes. N’avait-il pas été baptisé in extremis, in articulo mortis, et son soutien indéniable à la nouvelle religion n’était-il pas fondé d’abord sur des intérêts politiques ?
Paul Veyne m’a convaincu de la sincérité de sa conversion et de son adhésion profonde, qui ne souffre aucune suspicion, à la substance même de la foi. Je me rends compte que ceux qui m’ont enseigné l’Histoire des premiers siècles chrétiens étaient imbus d’une opinion largement partagée par des gens très sérieux, qui croyaient que Contantin était “un pauvre homme qui tâtonnait” et qui “confondait le Christ et le Soleil invincible, dieu impérial”. Paul Veyne démontre qu’il n’en est rien. Qu’il s’agit d’un très grand empereur, et qu’il avait la conception la plus orthodoxe qui soit du christianisme : « Ce n’est certes pas un grand théologien, les querelles christologiques lui semblent byzantines avant la lettre, et ne font à ses yeux que diviser inutilement le peuple chrétien. Mais il ne faudrait pas l’avoir lu pour voir en lui un “syncrétiste” qui avait mêlé le Christ avec Apollon ou avec le Soleil, dont il ne prononce jamais le nom, sauf pour dire que le soleil, la lune, les astres et les éléments sont gouvernés par le Dieu tout puissant. »
3 JUIN
L’admiration de Paul Veyne pour Constantin est égale à celle qu’il éprouve pour ces chefs-d’œuvre que constituent à ses yeux le christianisme et l’Eglise. Pour les gens de ma génération qui furent assommés de réquisitoires contre le constantinisme et l’Eglise constantinienne, c’est plutôt rafraîchissant. Toutefois, l’historien affirme aussi que la supériorité de la nouvelle religion par rapport à toutes les autres n’aurait pu, à elle seule, faire basculer la population de l’Empire romain : “Telle fut l’histoire de la christianisation : seule une autorité extérieure a pu faire supplanter une coutume par une autre coutume. Par là, le rôle de Constantin a été décisif.” On voit bien la polémique se réengouffrer. L’Empire chrétien met sa puissance de coercition morale du côté de l’Eglise désormais associée au pouvoir et à tous les débordements dénoncés à l’aune du triomphalisme et du cléricalisme ressurgissent.
Seulement, ce n’est pas si simple. Paul Veyne insiste aussi sur les qualités spécifiques d’une religion que rien n’égale et je suis assez ébloui par sa culture chrétienne. Il n’est pas courant aujourd’hui de trouver des intellectuels non chrétiens familiers du cardinal Newman et de l’abbé Brémond, et qui défendent la spécificité du sentiment religieux, irréductible à ce à quoi certaines philosophies voudraient le réduire, comme la peur de la mort. Le paradoxe veut pourtant que cet admirateur sincère et passionné du christianisme soit en même temps un moderne qui a fait son deuil de la foi. Et puis il y a deux parties dans son livre : ce qui concerne Constantin et l’avènement du christianisme, ce qui concerne le temps présent avec un refus explicite de la notion de « racines chrétiennes de l’Europe ».
Une discussion serrée s’imposerait pour répondre aux objections de Paul Veyne, qui ne sont pas mineures. Par exemple, cette affirmation tranchante : « Plutôt que de servir de matrice à l’universalisme des droits de l’homme, saint Paul a mis de l’huile dans les sociétés inégalitaires : sur les bancs d’une église, les petits sont égaux aux grands (sauf si la modestie sociale ou l’humilité chrétienne les font s’y placer au dernier rang). » Ainsi, le christianisme ne serait pas pour grand-chose dans les exigences modernes d’égalité et de justice. La preuve : il n’a pas changé fondamentalement les rapports inégalitaires du monde où il a déployé son message. Au Moyen Age, chrétienté et brutalité font bon ménage en dépit des injonctions des béatitudes. Et de citer Marc Bloch : « Durant l’ère féodale, la foi la plus vive dans les mystères du christianisme s’associa sans difficulté apparente avec le goût de la violence ».
Paul Veyne reprend ainsi tout ce dont on crédite le christianisme en fait d’universalisme, d’individualisme, pour le relativiser, ou l’édulcorer en dénonçant l’illusion de la fondation ou des racines. Il privilégie la différence, l’évolution, et même la mutation radicale. La modernité n’est pas fille de saint Paul ou des Evangiles, mais de Kant et de Spinoza, ce qui aboutit à cette proposition : « Ce n’est pas le christianisme qui est à la racine de l’Europe, c’est l’Europe actuelle qui inspire le christianisme ou certaines de ses versions. Etranges racines qui se confondent avec la croissance de la tige Europe, se transforment avec elle ou même cherchent à ne pas être en retard sur elle. Aussi bien la morale que pratiquent aujourd’hui la plupart des chrétiens ne se distingue-t-elle pas de la morale sociale de notre époque (Anatole France en souriait déjà) et de son recours à la contraception (Baudelaire en ricanait déjà). »
Si Paul Veyne n’était pas féru sérieusement de culture chrétienne, ces remarques critiques toucheraient moins. Venant d’un anticlérical borné, d’un contempteur du religieux par principe, elles glisseraient sans guère de conséquence sur le cuir un peu tanné du combattant. Mais formulées de façon si souriante, elles atteignent forcément des défenses plus profondes ou sollicitent une réflexion sur le développement historique qui demande un échange sur le terrain qu’il a choisi. Car ce ne sont même pas les Lumières (malgré Kant et Spinoza) qui barreraient toute influence déterminante des origines chrétiennes, mais la nature même de l’évolution historique : la plante historique ne continue pas ses racines, ne développe pas ce qui aurait été préformé dans un germe, mais se constitue au fil des temps par degrés imprévisibles.” La notion d’épigenèse rendrait compte de cette imprévisibilité qui exclut développement homogène à partir d’une structure préformée. Expliquer le développement du monde moderne à partir d’un programme génétique chrétien serait donc irrecevable. Les choses ne se passent pas comme cela. Une multitude de facteurs interviennent, dont la religion qui n’est qu’un agent parmi d’autres et qui n’a d’efficace que lorsque les autres données lui permettent de se déployer : Schumpeter disait que si la guerre sainte avait été prêchée aux humbles pécheurs de Galilée, et le sermon sur la Montagne à de fiers cavaliers bédouins, le prédicateur aurait eu peu de succès”.
Voilà qui a au moins le mérite du non-prêt à penser et qui prend à rebrousse-poil les préjugés et les schèmes explicatifs trop évidents et faciles. Il m’est arrivé, alors qu’on m’avait demandé des exposés sur les racines chrétiennes de l’Europe – l’un dans une salle prestigieuse de l’Assemblée nationale – de me montrer très critique à l’égard de cette notion à cause de la métaphore biologique qu’elle inclut et qui ne me semble pas adéquate à la nature de la question posée. Sans partager le relativisme généralisé de Paul Veyne, il faut convenir d’une complexité causale de l’Histoire où l’influence religieuse n’est pas déterminable aisément. De plus, la question se reformule sans cesse, d’époque en époque, obligeant l’instance religieuse à se redéployer autrement ou à réagir selon d’autres stratégies.
Mais globalement je ne puis suivre Paul Veyne dans sa démonstration. Oserait-il dire qu’il n’y a pas une civilisation islamique dont le message du Prophète est intégralement responsable ? Pourrait-il parler des civilisations d’extrême-Orient sans se référer longuement à leurs religions et à leurs sagesses ? De l’Afrique noire sans l’animisme ? On dira que l’Europe constitue une exception à cause des processus de désenchantement du monde. Mais même en ce cas, comment ne pas tenir compte de la thèse de Marcel Gauchet sur la religion de la sortie de la religion et d’une absence de religion (relative) qui s’explique par le caractère émancipateur du christianisme. Enfin, j’ai l’impression qu’il y a deux thèmes qui coexistent chez Veyne et ne marchent pas forcément en totale solidarité. Celui de la relativité du facteur religieux et celui de la coupure rationaliste qui a créé une réalité sans rapport avec ce qui avait précédé. En ce cas, il y aurait une contradiction non dénouée à propos du rôle mineur ou majeur de la sphère idéologique dont par ailleurs il conteste l’autonomie.
5 JUIN
Jean-Marie Lustiger (suite).
Quand une personnalité aussi exceptionnelle est sur le point de franchir le grand passage, c’est bien sûr un arrachement pour tous ceux qui sont attachés à sa présence « insubstituable ». Mais il y a aussi l’idée que quelque chose de supérieur est en train de s’accomplir. A fortiori s’il s’agit d’un homme de Dieu. Je ne puis qu’être discret sur ces jours dont les témoins sont si touchés, mais il m’est impossible de ne pas sans cesse penser à tout ce que Jean-Marie Lustiger nous a apporté. Je suis beaucoup sollicité, de la part des collègues – certains trop jeunes pour l’avoir connu dans son ministère pastoral. Un souvenir en appelle un autre, enfoui au creux de la mémoire. Ainsi mes conversations avec le cardinal de Lubac où le nom de l’archevêque de Paris revenait souvent. Je prends la liberté de raconter ici ce que m’a rapporté un familier du théologien sur l’impression que fit sur ce dernier la nomination à Paris de Jean-Marie Lustiger.
Ceux qui connaissent un peu la vie d’Henri de Lubac savent qu’il y a eu deux périodes douloureuses pour lui. D’abord celle où il fut écarté de tout enseignement à cause des suspicions qui entouraient son livre Surnaturel. Ce fut très dur, pour ce religieux si fidèle et si attaché au mystère de l’Eglise, d’être mis à l”écart par ses supérieurs. Les historiens ont déjà abondamment travaillé sur ces années 50 et l’affaire dite de “la nouvelle théologie”, expression que lui-même récusait. Mais les mêmes historiens ne se sont pas encore intéressés à la période post-conciliaire qui fut encore bien plus éprouvante pour celui qui avait tellement servi les Pères de Vatican II dans leur élaboration doctrinale. Très vite il eut le sentiment d’un immense naufrage pour l’Eglise et pour la foi. Ses proches ont alors assisté à une sorte d’entrée dans la nuit où toute consolation humaine lui semblait refusée. Son impuissance à empêcher quoi que ce soit, la sensation de la vanité de toute résistance et, surtout, à vue prochaine, l’improbabilité d’un sursaut possible furent tellement accablants pour son esprit qu’aucun de ses proches ne parvenait à le sortir de sa tristesse. Pourtant il y avait eu l’élection de son ami Karol Wojtyla au siège de Pierre qui avait tout pour le réconforter. Mais cela n’avait pas atteint son environnement et il avait au contraire la certitude d’une sourde hostilité au nouveau pape, qui empêchait le déblocage de la situation. Aussi, quelle ne fut pas la surprise d’un de ses confrères de le retrouver un matin transfiguré et comme surgi d’un gouffre : “Votre ami Jean-Marie Lustiger vient d’être nommé par le Pape archevêque de Paris !” Le confrère jésuite connaissait de longue date le nouveau promu. Cette nouvelle à elle seule avait provoqué la métamorphose d’Henri de Lubac. C’est dire à quel point il estimait le père Lustiger et considérait que sa nomination à Paris était le signe le plus sûr d’un renouveau. Le Père Georges Chantraine, qui travaille depuis de longues années sur la biographie de son illustre maître, nous apprendra certainement beaucoup sur cette période que je ne puis qu’évoquer. Mais l’anecdote à elle seule me paraît significative de l’importance considérable de la décision de Jean-Paul II en 1981.
6 JUIN
Justement, la réédition par Ad Solem du célèbre ouvrage de Jacques Maritain, Le paysan de la Garonne, permet de revivre d’une façon très aiguë la crise qui frappa si fort le Père de Lubac. Les deux hommes n’étaient pas exactement sur la même longueur d’onde pour des raisons que je ne puis exposer ici en détail. On dira que l’un était thomiste de stricte observance et que l’autre était blondélien, ce qui est assez exact mais ne saurait nous dissimuler la dépendance du jésuite à l’égard de saint Thomas d’Aquin. Il y avait aussi le cas Teilhard de Chardin qui, dans ces années 60, constituait une source de querelles infinies. Charles Journet, le grand ami et confident de Maritain, s’était lancé dans une sévère croisade anti teilhardienne et ce dernier l’avait vigoureusement appuyé dans Le Paysan. Lubac ne pouvait qu’en être blessé, lui qui avait mis toute son énergie à défendre l’orthodoxie de l’auteur du Phénomène humain en le restituant à la continuité de la Tradition. Par ailleurs, il voulait absolument distinguer Teilhard d’un certain teilhardisme qui constituait une idéologie pernicieuse, parasitaire par rapport à l’œuvre et à son intention théologique et mystique.
Que Maritain considère Teilhard comme le symbole même de la dérive doctrinale qui atteignait le corps ecclésial, le contrariait d’autant plus qu’il pensait au contraire que c’était une meilleure compréhension de Teilhard qui pouvait ramener à la substance vive de la tradition en répondant à toutes les requêtes intellectuelles qui alimentaient la crise généralisée. C’est dire la situation singulière de deux hommes qui sont à la fois profondément d’accord, et en désaccord, et à qui il est difficile de s’expliquer mutuellement, tant leurs différences plongent dans un passé compliqué où les positions des écoles, les sensibilités, les amitiés créent des incompatibilités que seul l’amour de l’Eglise permet de surmonter.
Je me réfère ici au dossier critique qu’a joint à la réédition du Paysan de la Garonne (avec le titre qu’avait préalablement envisagé Maritain : Le feu nouveau) l’universitaire Michel Fourcade. C’est un véritable essai de 150 pages qui fait le point exact du retentissement du livre et des réponses suscitées par la provocation du philosophe. Si j’y distingue ce qui concerne Lubac, ce n’est pas que je dédaigne le reste, (bien au contraire car il y a des merveilles comme par exemple un petit texte de notre ami René Pucheu), mais à cause de l’intérêt particulier du choc de deux personnalités et de leur différence foncière d’analyse d’un phénomène passionnément scruté par l’un et l’autre. D’une certaine façon, Lubac croit que les choses sont beaucoup plus graves que ne le dit Maritain, et il est beaucoup plus en colère que lui. Je force un peu le trait, mais je ne pense pas être loin du compte. Quand le philosophe cite le proverbe chinois dans l’entête de son livre – “Ne prenez pas la bêtise trop au sérieux” – il donne à penser que, dans la crise qu’il décrit, c’est la bêtise qui a le dessus et que l’on a pris trop au sérieux des gens qui ne répandaient que sottise et folie. Le remède est donc de se remettre à bien penser, à l’école du Docteur commun, seul capable de nous guérir des systèmes actuels qui ne sont que des « idéosophies ».
Bien sûr, il y a aussi des fautes de mystique, pour employer le langage de Péguy, qui défigurent l’Evangile et l’Eglise, et qui relèvent des affaires du royaume de Dieu. Dans ce registre-là, il me semble que Maritain et Lubac sont plus proches. N’en subsiste pas moins l’opposition sur le fond de l’analyse. Pour le théologien, ce n’est pas question de bêtise, mais d’apostasie. Ce n’est pas un simple redressement intellectuel qui nous en sauvera. La foi de l’Eglise est seule en cause, car la conscience catholique est sur le point de faire naufrage. Elle se coupe “de tout ce qui la nourrissait, elle s’étiole et se trouve ainsi livrée, vide, démunie, à toutes les sollicitations du dehors. Elle ne sait plus se voir que dans l’idée que se fait d’elle un monde incroyant”. Ce n’est donc pas saint Thomas seul qui est oublié, c’est le christianisme lui-même qui devient obsolète et s’évanouit dans “un vertige collectif”. Les idéosophes ne sont pas innocentés, ils sont englobés dans le mouvement généralisé d’auto-reniement.
(à suivre)