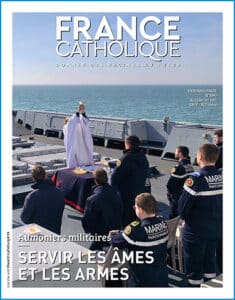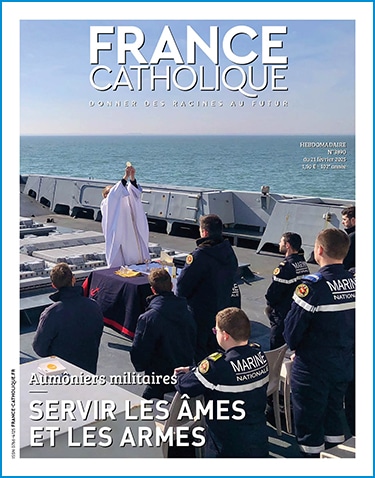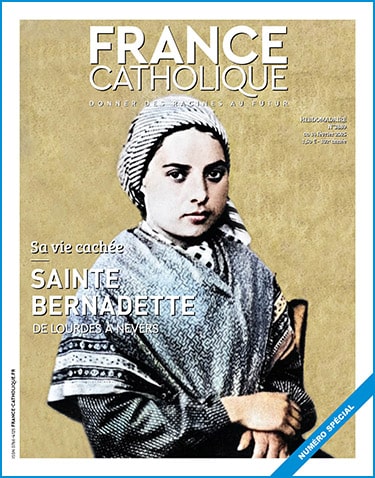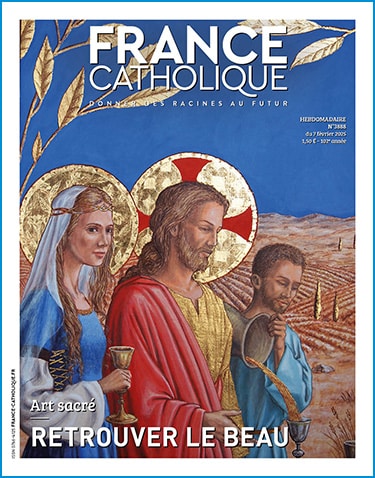Extrait du chapitre 6 « Pensée animale » de La Clarté au cœur du labyrinthe, pp. 175 à 177
« Cela crie, mais cela ne sent pas » (a)
C’était à Seewiesen, chez Konrad Lorenz (b), l’un des sages de ce temps. Accoudés à son balcon, nous parlions du fameux coup de pied de Malebranche à sa chienne et du commentaire, non moins fameux, du philosophe : « Cela crie, mais cela ne sent pas. » Sous nos yeux, l’admirable paysage bavarois où se cachent les laboratoires de l’Institut Max-Planck, l’étang, la forêt prenant ses teintes d’automne.
– Ce qui est sûr, disait Lorenz, c’est qu’il y a des coups de pied qui se perdent, et qu’une certaine forme d’intelligence conduit tout droit à l’imbécillité. Quoi, cela ne sent pas ? Et toi, pauvre homme bourré de syllogismes, quelles preuves me donneras-tu de ta douleur si je te frappe ? Tes cris ? Et pourquoi les tiens exprimeraient-ils quelque chose, et ceux de ta chienne, rien ? Tes protestations, ton éloquence à me convaincre que tu souffres ? Alors, accorde au Chinois qui ne comprend rien à tes protestations le droit de te traiter toi-même comme un chien. »
La douleur se prouve-t-elle ?
Je cite de mémoire, n’ayant pas enregistré ces paroles. Mais je me rappelle parfaitement leur sens. « Si je crois, me disait Lorenz, à la réalité de votre douleur (comme aussi à celle de votre plaisir et de vos sentiments), c’est uniquement par analogie, parce que je vous vois extérieurement très semblable à moi et que je ne suis pas libre de douter de ma douleur, de mon plaisir et de mes sentiments. Mais je vous défie bien de me fournir la preuve objective que j’ai raison de croire à cette analogie. Cela a été clairement démontré par les philosophes idéalistes des deux derniers siècles : certes, le solipsisme fait partie de ces absurdités irréfutables auxquelles, Dieu sait pourquoi, aboutit toujours l’exercice systématique de la raison quand il n’est pas contrôlé par l’expérience.
– C’est vrai, je ne peux pas, je ne pourrai jamais prouver que si la chienne de Malebranche criait sous les coups de pied du philosophe, c’était de douleur. Mais enfin, nous autres biologistes sommes bien aise de pouvoir croire à cette douleur improuvable. Et les philosophes, même idéalistes, sont bien aises pour soulager une douleur dont ils ne peuvent douter, d’admettre sans façon, et sans attendre la réfutation du solipsisme, que nous autres biologistes avons raison de croire à la réalité de la douleur animale. Car, c’est en étudiant sur l’animal les concomitances observables de la douleur que nous découvrons les moyens d’épargner la souffrance humaine. »
La conversation ayant pris alors un autre cours, je ne peux dire de quels exemples Lorenz aurait illustré cette idée de la souffrance humaine soulagée par l’observation de la souffrance animale. Mais il n’y a que l’embarras du choix.
C’est par l’expérimentation animale que sont d’abord étudiées toutes les substances présumées analgésiques. Quand un chimiste découvre une formule dont on peut espérer qu’elle soulagera la douleur, c’est sur des animaux qu’on l’essaie d’abord. Et quand la chienne de Malebranche traitée à la substance en question cesse de manifester son improuvable douleur, le biologiste passe outre à l’indémontrabilité et admet que la substance est bel et bien analgésique pour l’animal. Il en déduit toujours une présomption d’efficacité sur l’homme : « Puisque ça marche sur le chien, il y a un bon espoir que ça marchera sur l’homme. »
Et la plupart du temps, en effet, « ça marche ». La substance qui rend la chienne indifférente aux coups de pied du philosophe soulage aussi le philosophe de sa rage de dents. Ce n’est pas une preuve philosophique, mais enfin le philosophe règle sans discuter la note du pharmacien et retourne, l’âme en paix, à ses méditations sur le solipsisme. À cela on objecte généralement qu’il y a douleur et douleur, et que celle d’un être hautement conscient comme l’homme est d’une nature différente.
Une mesure obscure
On peut aborder cette objection de plusieurs biais, tous malheureusement invérifiables par l’expérience. Ayant grandi dans une ferme et observant les bêtes avec un peu plus de méthode depuis quelque quinze ans, j’ai acquis la conviction que le désespoir de la vache à qui l’on prend son veau, cela existe, quoique la vache beugle stupidement ce désespoir pendant des jours et des nuits et que les grandes douleurs, paraît-il, soient muettes.
De plus, est-on bien sûr que cette mesure que l’on fait de la douleur à l’aune de la conscience ne comporte aucune obscurité ? Et que, par exemple, la douleur de l’enfant soit moins profonde ? Que chacun réponde à cette question selon son cœur. Quant à moi, si mon passage dans ce monde me donna jamais quelque idée de l’enfer, ce fut vers l’âge de cinq ans, et toute douleur depuis ne m’est apparue que comme une pâle réminiscence de cet âge qui n’était pas encore de raison (c).
Mais voici qui est moins subjectif. La drogue, en ces années 70, nous obsède. Que la chimie agisse sur la pensée, c’est effrayant. Mais enfin, elle agit. Elle agit sur la pensée.
En ce moment même, aux États-Unis, une équipe de chercheurs (P. N. Witt et ses élèves) étudie les effets des drogues psychotropes sur des araignées. Les araignées « pensent-elles » ? Sont-elles douées d’une « conscience » ? Laissons ces questions profondes et obscures et ne retenons que les faits : les araignées droguées montrent dans la confection de leur toile des désordres de même nature et parfois identiques à ceux que l’on observe dans l’activité intelligente de l’homme drogué.
Quand l’araignée délire
La caféine provoque une espèce de désordre enthousiaste, la mescaline inhibe la coordination (chez l’homme on dit la coordination « des idées » ; chez l’araignée, on dit « de l’activité ») ; l’adrénochrome inhibe l’intégration (l’intégration de quoi ? c’est de plus en plus embarrassant). Le LSD, enfin, provoque « un délire logique » : l’araignée est schizophrène ! Rien de tout cela ne prouve rien.
Ce ne sont que de pauvres faits. Mais, pour s’en débarrasser, un coup de pied ne suffit plus. S’il existe dans cet univers mystérieux quelque chose de spécifique appelé douleur, nous n’en avons pas, si l’on peut dire, le privilège. Ce quelque chose est aux sources même de l’être. Et notre douleur à nous n’en est qu’un fugitif écho (d).
Aimé MICHEL
Notes de Jean-Pierre Rospars (les références renvoient à La Clarté…)
* Chronique n° 10 – F.C. – N° 1251 – 4 décembre 1970
(a) Ce texte, ainsi que Ce que je voudrais dire au grand corbeau un peu plus loin dans ce chapitre, qui traitent de la conscience chez les animaux, sont en continuité avec ceux du chapitre 9 sur la conscience humaine et ils s’éclairent mutuellement. Ce chapitre, comme presque tous les autres, présente des faits scientifiques avec une visée philosophique : c’est à la fois une introduction à l’éthologie et une prise de position ferme sur la réalité de la conscience animale, avec toutes ses conséquences éthiques et théologiques (voir note 221, p. 193). Aimé Michel est ici, comme à son habitude, en conflit avec les idées dominantes : dans les années 70 (et avant) c’était un sujet mal venu pour les scientifiques, tenu pour puéril ou marginal par les philosophes et minimisé par les théologiens. Elle est devenue depuis peu un sujet respectable, si on en juge par les livres de Joëlle Proust (Comment l’esprit vient aux bêtes, Gallimard, 1997), Dominique Lestel (Les origines animales de la culture, Flammarion, 2001) et Marc D. Hauser (À quoi pensent les animaux, Odile Jacob, 2002), pour n’en citer que quelques-uns. Avec la reconnaissance de l’étendue de notre ignorance sur la question animale, c’est un obstacle séculaire bloquant la recherche en ce domaine qui vient d’être franchi.
(b) Konrad Lorenz (1903-1989), un des créateurs de l’éthologie, reçu le prix Nobel en 1973 avec Niko Tinbergen et Karl von Frisch, voir la dernière chronique du chapitre 6, L’homme qui parlait aux oiseaux : adieu à Lorenz, p. 195.
(c) Voir la chronique Je vous salue Marie : le miracle secret, p. 735.
(d) Le mot « douleur » est l’un de ceux qui reviennent le plus souvent sous la plume de l’auteur (voir l’index). On pourrait tenter d’organiser autour de cette notion de larges pans de sa pensée. Pour Aimé Michel, la douleur est l’exemple le plus parfait de ce que les philosophes appellent les qualia, les qualités sensibles, comme la noirceur (vision), la douceur (toucher), la stridence (audition), la fétidité (odorat), le sucré (goût), le chaud, le froid etc., qui sont la manifestation dans la conscience de phénomènes physico-chimiques étudiés par la science tels que les ondes sonores et lumineuses, les molécules et leur agitation etc. (voir chap. 9). Partant d’observations communes (« Il n’y a de douleurs et de plaisirs que de l’âme », p. 262 ; « Toute douleur (…) est impartageable », p. 745), il en tire les conséquences épistémologiques (« Il n’existe et il ne saurait exister aucune preuve testable de votre prétendue douleur », p. 249 ; « Ce qu’il y a de plus vrai, de plus profond, de plus certain en ce monde est par essence réfractaire à la mesure », p. 619 ; « Ce fait extraordinaire, que l’on appelle la conscience, n’a pas de place dans la science », p. 646) et techniques (« Tout ce que je fais (…) pourra être fait bientôt (…) par les super-moulins à café que les informaticiens commencent d’entrevoir dans leurs plans. Seule petite différence : ces machines ne sentiront rien, aucun plaisir, aucune douleur (…) », p. 274). Il en évoque les dimensions cosmique (« Ce quelque chose est aux sources même de l’être », ci-dessus ; « Si la douleur n’existait pas dans ce monde, ou si elle cessait d’y exister, ce serait sûrement le changement le plus profond qu’il puisse subir », p. 257 ; « Pour qu’un monde existe où il est normal que des caisses de poussins attendent par moins dix sur un coin de quai, il faut que le fond des choses échappe à notre jugement », note 964, p. 748) et théologique (« au fond de l’éternité existe aussi une autre douleur trop démesurée même pour une révélation », p. 748 ; « la souffrance n’est pas tellement négative qu’un Dieu n’ait voulu mourir sur la Croix », p. 195).
— –
Deux livres à commander :
Aimé Michel, « La clarté au cœur du labyrinthe ». 500 Chroniques sur la science et la religion publiées dans France Catholique 1970-1992. Textes choisis, présentés et annotés par Jean-Pierre Rospars. Préface de Olivier Costa de Beauregard. Postface de Robert Masson. Éditions Aldane, 783 p., 35 € (franco de port).
À payer par chèque à l’ordre des Éditions Aldane,
case postale 100, CH-1216 Cointrin, Suisse.
Fax +41 22 345 41 24, info@aldane.com.
Aimé Michel : « L’apocalypse molle », Correspondance adressée à Bertrand Méheust de 1978 à 1990, précédée du « Veilleur d’Ar Men » par Bertrand Méheust. Préface de Jacques Vallée. Postfaces de Geneviève Beduneau et Marie-Thérèse de Brosses. Edition Aldane, 376 p., 27 € (franco de port).
À payer par chèque à l’ordre des Éditions Aldane,
case postale 100, CH-1216 Cointrin, Suisse.
Fax +41 22 345 41 24, info@aldane.com.