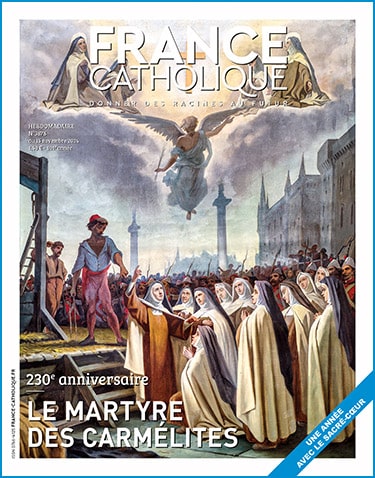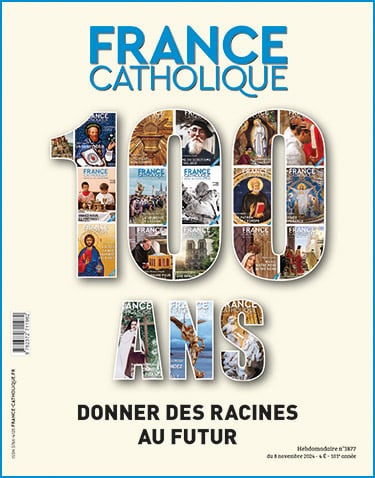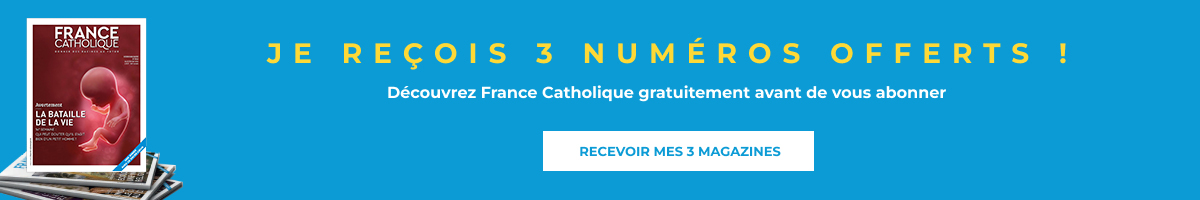Comme le raconte l’histoire, Robert Johnson, le légendaire chanteur de blues, se trouvant une nuit à quelque carrefour du Mississipi, vendit son âme au diable afin de devenir le plus grand joueur de guitare que la terre ait jamais porté.
« Je m’avançai sur la croisée des chemins et tombai à genoux,
Je m’avançai sur la croisée des chemins et tombai à genoux,
Je demandai au Seigneur, au-dessus : « Aie pitié, sauve le pauvre Bob maintenant, s’il te plaît ». » (“Crossroads Blues”)
Pas très longtemps après cette supposée transaction, Johnson mourut au jeune âge de 27 ans. Peut-être est-ce pourquoi l’on utilise l’expression « arriver à la croisée des chemins » lorsqu’il faut choisir entre le succès mondain et l’intégrité de son âme.
Le conservatisme américain, me semble-t-il, est à une telle croisée des chemins. C’en est une où ses partisans doivent choisir si le mouvement doit être guidé par un conservatisme fondé sur les vérités immuables de la nature humaine qui nous font pencher vers le bien, ou s’il s’aligne avec un simple conservatisme de marché.
Le second – que j’appelle conservatisme du marché – est le point de vue selon lequel, puisque les marchés ont été si efficaces et fructueux dans la production de richesses et de prospérité, et donc en nous permettant de profiter de beaucoup d’autres biens, le raisonnement du marché doit être appliqué à tous les aspects de la vie. Parce que la valeur des marchandises découle du calcul de ce que les gens sont prêts à payer pour elles, la valeur de tout ce qui paraît un bien – y compris les inclinaisons morales traditionnelles de la nature humaine – ne porte aucun poids normatif pour le conservatisme du marché.
Ces données, vues par ce dernier, loin d’être des vérités fondamentales de la nature humaine desquelles dépend le bien commun, sont des contraintes sur la liberté de chacun de poursuivre sa vision subjective de la bonne vie. Pour cette raison, pour le conservatisme du marché, le but presque exclusif de la politique est un gouvernement limité, ce qui signifie pour lui non seulement une libre économie de marché mais aussi l’élimination des lois ou des coutumes qui interfèrent avec la poursuite du but désiré. Donc, à ce compte-là, le bien commun (si on peut l’appeler ainsi) est mesuré par la manière dont l’individu n’est pas encombré par la tradition, la nature, les liens familiaux, la religion, etc. dans sa recherche de l’acquisition de ce qu’il veut quand il le veut.
Pourtant, en politique appliquée, le conservatisme du marché et les moralistes traditionnels se sont souvent trouvés utiliser le même vocabulaire et sont souvent parvenus à la même conclusion sur l’objet de la politique, bien que leurs raisons sous-jacentes soient remarquablement différentes. Comme le conservateur du marché, le moraliste traditionnel prône souvent le « gouvernement limité ». Ainsi, par exemple, tous deux soutiennent les marchés libres, parce qu’un tel système économique a le meilleur bilan en matière d’élévation du niveau de vie.
Mais à quoi sert d’élever le niveau de vie ? Pour le conservateur du marché, « le but ultime est de nourrir et de vêtir les gens », ainsi que C.S.Lewis l’écrit dans The Abolition of Man (Lewis lui-même n’était pas un conservateur du marché). La question de la manière dont les citoyens mènent leur vie – s’ils suivent les préceptes de la justice naturelle – est hors de la juridiction de la loi tant que leur conduite n’interfère pas avec les choix privés de leurs concitoyens pour suivre leurs propres visions de la bonne vie.
Bien que le moraliste traditionnel soit d’accord avec le conservateur du marché sur le fait que l’acquisition de richesse, la nourriture et les vêtements sont de bonnes choses, il les considère comme dignes d’être recherchés uniquement parce qu’ils l’aident à faire progresser ses tâches naturelles vis-à-vis du conjoint, de la progéniture, du voisinage, de la nation et de Dieu. Pour le moraliste traditionnel, la liberté est la capacité de poursuivre les choses non choisies de la justice naturelle, non grevées par certains agents extérieurs comme des criminels ou des gouvernements iniques. Pour le conservateur du marché, la liberté est la capacité de poursuivre ses désirs quels qu’ils soient, sans être encombré d’obligations non choisies telles que le conjoint, la progéniture, le voisinage, la nation ou Dieu. Pour le moraliste traditionnel, le bien est ce qui est désirable en lui-même, alors que pour le conservateur du marché, désirer quelque chose est ce qui fait que cette chose est un bien.
Tant que les marchés libres et leurs limites morales étaient dans le contexte d’une infrastructure culturelle qui n’était pas consciemment inamicale vis-à-vis des buts du moraliste traditionnel, une alliance entre le conservatisme du marché et le conservatisme moral avait beaucoup de sens. Le moraliste avait de bonnes raisons instrumentales de soutenir les marchés libres, pendant que le conservateur du marché avait de bonnes raisons pragmatiques d’accepter les apports d’une culture plus vaste, et ses mandarins n’avaient pas pour première mission d’écraser les institutions et les modes de vie traditionnels, ni le public dissident qui peut en émaner.
Mais nous ne vivons plus dans ce monde-là. Nous résidons dans un monde dans lequel les grandes entreprises ont créé un cartel culturel – un monopole moral – par lequel elles espèrent rendre le prix de l’acquiescement si bas, et celui du refus si élevé, que leur concurrence idéologique sera l’objet d’une prise de contrôle hostile ou déclarera la faillite de la civilisation.
Sans doute, comme certains l’ont remarqué, le conservateur du marché n’a-t-il jamais été un véritable ami du moraliste traditionnel. C’est juste un mariage de raison qui doit se finir par un divorce dès qu’une des parties aura trouvé un meilleur prétendant. Bien que je pense que cette théorie soit un peu simpliste, on ne peut ignorer le lieu ni le temps où nous nous trouvons : il est minuit à la croisée des chemins.
Source : https://www.thecatholicthing.org/2016/06/09/conservatism-at-the-crossroads/
— –
Francis J. Beckwith est professeur de philosophie et d’études sur l’Église et l’État à l’Université Baylor, et professeur invité en 2016-17 en Politique et pensées traditionnelles à l’université du Colorado à Boulder. Parmi ses nombreux ouvrages se trouve Prendre les rites au sérieux : la loi, la politique et le caractère raisonnable de la foi (Cambridge University Press, 2015).