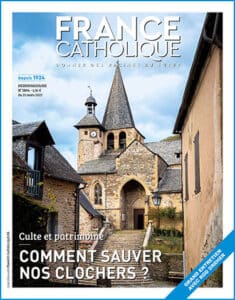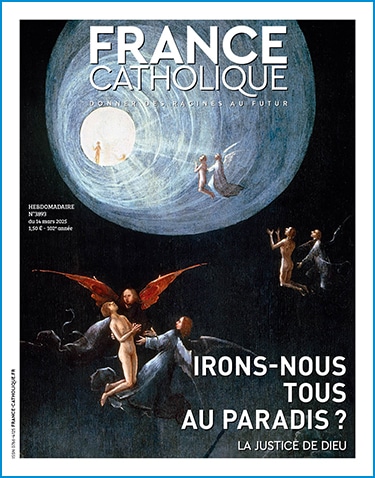« Disons que nous sommes en présence de deux femmes, commence mon ami. Elles s’aiment et sont engagées l’une envers l’autre de la manière dons vous êtes engagé avec votre épouse, et disons qu’elles s’engagent par des actes qui, si la biologie était différente, pourraient aboutir à des enfants mais, dans ce cas, ne le peuvent pas. Pourquoi l’absence de cette seule et unique dimension de cet acte le rend-il moralement mauvais ? »
A l’occasion d’articles précédents, j’ai suggéré qu’un problème avec cette question est qu’elle implique une subtile ambiguïté dans les termes. Parler de « relations sexuelles » à qui « il ne manque qu’une dimension de l’acte » – en l’occurrence l’ouverture à la procréation -, c’est comme « utiliser un marteau » sans aucune ouverture à l’idée d’utiliser des clous ou de fabriquer quoi que ce soit. Est-ce vraiment cela, l’utilisation d’un marteau ? Faire certains mouvements en l’air avec une main qui tient un marteau n’est pas le seul déterminant de ce qui constitue l’usage d’un marteau, pas plus que le fait de remuer les hanches ne constitue le seul déterminant de ce qui constitue les « relations sexuelles ».
Donc, la première chose à clarifier est qu’un homme et une femme (ou une femme et une autre femme) qui sont engagés dans un certain mouvement physique ne sont pas de facto engagés dans le même acte que deux conjoints qui sont engagés dans un acte fondamentalement procréateur, pas plus qu’un chirurgien qui incise un patient pour opérer son foie n’est en train de faire le même acte qu’Hannibal Lecter lorsqu’il ouvre sa victime pour lui manger le foie.
Dans un « acte », il y a plus que le seul mouvement physique. Il y aussi dans un « acte » plus que la seule intention avec laquelle il est réalisé. Selon l’Eglise, nous devons prendre en considération à la fois « l’objet » de l’acte et l’intention avec lequel il est réalisé, ainsi que toutes les circonstances pertinentes.
Mais disons que nous changeons la question. La manière dont la plupart de mes étudiants m’interrogent à propos de l’enseignement moral de l’Eglise est la suivante : « Pourquoi est-ce que je n’aurais pas le droit de faire ce que je veux, tant que cela ne porte préjudice à personne ? »
La première chose à dire sur cette question est qu’elle trahit un utilitarisme plutôt simplet dont celui qui la pose n’est généralement pas conscient. Mes élèves n’ont pas étudié de près les travaux de Bentham et Mill ni décidé qu’ils avaient raison. Non, cette sorte d’utilitarisme est simplement dans l’air du temps. Donc, ma première tâche consiste à leur suggérer que le « principe de nuisance » n’est pas vraiment la meilleure voie pour aborder les questions morales.
Pourquoi ? Eh bien, parce qu’il est en général difficile de définir le préjudice de manière à justifier que l’on force quelqu’un à cesser de faire ce qu’il veut. Nos chefs de résidences sont sans arrêt confrontés à ce problème. « Tout ce que je veux est écouter ma musique la nuit pendant que je travaille, ça ne fait de mal à personne » insiste un étudiant. Si vous mettez votre musique si fort que les autres ne peuvent pas dormir ou travailler, alors ça leur fait du « mal ». Mais est-ce que ça le fait effectivement ? Si l’on définit le « préjudice » comme le fait de donner un coup de poing dans la figure, non. Donc, quel niveau de préjudice faut-il que quelqu’un endure pour que vous restreigniez vos activités ?
Pas de préjudice ?
La prédominance du “principe de nuisance” est une des raisons pour lesquelles dans notre société, nous sommes obsédés par le fait d’essayer de montrer que quelque chose d’esthétiquement désagréable – comme fumer – contribue effectivement à tuer les passants qui respirent la moindre bouffée de fumée. Votre fumée ne m’est pas seulement désagréable, elle me fait du mal. Donc vous devez cesser. Inutile de dire que les fumeurs trouvent rarement ce genre d’argument vraiment convaincant. Les étudiants qui aiment écouter de la musique forte non plus.
Dans tout cela, on perd souvent de vue le fait que ce « principe de nuisance » suppose une approche complexe de la personne humaine. Les étudiants qui comprennent qu’il est mauvais de boire et de conduire (au risque de blesser quelqu’un) vont me demander : « Si je m’enivre tout seul dans ma chambre et que personne n’est blessé, en quoi est-ce mal ? ». A cela je réponds : « Mais cela porte préjudice à quelqu’un : vous-même ! Pourquoi ne devrais-je faire attention que lorsque quelqu’un d’autre souffre ? »
La manière dont les questionneurs modernes affirment le principe de nuisance est souvent sous-tendue par une sorte d’individualisme réducteur qui est illégitime et selon lequel une personne n’est pas intrinsèquement liée aux autres. Est-il vrai que ce que je fais, y compris à moi-même, n’a vraiment aucune incidence sur les autres ? Ou bien ce que l’on se fait à soi-même a-t-il un profond impact sur ses amis, sa famille, et la société ? N’avons-nous aucune obligation vis-à-vis des autres, de les aimer et d’en prendre soin ? Est-ce que le fait de se faire du mal à soi-même ne vole pas aux autres quelque chose qui leur est dû ?
A fortiori, est-ce que le suicide, que beaucoup d’entre nous considèrent comme une affaire privée, n’est pas en fait l’ultime acte égoïste par lequel je me coupe de tous liens et obligations envers la famille, la société, et Dieu ? L’ultime pacte anti-suicide est le fait de réaliser que je ne me suis pas donné la vie – elle m’a été donnée à la fois comme un cadeau et comme une responsabilité – et que je n’ai donc aucun droit à me l’enlever.
L’autre problème avec ce principe de nuisance est qu’il est plein de questions sous-jacentes. Est-ce que la nuisance physique est la seule sorte concernée ? Que dire du tort moral ? Est ce que je me nuis à moi-même lorsque je fais telle chose, pas seulement physiquement mais aussi psychiquement et spirituellement ? Ceux qui ont été accros à la drogue ou à l’alcool vous diront que le dommage physique est alors le moins grave. Le plus grand dommage est intérieur : il est relatif à la possession de soi-même. Et bien sûr, le préjudice qu’il crée aux relations avec ceux que l’on aime est le pire de tous, même si aucun dommage externe ne leur a été fait. Le préjudice moral peut être le plus nuisible.
Non, le « principe de nuisance » ne convient pas. Et les catholiques peuvent se trouver inextricablement ligotés dans leur recherche d’une réponse à une question à laquelle on ne peut pas répondre telle qu’elle a été posée.
L’enseignement de la morale n’est pas seulement le fait de dire ce que l’Eglise enseigne, mais aussi de montrer pourquoi l’Eglise a une meilleure façon de penser à propos de la vie et de ses questions les plus fondamentales.
— –
Source : http://www.thecatholicthing.org/columns/2013/robot-sex-cont-the-harm-principle.html
Randall B. Smith est professeur à l’Université de St-Thomas, récemment nommé titulaire de la chaire de théologie de Scanlan.
© 2013 The Catholic Thing. All rights reserved. For reprint rights, write to: info@frinstitute.org This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it