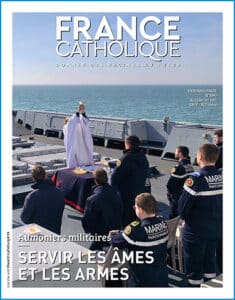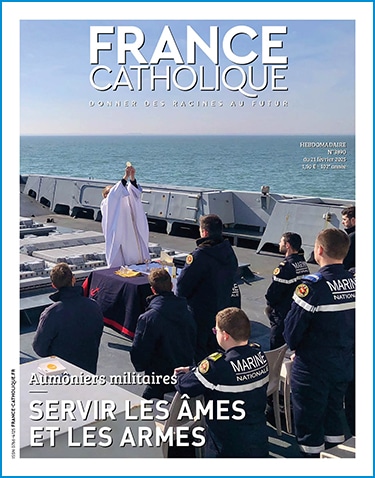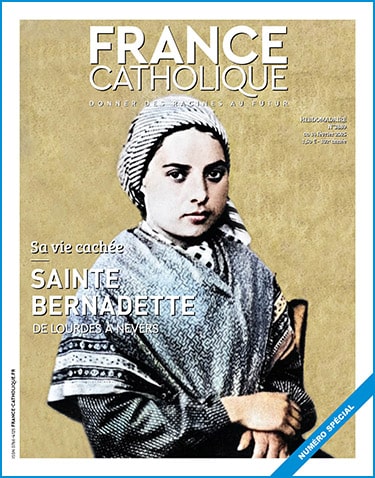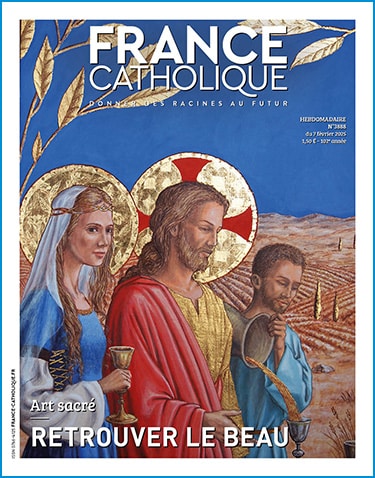Arthur Koestler est décidément l’un des grands esprits de ce temps, dont il aura traversé toutes les aventures et affronté tous les périls. Son dernier livre le montre une fois de plus sur un avant-poste, au milieu d’une querelle totalement inconnue du public, mais qui mine sourdement (les spécialistes le savent) les fondements mêmes de la science : celle du darwinisme et, au-delà, du déterminisme et, au-delà encore, du mystère de la nature (a).
Koestler n’est pas seulement un grand esprit. Il est aussi un grand écrivain. Comment intéresser les lecteurs intelligents mais profanes aux problèmes difficiles du néo-darwinisme et du lamarckisme ? Question que je m’étais souvent posée en vain et qu’il résout avec éclat en racontant simplement la vie tragique de Paul Kammerer, le romanesque et génial biologiste autrichien mort de s’être attaqué à l’orthodoxie darwinienne.
En effet, il y a tout l’essentiel dans cette vie. Kammerer naît en 1880. il commence par faire de brillantes études musicales en compagnie de Bruno Walter. Il compose, fréquente Mahler, Schönberg, Alban Berg.
Et si le hasard n’existait pas
Mais sa passion, c’est la nature, et surtout les bêtes sauvages. Il les devine. Il sait les approcher, les mettre en confiance. Le voilà qui abandonne la musique pour les études scientifiques. Il est bientôt chercheur à la Biologische Versuchstation d’où sortiront tant de savants fameux.
Kammerer, qui est à la fois un profond intuitif et un expérimental, sent la sottise d’une explication – celle de Darwin ou plutôt de ses intolérants épigones – qui réduit toutes les énigmes de la nature aux mécanismes conjugués de la mutation et de la sélection. Quelque chose d’autre, pense-t-il, quelque chose de plus obscur, de moins simpliste, participe à la création perpétuelle des êtres. Cette intuition ne nait pas chez lui d’une révolte superficielle, mais d’une vision globale, poétique des choses, aussi bien que de l’étude approfondie d’une certaine variété de crapauds. Et là Koestler m’a appris un fait capital et que même les biologistes le plus souvent ignorent : c’est que Kammerer, au-delà de sa spécialisation de naturaliste, s’était attaqué au problème philosophique du déterminisme lui-même en écrivant un livre d’observation et de réflexion sur l’anti-hasard (b). Selon Kammerer, le hasard vrai n’existe – et encore ! – que dans l’inanimé. Dès que la vie s’en mêle, il est battu en brèche par d’inexplicables coïncidences en série. Voici l’un des cent exemples donnés par Kammerer (le 22e) :
Le 28 juillet 1915 […] ma femme lit les aventures de Mme Rohan, personnage d’un roman de Hermann Bang intitulé Michael ; dans le tramway, elle voit un homme qui ressemble à son ami le prince Josef Rohan 1 ; le soir, le prince Rohan vient nous voir à l’improviste ; toujours dans le tramway, elle entend quelqu’un demander au pseudo-Rohan s’il connaît le village de Weissenbach-sur-Attersee ; en descendant, elle entre dans une charcuterie où le vendeur lui demande si par hasard elle connaît Weissenbach-sur-Attersee : il doit y expédier un colis et n’est pas sûr de l’adresse.
Notre éducation nous a appris à tenir de tels faits pour des coïncidences nées des lois du hasard et à repousser avec horreur, comme relevant de la pure superstition, l’hypothèse qu’ils aient une signification quelconque 2 . Or, Kammerer a très bien vu qu’une telle hypothèse, si choquante pour la raison, est très exactement de même nature logique que l’idée d’un processus non-darwinien supposé à l’œuvre dans la nature vivante.
On est pris, en découvrant cela, d’un surcroît de respect pour cet esprit qui, ayant le premier et tout seul mesuré l’immensité du problème auquel il s’attaquait, a tout simplement retroussé ses manches et s’est mis à l’ouvrage. Car pendant quinze ans, et en concentrant son travail sur l’hérédité chez le crapaud, il se battit contre le corps tout entier de l’orthodoxie scientifique pour obtenir que l’on examinât ses expériences. Il ne cessa pas de se heurter à la fin de non-recevoir, au mensonge, à l’insinuation calomnieuse (ses adversaires refusaient l’examen en laissant entendre que c’était inutile car tout était truqué), à la perfidie et peut-être, pour finir, au complot physique pur et simple, jusqu’à ce que Kammerer, perdu de réputation, se suicide le 22 septembre 1926.
Il s’agissait, répétons-le, d’expériences de biologie faites en laboratoire sur un élevage de crapauds. Ces expériences étaient difficiles, longues. Elles exigeaient une patience et un savoir-faire exceptionnels. Mais les résultats qu’il en alléguait et que ses collègues de la Biologische Versuchstation observèrent de leurs yeux pendant plus de dix ans introduisaient peut-être une découverte scientifique et philosophique fondamentale. Depuis 1926, personne ne les a refaites. Non qu’il ne se soit trouvé des savants curieux de savoir où était la vérité : mais on ne peut depuis un siècle toucher au sacro-saint darwinisme sans risquer sa réputation.
L’aventure de Kammerer est très connue en biologie 3 . Et Jean Rostand, grand amateur de crapauds lui aussi, tient l’évolution néo-darwinienne pour un « conte de fées » – ce n’est sans doute pas par hasard. Tous ceux qui connurent Kammerer ont été impressionnés par la puissance, la rigueur, la profondeur de sa pensée. Einstein ne cachait pas son admiration pour ses recherches sur les coïncidences. Et cependant, jusqu’à présent, la porte qu’il avait peut-être entrouverte est restée fermée.
Pourquoi ?
Sans réussir à se métamorphoser
Parce que la science (sinon la nature) ne fait pas de sauts. A lire superficiellement le maître livre de Koestler, on est tenté de penser que ces savants persécuteurs sont bien ignobles. Mais non. Ils étaient pris eux-mêmes dans la même mécanique que Kammerer, ceux-là comme instruments, celui-ci comme victime.
Les savants actuels qui ont souvent vécu personnellement une version atténuée du drame de Kammerer sont nombreux à penser que si les très grandes découvertes ont tendance à se raréfier, c’est que les mécanismes de la science tendent a échapper de plus en plus au contrôle des hommes, comme ceux de la société. De même que le monde des machines devient une néonature (la technonature de Jacques Ellul), de même la science se met à obéir aux lois de la jungle ou de la tumeur. Elle grossit sans réussir à se métamorphoser. Elle ne trouve du neuf que dans le prolongement du déjà connu. 4
Kammerer crut pouvoir faire de la science comme on fait une symphonie et en mourut. Il fallait un écrivain pour ressusciter son ombre, et cette résurrection était nécessaire.
Aimé MICHEL
(a) L’Etreinte du crapaud : Arthur Koestler (Calmann-Levy, Paris, 1972).
(b) Il s’appelle Das Gesetz der Serie et est introuvable. Koestler en donne une analyse en annexe.
(*) Chronique n° 77 parue dans F.C. – N° 1314 – 18 février 1972.
Les notes de (1) à (4) sont de Jean-Pierre Rospars.
- Ancienne famille française, descendant des rois et ducs de Bretagne. Henri de Rohan, prince de Guéméné et son fils Charles fuirent la Révolution. Ils se mirent au service de la Maison impériale et royale des Habsbourg-Lorraine qui régna sur l’empire austro-hongrois de 1780 à 1918. En 1820, ils acquirent le château de Sychrov en Bohème. Bien qu’invités comme les autres émigrés à revenir en France, les Rohan décidèrent de rester en Bohême où ils furent naturalisés.
- Paul Kammerer, né à Vienne en 1880, mena donc des recherches hétérodoxes non dans un seul domaine mais dans deux. Commençons par cette première « entreprise excentrique » à laquelle Arthur Koestler consacre l’Annexe I de son livre intitulée « La loi de sérialité ». Kammerer commença sa collection de coïncidences à l’âge de vingt ans et la poursuivit au moins jusqu’à la rédaction de son livre Das Gesetz der Serie (La loi des séries) qu’il acheva en 1919, sept ans avant sa mort. Il « passa des heures sur les bancs des jardins publics à noter le nombre des passants dans un sens et dans l’autre, et à les classer par sexe, par âge, par vêtements, par objets transportés, − paquets ou parapluies. Il fit de même pendant ses longs trajets en tramway de la banlieue au bureau. Puis il analysa ses tables et découvrit que pour chaque paramètre elles faisaient voir les phénomènes typiques de groupement que connaissent bien les statisticiens, les joueurs et les compagnies d’assurances. Naturellement, il tenait compte de tous les facteurs de causalité, comme les données météorologiques, les heures de pointe, etc. ». Il est difficile de juger la valeur de ces observations car « Kammerer ne connaissait pas toutes les finesses du calcul des probabilités et, en conséquence ne pouvait donner de réponse convaincante à l’argument classique du sceptique, − à savoir que sur une durée assez longue les combinaisons les plus invraisemblables se produiront fatalement par pur hasard » (voir sur ce point la chronique n° 106, L’avocat du diable, parue ici le 1er septembre 2010). Selon Koestler, « Kammerer voulait prouver que ce que nous appelons communément une coïncidence ou une suite de coïncidences est en réalité la manifestation d’un principe universel de la nature opérant indépendamment des lois connues de la causalité physique. » Pour cela il s’appuie « sur les analogies avec des principes de physique comme la gravitation, le magnétisme, etc., en repoussant toutes les explications parapsychologiques. Et c’est encore un paradoxe de ce caractère très complexe. Les exemples les plus frappants de coïncidences sont les rêves véridiques, les prémonitions, les expériences télépathiques. Kammerer voyait dans la sérialité un principe irréductible de la vie et rejetait comme autant de superstitions les explications parapsychologiques. Il ne croyait pas davantage, apparemment, à l’importance des processus inconscients, que le contexte en soit freudien ou “sériel”. On ne trouve que deux rêves dans sa collection de coïncidences ; encore les rapporte-t-il d’après autrui, et ils sont d’une extrême banalité. Le paradoxe est qu’il se considérait comme un matérialiste à toute épreuve. Athée fervent, pourrait-on dire, il était en outre franc-maçon, membre du partie socialiste autrichien, et collaborateur régulier des Monistische Monatshefte, revue de la ligue allemande des monistes. »
La même année, Koestler fait paraître Les racines du hasard (The roots of coincidence, trad. G. Fradier, Calmann-Lévy, Paris, 1972), une réflexion sur les « phénomènes impensables de la perception extra-sensorielle à la lumière des propositions impensables de la physique moderne ». Il y consacre un chapitre à Kammerer et à ses émules, le psychologue Carl Jung et le physicien Wolfgang Pauli. « Pour la première fois dans l’histoire moderne, écrit-il, l’hypothèse que des facteurs a-causals sont à l’œuvre dans l’univers reçut la bénédiction commune de deux chercheurs de grand renom, un psychologue et un physicien » mais « la montagne accoucha d’une souris » (p. 130). « Pauli fit (…) la proposition révolutionnaire d’appliquer à la macrophysique le principe d’éléments non causals, dont la légitimité était admise en microphysique, et en microphysique seulement. (…) Il espérait peut-être que de sa collaboration avec Jung sortirait une théorie macrophysique donnant quelque explication intelligible des évènements paranormaux. La tentative devait échouer à cause de traditions profondément incrustées dans la pensée occidentale, et qui remontent à l’antiquité grecque. » Les essais de Jung et Pauli, publiés dans un même ouvrage en langue allemande, sont disponibles en traduction française dans des livres distincts : Synchronicité et Paracelsia (Albin Michel, Paris 1988) pour celui de Jung, et Le cas Kepler (Albin Michel, 2002), avec une préface de Werner Heisenberg, pour celui de Pauli.
- La seconde entreprise de Kammerer suscite toujours des commentaires, en grande partie grâce au livre de Koestler, qui permettent d’en mieux comprendre la portée scientifique, épistémologique et philosophique.
Stephen J. Gould commente cette affaire dans le chapitre 7 « La tentation lamarckienne » de son livre Le pouce du panda. Les grandes énigmes de l’évolution (trad. J. Chabert, Bernard Grasset, Paris, 1980). Il en fournit une interprétation à la fois modérée et conforme aux idées actuelles. Les crapauds terrestres utilisés par Kammerer provenaient d’ancêtres aquatiques. Les mâles ancestraux avaient des coussinets sur les pattes pour tenir la femelle pendant l’accouplement. Les mâles actuels les ont perdus, bien qu’on les retrouve sous forme rudimentaire chez certains individus anormaux, ce qui indique que les gènes nécessaires à leur fabrication ne sont pas complètement perdus. « Kammerer contraignit quelques crapauds terrestres à se reproduire dans l’eau et éleva la génération suivante issue des quelques rares œufs qui avaient pu survivre dans ce milieu inhospitalier. Après avoir répété l’opération sur plusieurs générations, Kammerer obtint des mâles dotés de coussinets nuptiaux (même si l’un d’eux plus tard reçut une injection d’encre de Chine, peut-être pas de Kammerer lui-même, pour en rehausser l’effet). Kammerer en conclut qu’il avait mis en évidence un processus lamarckien : il avait replongé le crapaud accoucheur dans son milieu ancestral ; celui-ci avait recouvré son ancienne adaptation et l’avait transmise sous une forme génétique à sa descendance. Mais Kammerer avait en fait réalisé une expérience darwinienne : lorsqu’il força les crapauds à se reproduire dans l’eau seuls quelques rares œufs survécurent. Kammerer avait donc exercé une très forte pression sélective sur les variations génétiques, quelles qu’elles soient, qui encouragent le succès de reproduction dans l’eau. Et il maintint cette pression pendant plusieurs générations. La sélection exercée par Kammerer avait regroupé les gènes favorisant la vie aquatique, ce que ne possédait aucun des parents de la première génération. Puisque les coussinets nuptiaux sont une adaptation aquatique, leur apparition peut être liée à l’ensemble des gènes qui assurent le succès dans l’eau, ensemble dont la sélection darwinienne opérée par Kammerer a accru la fréquence. »
Mais Gould ne s’en tient pas là et s’attache à expliquer le succès du lamarckisme. Avant d’entrer dans le vif du sujet il commence par faire litière de la thèse commune : « Bien que j’accepte de me plier à l’usage contemporain et que je définisse le lamarckisme comme la notion selon laquelle les organismes évoluent en acquérant des caractères adaptatifs et en les transmettant sous la forme d’une information génétique transformée, je tiens à faire remarquer que ce nom honore bien mal un très grand savant qui mourut voici cent cinquante ans. L’intelligence et la richesse de sa pensée sont ainsi trop souvent dégradées. » (p. 73). On ne saurait mieux dire (voir à ce propos la note 1 de la chronique n° 45, Le cou de la girafe ou le poids de la liberté, parue ici le 13 septembre 2010). Cette mise au point faite, il explique le succès du lamarckisme par deux raisons. La première est que certains phénomènes de l’évolution semblent confirmer la thèse lamarckienne (mais un examen plus approfondi montre que c’est une erreur et que l’interprétation darwinienne les explique fort bien). La seconde raison, plus importante à ses yeux, « réside dans le soulagement que cette théorie apporte face à un univers dépourvu de signification pour notre vie. ». En effet, « la nature ne répond pas à certaines de nos aspirations : ainsi nous devons tous mourir et nous n’habitons pas au centre d’un univers restreint. L’hérédité des caractères acquis n’est qu’un autre exemple de ces espérances déçues. ». Il « renferme deux de nos préjugés les plus profondément ancrés, notre conviction que tout effort devrait être récompensé et l’espoir que nous mettons en un monde progressant de son propre mouvement, vers un but bien déterminé. Le lamarckisme a plus attiré Koestler et les autres humanistes par le réconfort qu’il apporte que par les arguments techniques sur l’hérédité. Le darwinisme n’offre aucune consolation de cette sorte car il considère uniquement que les organismes s’adaptent aux environnements locaux en luttant pour accroître les chances de succès de leur reproduction. Le darwinisme nous contraint à chercher ailleurs le sens de la vie. Et n’est-ce pas là le but même de l’art, de la musique, de la littérature, de l’éthique, des combats personnels et de l’humanisme koestlérien ? Pourquoi exiger tant de la nature et limiter les moyens qui sont les siens alors que les réponses (même si elles sont individuelles et non pas absolues) se trouvent en nous-mêmes ? »
Un autre biologiste, Gérard Nissim Amzallag, analyse l’affaire Kammerer et la controverse sur le lamarckisme d’une toute autre manière. Dans son livre La Raison malmenée. De l’origine des idées reçues en biologie moderne (CNRS éditions, Paris, 2002), s’appuyant sur l’enquête de Koestler, il écrit : « certains indices permettent de conclure que l’injection d’encre de Chine ne fut pas perpétrée par Kammerer lui-même, mais bien par un individu désireux d’invalider d’un coup tous ses travaux. De fait, nombreuses étaient les autorités scientifiques décidées à utiliser tous les moyens pour éradiquer toute possibilité d’héritabilité des caractères acquis. Il semble donc que la fraude fut utilisée ici en tant qu’arme de persuasion. Elle s’est avérée encore une fois extrêmement efficace. L’histoire de Kammerer est mentionné jusque de nos jours dans les ouvrages de référence comme un cas célèbre de fraude, et ce dans un but bien précis : discréditer toute tentative de démonstration expérimentale de l’hérédité des caractères acquis. Pire encore, ce tragique dénouement constituait, à l’avenir, une menace pesant sur tout biologiste affirmant détenir une preuve expérimentale de l’hérédité des caractères acquis. » (pp. 124-125). Pour Amzallag, l’affaire Kammerer n’est qu’un exemple parmi beaucoup d’autres des méthodes douteuses qu’utilisent les partisans de certaines théories pour « en accélérer la canonisation » et « les défendre activement contre les éventuelles alternatives ». C’est que « l’adhésion à une théorie dépasse souvent le contexte scientifique », d’où la passion des protagonistes et parfois le recours à la fraude par les deux camps opposés : « Si la falsification des résultats est souvent utilisée pour mener à maturité une théorie, l’accusation de fraude vis-à-vis de résultats problématiques constitue l’arme privilégiée pour protéger une théorie en place d’une sénescence trop précoce, et permettre ainsi sa canonisation définitive. » (pp. 111-112).
Bien entendu, l’argument philosophique de Gould ne prouve pas la fausseté du lamarckisme, ni l’argument historique d’Amzallag sa vérité. Seule l’expérience peut trancher. A ma connaissance les expériences de Kammerer n’ont jamais été reprises, en dépit de l’intérêt qu’y portaient, selon Koestler, des biologistes éminents comme Thorpe, Hydén et Waddington (sur Hydén voir la chronique n° 14, Matière et mémoire 1971, parue ici le 3 septembre 2009). Je n’en suis nullement surpris. Outre la difficulté considérable de ces expériences signalée par Koestler et la dissuasion bien réelle évoquée par Amzallag, il y a le fait que même leur réplication réussie ne prouverait nullement la thèse lamarckienne comme le montre Gould. La biologie moderne est bien différente de celle du temps de Kammerer et bien plus exigeante quant à la description des processus en jeu. Il faudrait d’autres expériences de biologie moléculaire et de génétique auxquels les crapauds de Kammerer se prêteraient mal. Si des mécanismes de type lamarckien sont à nouveau étudiés depuis quelques années (on préfère parler d’hérédité non mendélienne et de processus épigénétiques), c’est sur des espèces mieux connues génétiquement (souris, maïs, arabette des dames, voir note 2 de la chronique n° 45 citée ci-dessus). - Il s’agit d’un constat terrible, exprimée ici explicitement mais qui revient implicitement dans de nombreuses chroniques. L’évolution de la recherche au cours des trente dernières années ne peut que le conforter. L’organisation de la recherche, son mode de financement, son système de publication, son internationalisation complète (avec usage exclusif de la langue anglaise), entraînent une « massification » évidente de l’ensemble du dispositif avec un renforcement de l’establishment représenté par des journaux comme Nature et Science et une réduction concomitante de « niches » obéissant à des règles différentes. Il est significatif qu’Aimé Michel ne semble voir aucun correctif à la tendance qu’il diagnostique précocement.