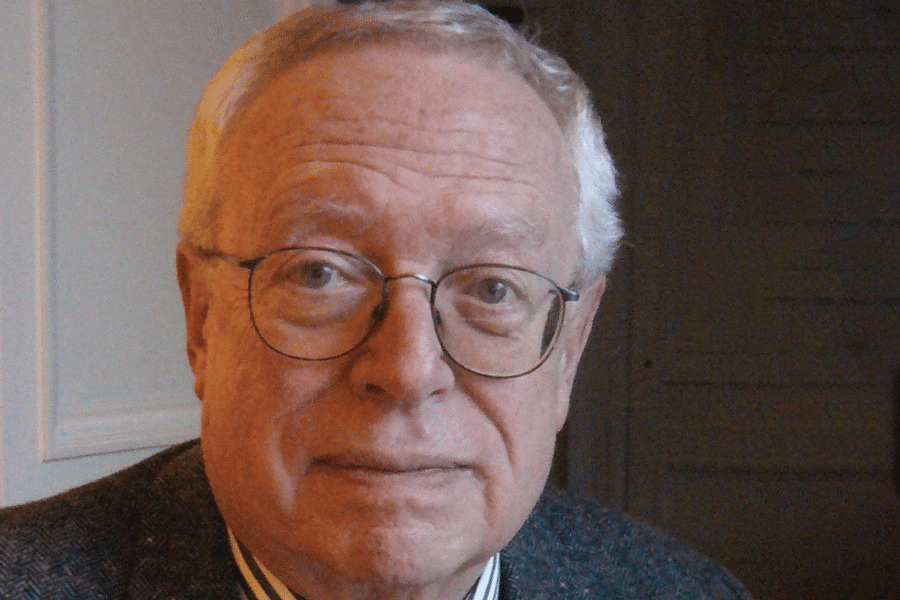À dire vrai, Alain Besançon aborde la question religieuse sous plusieurs angles. Il consacre sept chapitres à des problèmes religieux de natures très différentes. Par exemple, il s’interroge sur l’art chrétien et sur la religion de la Shoah. Il revient sur une discussion historique épineuse à propos du communisme russe. Il insiste beaucoup sur l’islam et ses rapports avec le christianisme. Mais il y a une unité indéniable dans son dernier livre, que l’on pourrait caractériser par le souci de rendre compte par l’intelligence critique du fait religieux, et plus précisément du fait chrétien. Besançon affirme sans détour son identité catholique mais précisément, c’est son appartenance qui lui commande un discernement exigeant, qui ne manque jamais « au respect et à l’amour qui sont dus à l’Église ». Et d’ajouter : « Aux porches des cathédrales, la synagogue est représentée par une femme ayant un bandeau sur les yeux. On verra que l’Église s’est souvent mise sur les yeux le même bandeau, ou un autre. » Plus que par une attention apologétique qui consisterait à justifier tout le parcours du christianisme, c’est par une attention critique qu’il est guidé. Au sens précis du terme qui signifie jugement, volonté d’approfondissement et de compréhension des éléments les plus essentiels.
Alors qu’on est trop souvent tenté de prendre les choses sous un angle moralisateur, Besançon s’intéresse aux sujets les plus essentiels, il les aborde de la façon la plus exigeante, en historien des idées qu’il est d’abord et qui s’informe auprès des sources les plus incontestables. Rien ne lui est étranger des disciplines du savoir dès lors qu’il peut recevoir un éclairage ciblé sur le domaine qu’il explore. Le premier chapitre de Problèmes religieux contemporains [1], concerne la science des religions, telle qu’elle s’est constituée à l’âge moderne. Il en fait un bilan rapide en montrant l’intérêt d’une méthode qui a mis en relation toutes les traditions religieuses possibles. Mais il met aussi en évidence les limites et les impasses d’un comparatisme égalisateur qui ne peut atteindre le génie propre à une tradition. C’est pourquoi il est sceptique quant au projet d’introduire l’étude du fait religieux à l’école. Autrefois, on enseignait aux élèves quelques bribes des mythologies antiques, mais il s’agissait de religions mortes. Dès lors qu’on s’intéresse aux religions vivantes, il est impossible de ne pas prendre position, d’une façon ou d’une autre, sur le fond. Mieux vaut donc s’abstenir. Si lui ne s’abstient pas c’est qu’il est totalement impliqué dans la tradition chrétienne dont il rend compte. Même quand il met les événements et les doctrines à distance, il ne se sent pas étranger, puisqu’il assume encore aujourd’hui la continuité d’un phylum qui est le sien. Ce phylum, c’est celui d’une orthodoxie chrétienne qui s’est parfois douloureusement construite dans un environnement historique, politique, intellectuel dont il reconstitue la trame. Ce sont des pages précieuses ainsi consacrées à ce que Newman aurait appelé le développement dogmatique du christianisme. Celui-ci passait par la fondation d’une Église, la constitution d’une hiérarchie ecclésiastique, la définition du canon des Écritures, la construction d’une dogmatique. Cette dernière a impliqué le recours à la philosophie antique. Le monde juif s’était aussi ouvert timidement à la sagesse païenne mais la théologie chrétienne poussera beaucoup plus loin l’expérience : « La foi chrétienne débordait la capacité de l’intelligence. Celle-ci était donc dans la situation malheureuse de ne pas pouvoir se donner la raison de sa foi. La pensée était donc dans l’urgente nécessité de se mettre au travail afin de ne pas rester en arrière et, à la longue, risquer de se séparer de la foi, voire de la contredire. Foi et intelligence se sont donc mises, si l’on peut dire, en concurrence. Elles ont l’une de l’autre un besoin vital. Fides quaerens intellectum. Intellectus quaerens fidem. »
Toujours dans la même ligne newmanienne, le travail est sans cesse à prolonger et à reprendre. La tentation serait de se replier dans ce que Balthasar appelait « les bastions », qui donnent un sentiment de fausse sécurité. Plus en avant, Besançon consacre un chapitre sévère à une période récente où l’intelligence a paru déserter l’Église latine, se réfugiant dans sa forteresse, bardée d’interdits, de condamnations, de sommations. Mais ce n’est pas la censure et l’index qui peuvent vaincre l’hérésie menaçante ou l’étiolement de la foi : « Entre les moyens de discipline et le travail de la pensée, il est moins fatigant de recourir au premier. Chacun se souvient de la manière dont a été étouffée plutôt que résolue la crise du modernisme. » On pourrait apporter un certain nombre de nuances à ce tableau général. La crise moderniste a tout de même débouché sur l’essor d’une exégèse biblique catholique de grande valeur. Il n’en reste pas moins que le constat général de l’épuisement des bastions a été confirmé à Vatican II. « L’Église chrétienne est née toute nue, exposée à tous les vents. Il se pourrait bien que 2 000 ans plus tard elle se retrouve dans la même situation. » Et Besançon d’enfoncer le clou : « Il ne reste à l’Église que la force de la vérité et sa capacité de persuasion, comme au temps des apôtres. Pour persuader, il vaut mieux être intelligent. »
Cette intelligence, l’auteur la revendique face à des défis contemporains d’une singulière importance, puisqu’ils concernent le communisme et l’islam. On pourrait lui objecter que c’est d’abord le contenu de la foi qu’il s’agit de mieux faire comprendre. N’étant pas lui-même théologien, il s’intéresse aux sujets qui sont plus proches de ses compétences. Nous reviendrons, toutefois, sur son dernier chapitre, qui est d’une teneur théologique extrêmement forte, puisqu’il concerne les fins dernières. Il est en même temps d’une actualité frappante et met en cause l’orthodoxie en ce qu’elle est fidélité rigoureuse à la tradition des apôtres. Avant de revenir là-dessus, nous ne pouvons faire l’impasse sur les deux chapitres qui provoqueront sans doute le plus de controverses.
Sur le communisme, Alain Besançon est particulièrement coriace. C’est sa vie personnelle qui est en cause, puisqu’il appartint, dans sa jeunesse, au Parti communiste français, dont il se détacha rapidement. Par la suite, son travail universitaire l’amena à étudier les sources et le développement du communisme en relation avec le passé profond de la Russie. À ce propos, la parution en 1977 de son essai intitulé Les origines intellectuelles du léninisme constitua un événement, car il obligeait à reconsidérer la réalité soviétique avec des instruments d’analyse vraiment adaptés à leur objet. Dans ces conditions, on comprend la singulière attention de l’auteur à l’égard de l’attitude du Saint-Siège face au phénomène soviétique. Besançon fut de ceux qui s’indignèrent du silence du concile Vatican II sur le sujet. Si l’on a vivement reproché à Pie XII son prétendu silence sur le nazisme, que dire de ce silence qui a duré 17 ans et auquel l’intéressé ne daigne accorder aucune excuse. Le regretté Étienne Borne n’avait pas admis, en son temps, pareille sévérité. Besançon persiste : « Dans l’optimisme et l’euphorie qui régnaient à l’époque « du concile », s’imposait l’idée que l’Église ne devait pas avoir d’ennemi. Si elle en avait, c’était un malheur dont il ne fallait pas faire état. Dénoncer un ennemi dénotait une imperfection de la charité. » Il y a du vrai dans un tel jugement, bien que l’Ost-politik menée par Mgr Casaroli fût guidée par un souci très réaliste de négociation, pour défendre les intérêts de l’Église dans les États communistes. Besançon n’est pas convaincu, car il pense qu’il y avait risque pour les Églises persécutées de se sentir moins soutenues par le Saint-Siège en négociation directe avec l’ennemi. Il aurait pu ajouter que le climat général de l’époque dans l’Église occidentale était au dialogue avec le marxisme. Le cardinal Decourtray a pu parler à ce propos d’une véritable connivence, ce qui lui fut amèrement reproché.
Besançon n’a que louanges pour la grande encyclique de Pie XI, Divini Redemptoris, du 19 mars 1937. Elle porte condamnation du communisme à partir d’une expérience historique : « Ce qui est condamné c’est le système, et non les gens qui le subissent. Le nom de ce système est “mensonge”. Il est étonnant que ce Pape en 1937 ait anticipé sur la pensée de quelques anticommunistes qui ont eu la tête métaphysique et qui ont abouti à flétrir l’essence du communisme comme étant un mensonge. Orwell, Kessler, Milosz, Herbert, Platonov, Mandelstam, Souvarine, Soljenitsyne, enfin, ont tous aboutis à ce mystère de néant qui subsiste comme mensonge. » Besançon regrette que cette lucidité n’ait pas été plus largement partagée du côté catholique et il affirme qu’aucun document pontifical n’a jamais égalé la pertinence de l’encyclique de 1937. Même Jean-Paul II ne trouve pas grâce à ses yeux : « Ce communisme dont il avait l’expérience, sous lequel il avait souffert et qu’il avait combattu, l’a-t-il pensé ? » La réponse est négative. Une telle assertion peut choquer, d’autant qu’elle concerne le principal responsable de la chute du système soviétique. L’ancien archevêque de Cracovie ne pouvait avoir qu’une connaissance intime de l’adversaire qu’il avait combattu jour après jour depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais je puis faire état ici d’un autre paradigme de lecture. Pour m’être intéressé à la pensée de Karol Wojtyla, j’ai toujours eu le sentiment qu’il avait combattu le système communiste, non pas au moyen d’une réfutation de la doctrine marxiste-léniniste, mais par un éclairage spirituel, philosophique et théologique qui montrait les carences anthropologiques du système. C’est en annonçant un Évangile vigoureux, qui s’adressait aux ressorts fondamentaux de l’âme humaine que Karol Wojtyla convainquait les cœurs et marquait la défaillance d’une idéologie incapable de répondre à ses prétentions libératrices. Cela n’enlève rien à la pertinence de l’analyse d’Alain Besançon en ce qui concerne la nature du communisme, et nul ne pourra esquiver son diagnostic.
Après le communisme, l’islam. Cela fait longtemps qu’Alain Besançon réclame la vigilance de l’Église sur ce thème crucial. Pour dire les choses crûment, il est en désaccord radical avec l’attitude générale où il discerne « un mélange de bons sentiments, d’ignorance et de peur ». Il est surtout insatisfait de la formulation de la déclaration conciliaire Nostra Ætate sur les religions non chrétiennes. Comme à propos du communisme, il incrimine un climat d’unanimisme et de réconciliation, qui fait bon marché des analyses qui conviendraient à propos d’une religion très particulière. À son propos, la volonté de la rapprocher à toute fin du christianisme, dans le cadre des religions dites du livre ou de la descendance abrahamique, est gravement fautive. Même le monothéisme ne saurait justifier une parenté qui fait bon marché de son contenu théologique, notamment dans ses désinences bibliques. La notion d’alliance, qui est capitale pour comprendre les relations du Dieu de la Bible avec l’humanité, est radicalement absente de la pensée musulmane. Par ailleurs, la référence à Abraham est trompeuse car le Coran réinterprète totalement les données de l’Ancien Testament, comme il réinterprète celles du Nouveau Testament. Le Jésus et la Vierge Marie honorés par les musulmans ne correspondent pas aux personnes de l’Évangile. Le Jésus coranique dément la foi chrétienne dans ses articles principaux. Il n’est pas mort sur la croix, un sosie lui a été substitué.
L’enseignement de Nostra Ætatæ a été le point de départ de nouvelles relations entre le catholicisme et le monde musulman. Alain Besançon conteste que la partie musulmane ait reconnu à la partie catholique la réciprocité que cette dernière essayait d’établir. Ainsi critique-t-il la rencontre de Casablanca de 1985 où Jean-Paul II s’est adressé à un vaste public de jeunes musulmans, à l’initiative du roi Hassan II : « Son discours, aux dires du père Borrmans, a été une “confession parfaite de la foi chrétienne dans le respect total de la foi musulmane”. On pourrait sans mauvaise foi dire l’inverse : une confession de la foi musulmane dans le respect de la foi chrétienne. » Autrement dit, ce serait un dialogue de sourds. Benoît XVI aurait pris conscience de cette anomalie, mais la réaction musulmane à la suite de sa fameuse conférence de Ratisbonne, aurait bloqué toute remise en cause, pourtant bien nécessaire. Besançon s’interroge même sur le geste de Benoît XVI dans la mosquée bleue d’Istanbul, dont il souligne le caractère équivoque, facilement exploité par les intéressés. Pour lui, le pape François poursuivrait la même ligne en affirmant que le véritable islam est l’ennemi de toute violence. Il est certain que ce chapitre extrêmement ferme sur des positions théologiques de fond pourra surprendre une opinion mal préparée. Mais Besançon persiste et signe : « Depuis quarante ans, beaucoup de chrétiens qui ont affaire à l’islam, particulièrement au Moyen-Orient comprennent mal que l’Église reste inerte devant la description qu’ils lui font de la réalité. Il faut se demander si la matrice de compréhension que propose la déclaration Nostra Ætate n’est pas insuffisante et ne contribue pas à obnubiler la perception des faits. De nouvelles clarifications seront réclamées par les événements. »
Il faut en venir enfin à l’ultime chapitre, dont l’intérêt est capital parce qu’ils concerne une donnée principielle de la foi. Il faut un certain courage pour l’aborder, l’auteur n’en manque point mais le sujet choisi est hors de toutes les opportunités politiques Il concerne ce qu’on appelait autrefois le domaine des fins dernières. Plus précisément, Alain Besançon veut faire le point sur la doctrine de l’enfer dans l’enseignement de l’Église catholique. Il esquisse ce qu’il appelle « une histoire démographique de l’enfer chrétien qui a longtemps été crû surpeuplé et qui maintenant est crû presque vide ». Là-dessus, les textes sont irrécusables. Il y a une incontestable évolution de la sensibilité chrétienne qu’accompagne la pensée des théologiens. À la fin de la vie d’Urs von Balthasar, il y eut une grosse querelle à propos d’un petit livre du théologien suisse intitulé L’enfer, une question. Un autre titre, Espérer pour tous, compléta d’ailleurs l’interrogation vivement contestée par des interlocuteurs traditionalistes (surtout en Allemagne). C’est dire à quel point le sujet est sensible. Pourtant, la doctrine n’a pas changé, si l’on consulte Le catéchisme de l’Église catholique : « § 1035 L’enseignement de l’Église affirme l’existence de l’enfer et de son éternité, (…) la peine principale de l’enfer consiste en la séparation éternelle avec Dieu en qui seul l’homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. » Besançon note que l’Église met fin à toutes les fantasmagories qui s’étaient développées au cours des siècles. Il y a de plus l’affirmation que c’est la personne qui choisit volontairement la privation de la vision de Dieu. Toutefois, cette persistance de la doctrine met encore mieux en évidence les changements de sensibilité intervenus. L’institution n’utilise plus la stratégie de la terreur, dénoncée dans les travaux de l’historien Jean Delumeau. Est-ce à dire que la question radicale du Salut est désormais absente de la spiritualité moderne ? Tel n’est pas le sentiment de Besançon qui explique que « ce sont les saints qui craignent l’enfer, eux qui sont plus capables que les autres de voir le fond de leur âme, et qui supplient le ciel de les arracher à ce destin et savent mériter. Ils espèrent aussi en l’assistance de la communion des saints. » Une citation de saint Jean conclut le chapitre comme il conclut le livre « Nous devons attendre avec assurance le jour du jugement. »
Alain Besançon, qui estime énormément le théologien Joseph Ratzinger, aurait pu se rapporter à l’ouvrage de ce dernier, La mort et l’au-delà, publié en 1977 et traduit en français en 1979 (Communio-Fayard). Le futur pape insiste beaucoup sur l’expérience des saints, surtout des derniers siècles, Jean de la Croix et surtout Thérèse de Lisieux : « Pour eux, l’enfer est moins une menace qu’ils brandissent contre les autres, qu’un appel à souffrir dans la nuit obscure de la foi la communion avec le Christ en tant que communion aux ténèbres de sa descente dans la nuit ; à approcher la lumière du Seigneur parce qu’ils partagent ses ténèbres et servent le Salut du monde en oubliant leur propre salut au profit des autres. Dans une telle spiritualité, rien n’est édulcoré de la terrible réalité de l’enfer ; il est si réel qu’il pénètre dans leur propre existence. » Impossible d’échapper au mystère d’iniquité dont parle l’apôtre et qui est au cœur même de la dramatique divine. La rédemption vécue par le Christ est arrachement aux ténèbres de la mort. Ce n’est pas seulement édulcorer le christianisme que d’amputer la doctrine de cette dimension, c’est le trahir. Il convient donc de remercier Alain Besançon de ce livre exigeant, qui oblige à remettre l’essentiel dans nos préoccupations et notre méditation.
—
Alain Besançon, Problèmes religieux contemporain, Éditions de Fallois, 2015.
P.S. : Le huitième chapitre du livre s’intitule : « Qu’en est-il du mariage des prêtres séculiers ? » Il avait déjà été publié dans la revue Commentaire (2009, n°128). À l’époque, je l’avais longuement commenté en formulant mes objections quant au possible mariage des prêtres dans l’Église latine (cf. France Catholique n° 3207 du 9 avril 2010). Mon avis n’a pas varié sur le sujet.