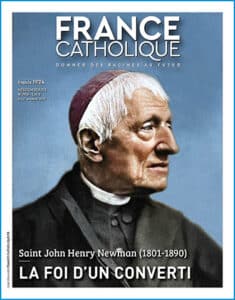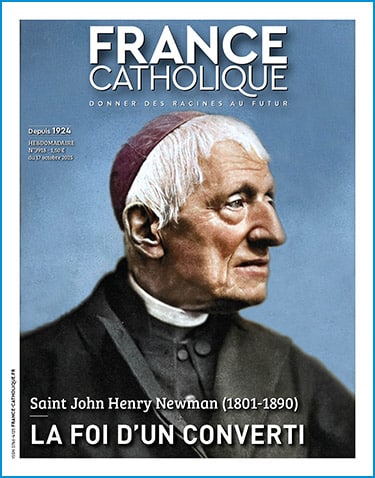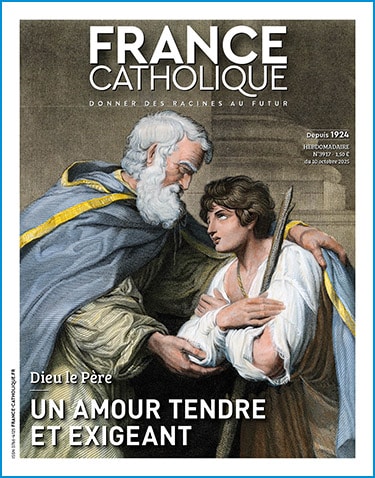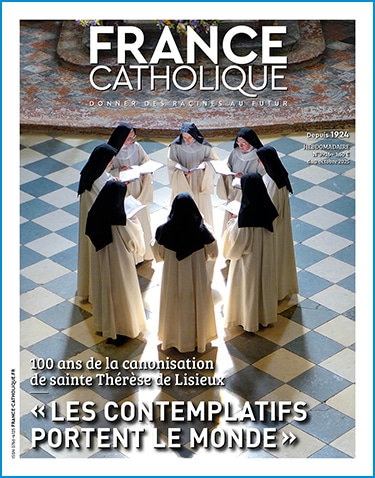3 JANVIER
Simone Weil ! Elle n’est pas seulement une des figures majeures de la pensée au XXe siècle. Elle fait partie de ces âmes religieuses dont Bergson aurait pu s’inspirer lorsqu’il se passionnait pour les mystiques. J’ai entendu, plus d’une fois, Gustave Thibon parler de l’auteur d’Attente de Dieu comme de la personne la plus proche de ce que saint Paul désigne avec le « pneumatique ». Ce qui est complètement engagé dans la vie spirituelle. J’ai toujours été fasciné par sa personnalité, son éthos, son rapport au christianisme, sans abandonner ma perplexité devant quelques-unes de ses phobies, et notamment son étrange rapport au judaïsme et sa complicité avec cette pureté dangereuse en quoi consiste l’hérésie cathare. Ce n’est pas pour autant que je suis prêt à acquiescer aux paroles définitives que Mona Ozouf prononce sur son destin : « À suivre les oscillations perpétuelles de cette pensée exigeante et obstinée, trouée d’éclairs, on se persuade que Simone Weil est profondément hérétique ». Hérétique en politique, je le croirais volontiers, tant sa passion révolutionnaire s’est toujours trouvée confrontée à ses propres contradictions. Hérétique religieuse ? C’est très possible. Mais jusqu’à quel point ? « Hérétique religieuse, servante d’un Dieu caché et absent du monde, qui réservait probablement des surprises au pauvre Père Perrin si désireux de la croire prête pour la conversion. » (Mona Ozouf, Les mots de femmes, Fayard, 1995).
J’ai voulu reconsulter ce beau livre de Mona Ozouf, tant j’avais été troublé par le portrait qu’elle fait de la grande Simone, parmi plusieurs autres. Très vite, j’ai retrouvé l’analyse psychologique plutôt imparable. J’ai été déçu par la brièveté de son allusion à la dimension religieuse. Le Père Perrin se serait trompé sur la disposition de Simone à la conversion. Naïf, le bon père ? Et voici que les éditions Nouvelle Cité ont justement la bonne idée de rééditer Mon dialogue avec Simone Weil, où le dominicain marseillais a rassemblé le dossier de sa rencontre avec la jeune philosophe géniale. Mais c’est encore un autre livre qui m’a imposé sa présence. Celui que sa nièce Sylvie Weil vient de publier (Chez les Weil, André et Simone, Buchet-Chastel) et où elle raconte comment sa vie entière a été marquée par le souvenir de sa tante si tôt disparue. Présence-absence obsédante, vécue par l’héritière avec des sentiments mêlés, même si l’admiration-affection n’est pas douteuse.
Certes, on comprend la difficulté de vivre avec un tel poids sur les épaules. Quel inconfort que d’être regardée comme une « relique de la sainte », de n’être considérée que comme la réanimation possible de l’icône. C’était tentant avec une réelle ressemblance physique. Il faut avoir une bonne dose d’humour pour supporter ces regards sur soi qui s’adressent à autrui. Parfois l’humour peut-être acide : « Moi, je déçois forcément. Passé le premier moment d’émotion devant mes yeux myopes derrière leurs lunettes, ma bouche et mes cheveux « qui ressemblent tant aux siens », la désillusion est grande ! Je ne connais même pas l’œuvre de ma tante par cœur. Je ne peux donc pas terminer les citations que l’on me tend comme des offrandes, dans l’espoir d’une véritable communion, d’un bain, d’une immersion totale. Combien de gens me regardent alors avec une déception non dissimulée, un étonnement attristé. »
Je me demande si ce n’est pas pour éviter la tentation de ne voir que Simone en Sylvie, que j’ai écarté la proposition faite par son attachée de presse de rencontrer la nièce de la philosophe ! Qu’aurais-je pu lui demander de plus que ce qu’elle explique dans ce livre assez mélancolique. Certes, il y a aussi le père, André, le frère de Simone, mathématicien génial, souverainement libre dans ses jugements, mais qui porte, lui aussi, le culte de ce personnage étonnant. Toute la famille a vécu dans le deuil perpétuel de l’irremplaçable. Comment ne pas l’admettre ? Il est vrai aussi que cette évocation est d’arrière-saison. Même le souvenir du père est attaché à la vieillesse, à ces moments où la fille attentionnée soutient le vieil homme par le bras. Le quartier du Luxembourg reste voué aux couleurs d’automne. Simone Weil s’y reconnaîtrait-elle ?
Le couple présence-absence est également sensible par la distance infranchissable que Sylvie paraît ressentir face à l’itinéraire intérieur de ce modèle impossible. L’attachement de Simone au catholicisme semble sinon incompréhensible, du moins exotique à Sylvie, qui considère sans tendresse les dévots de la chère tante. « Ces cafards qui venaient rouler au pied de sa grand-mère, susurrant, marmonnant comme un mantra ce nom de Simone dont ils se servaient pour envahir mon territoire… Les cafards avaient pris toute la place et il n’en restait guère pour nous. La maman de la sainte était tellement accaparée par ces fonctions qu’elle n’avait plus vraiment le désir d’être grand-mère ». Bien sûr, Sylvie Weil est plus nuancée que cela. Même si elle agite le personnage de Tartuffe, si elle prétend que Simone avait écrit « à ces hypocrites, ses pages les plus sincères et les plus désespérées », elle ne dit pas que cela, mais le dit tout de même. Elle conçoit l’amer regret de cet éloignement de la tradition juive à laquelle sa tante devait tout. En l’ignorant, ou en feignant de l’ignorer ? C’est vrai qu’il y a là une très profonde énigme.
Revenir au témoignage du père Joseph-Marie Perrin, c’est aborder une autre rive, celle qui est étrangère à Sylvie. Je n’y puis retrouver ce climat qui l’insupportait. Ce n’était pas un personnage banal que ce dominicain dont la cécité ne freinait pas l’ardeur apostolique et qui ne correspond en rien au reflet insupportable évoqué à l’instant. C’est vrai que Simone lui écrivit des textes extraordinaires et, tout d’abord, cette lettre étonnante qui constitue son autobiographie spirituelle.
7 JANVIER
Cette lettre adresse au Père Perrin en mai 1942 et où Simone Weil fait un point précis sur son parcours spirituel, s’interpose à l’encontre de l’opinion de Mona Ozouf. Celle-ci n’est pourtant pas sans argument, qu’elle fonde sur une analyse psychologique un peu unilatérale. « Une martienne », disait son maître Alain, une femme d’outre-monde. Une puriste insupportable souvent qui, par ses exigences, gênait tout le monde. Oui, bien sûr, on peut être troublé par sa tentation cathare, son étrange goût pour Marcion. Mais il y a aussi la Simone de cette lettre marseillaise, si simple, si vraie et si immédiatement proche du mystère chrétien. Son expérience d’Assise (1937) où « quelque chose de plus fort que moi » l’oblige, pour la première fois, à se mettre à genoux ; la semaine Sainte (1938) passée à Solesmes, où elle a suivi tous les offices, au cours desquels, la pensée de la Passion du Christ est entrée en moi une fois pour toutes. » Son cœur est ouvert à l’ampleur de la foi au Christ avec une appétence pour les sacrements et en premier lieu l’eucharistie.
Mais il faut se résoudre à une Simone inachevée, restée au seuil, sans le baptême, pleine d’interrogations et broyée par sa nature impérieuse, son sens du sacrifice. Elle n’est pas Édith Stein, fille du Carmel. Elle ne nous en est pas moins précieuse, essentielle. Et pour revenir à l’objection de Mona Ozouf, qui la déclare hérétique définitive, à partir de la définition – douteuse à mon sens – de Bossuet (Hérétique, tout homme qui pense), je proposerais cette amorce de réflexion. Non, l’hérétique n’est pas celui qui prend le parti de penser, c’est celui qui choisit selon son bon plaisir au détriment de la foi. L’anathema sit, la formule conciliaire qui gênait tant Simone, n’avait de légitimité que celle de nous garder de l’erreur et des mauvaises directions. Était-ce au détriment de l’immense espace des civilisations et de la richesse du monde ? Je ne le pense pas, même s’il peut y avoir des étroitesses, des tentations intégrisantes, pour rétrécir la faculté de s’étonner qui ouvre à la complexité des héritages. Pour Simone, cette immensité n’était pas contraire à la centralité de la croix du Christ.