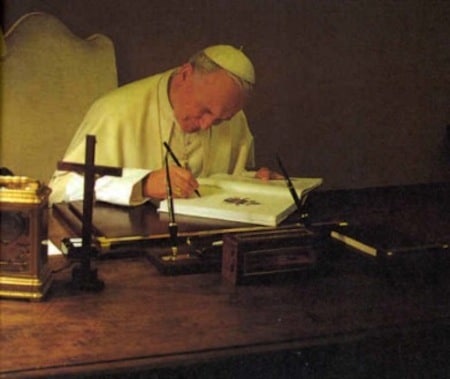Dans Evangelium Vitae, Jean-Paul II fait allusion à la philosophie de la personne humaine qui a donné essor à la culture de mort et dont les promoteurs cherchent à remplacer le caractère sacré de l’éthique de la vie : « En arrière-plan, il y a une crise profonde de la culture, qui génère un profond scepticisme vis-à-vis des véritables fondements du savoir et de la morale et qui rend de plus en plus difficile la claire compréhension de ce qu’est l’homme, la signification de ses droits et de ses devoirs. »
Comme le défunt pontife le soulignait dans une autre encyclique, Fides et Ratio, la raison de ce scepticisme est ce qui est généralement appelé scientisme, la croyance que les révélations des sciences dures sont les seules choses que nous pouvons connaître en dehors des mathématiques et de la logique. On appelle cela la mentalité positiviste puisque les tenants de cette pensée soutiennent que le sens et le but sont posés ou imposés par nos esprits dans un univers uniquement matériel et définitivement sans but. Jean Paul II note que, ce faisant, « non seulement cette pensée abandonne la vision chrétienne du monde, mais rejette tout appel à une vision métaphysique ou morale ».
Ce qu’il veut dire par là, c’est qu’une fois qu’une société a embrassé le scientisme, ou à tout le moins son esprit, des croyances avérées ne peuvent plus être considérées comme options possibles. Par exemple, si le but et le sens ne découlent pas du monde naturel, incluant la nature humaine, mais sont plaqués par l’homme, alors il n’existe aucun bien auquel l’homme soit ordonné. Alors on peut seulement savoir ce qui est bon pour une personne donnée, relativement à ses désirs, c’est à dire ce qu’elle croit être bon pour elle. Les règles du positivisme écartent la possibilité que ce qu’une personne considèrerait comme son intérêt pourrait être une erreur par rapport à une norme objective, ou qu’un être humain puisse avoir droit à des biens particuliers, même s’il n’en manifeste pas le désir.
C’est pour cela que certains croient qu’une communauté qui dénierait à un citoyen le droit de se suicider violerait les droits de ce citoyen. S’il n’y a pas de biens objectifs fondamentaux inhérents à la nature humaine, et si ce qui est bon est simplement l’assouvissement des désirs individuels (dans la mesure où cela n’entrave pas les désirs d’un autre citoyen), alors il ne peut y avoir de fondement au rejet du droit au suicide dans une société gouvernée par la mentalité positiviste. Pour cette raison, comme le note Jean-paul II, une telle société « ne reconnaît comme sujets de droits que les personnes dotées d’une certaine autonomie ».
Source : http://www.thecatholicthing.org/columns/2013/the-positivistic-mentality-and-the-gospel-of-life.html
C’est pour cela que les enfants à naître, et de plus en plus les nouveaux-nés, sont pensés par beaucoup, surtout parmi les intellectuels, comme ne faisant pas partie de la communauté morale. Récemment dans le Journal of Medical Ethics, les philosophes Alberto Giubilini et Francesca Minerva présentaient cette perspective avec une candeur stupéfiante. Dans un article intitulé : « Avortement post-natal, pourquoi le bébé devrait-il vivre ? » ils soutiennent, parmi d’autres arguments, que tant les fœtus que les nouveaux-nés, bien qu’étant des êtres humains, ne sont pas des personnes, et ne peuvent donc pas avoir un statut moral.
Ce qu’ils considèrent comme une personne, c’est « un individu qui est au moins capable d’attribuer une valeur à son existence de telle façon qu’être privé de cette existence représenterait une perte pour lui. » Ce qui veut dire que si un être humain n’est pas au moment présent capable d’attribuer une valeur à son existence -comme dans le cas des fœtus, des nouveaux-nés, des personnes en état végétatif persistant ou souffrant de dégénérescence neurologique – sa vie n’a pas de valeur objective.
Comme le titre de leur article le suggère, les auteurs veulent fournir un plaidoyer pour l’infanticide, qu’ils nomment par euphémisme « avortement post-natal ». Ils lui donnent ce nom car ils pensent à un problème médical que l’avortement ne peut régler : la naissance d’enfants handicapés qui auraient été probablement avortés si la mère avait connu le handicap du bébé.
Parce que de nombreux avortements ont lieu précisément parce que la mère est informée d’un tel diagnostic et que le nouveau-né n’est pas plus une personne que l’enfant à naître, Giubilini et Minerva soutiennent qu’il est injuste de refuser à ces parents la possibilité de se débarrasser d’une fardeau qu’ils auraient pu éliminer en toute légalité quelques semaines plus tôt.
Par conséquent, si une personne pense que son enfant né ou à naître est un fardeau trop lourd pour elle, pour sa société, sa famille, ses autres enfants ou même son bien-être économique, pourvu que la loi l’autorise à tuer son enfant, alors l’enfant n’est pas lésé.
Nous avons ici une illustration d’une société civile qui, selon les paroles de Jean-Paul II, « n’est plus « la maison commune » où tous peuvent vivre ensemble sur la base de principes d’égalité fondamentale, mais est transformée en un tyran qui s’arroge le droit de disposer de la vie des plus faibles et des plus démunis de ses membres… au nom d’un intérêt public qui n’en a plus que le nom et qui est l’intérêt de quelques-uns ».
Sans le scientisme ou ce que Jean-Paul II appelle la mentalité positiviste, il est peu probable que la culture de mort se soit jamais implantée dans beaucoup de nos sociétés. Sans cette dévaluation initiale des bases du caractère sacré de la vie — une égale dignité et un égal respect établis en raison de la nature humaine que nous partageons et qui est ordonnée vers certains biens — ces idées véhiculées par des chercheurs tels Giubilini et Minerva auraient rarement — voire même jamais — été sérieusement envisagées.
Pour aller plus loin :
- Le cardinal Müller sur les questions des droits
- Enseigner la mentalité chrétienne ?
- La paternité-maternité spirituelle en vie monastique est-elle menacée en Occident ?
- L’évangile de la vie, et les élections américaines de novembre
- Affaire Ulrich KOCH contre Allemagne : la Cour franchit une nouvelle étape dans la création d’un droit individuel au suicide assisté.