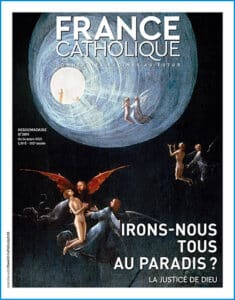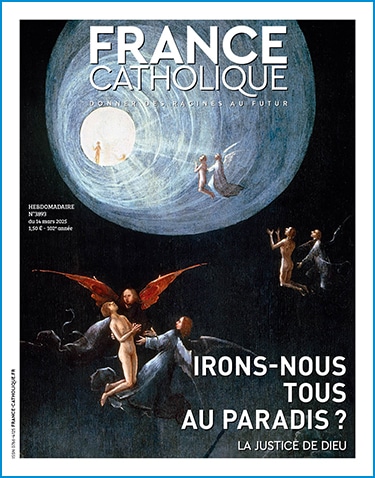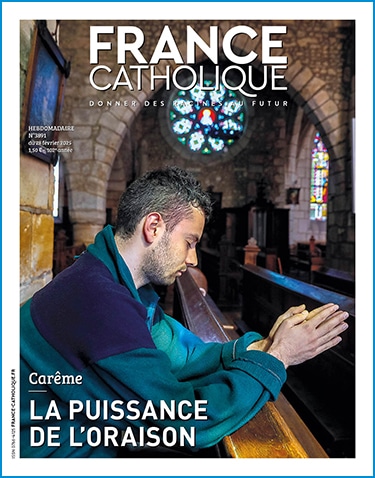Est-il besoin de dire qu’une telle tragédie insupportable peut ravager une vie ? Celle d’un père blessé et révolté ! Mais Philippe Delaroche a converti, en quelque sorte, sa révolte. On pense à Bernanos, selon lequel la prière est la seule révolte qui se tienne debout. Cela peut s’entendre aussi comme un formidable désir de restituer la figure d’une Inès magnifique qu’il n’est pas question d’enfermer dans le seul souvenir de sa fin, qui en deviendrait morbide. Non, l’anamnèse est une sorte de discipline intérieure qui a le don de faire ressurgir, dit le poète « non plus grands, non plus beaux, mais pareils, mais les mêmes, ces jours pleins, ces instants parfaits où la fibre a tenu, où le lien a duré, où ce qui était fait pour s’unir ne subissait amputation, rétractation ni déchirement ».
Ma lecture de La gloire d’Inès1 n’est pas celle d’un lecteur ordinaire, qui découvre un univers caché, celui d’une jeune fille qui a quitté ce monde à vingt et un ans, grâce à la magie de l’écriture. Je connais l’auteur depuis toujours. C’est un ami infiniment cher, avec lequel j’ai vécu, pour une part essentielle, l’aventure de ce temps, en déchiffrant, avec lui, le sens de ce qui se révélait à nous, depuis les convulsions heureuses et malheureuses de 68. Il a été l’éditeur de plusieurs de mes livres, et le co-auteur de l’un d’entre eux. Nous avons de sacrés souvenirs en commun, telle cette escapade à Bâle, pour passer une journée aux côtés de Hans Urs von Balthasar, que Philippe appelait « l’Augustin de notre temps ». Il en est d’autres, plus intimes, que je ne révèlerais évidemment pas mais qui expliquent une rare proximité. Le lendemain de la mort d’Inès, je reçus de lui un sms qui, en termes lapidaires, m’apprenait l’indicible. Je lui répondais sur-le-champ : « Cher Philippe, te voilà cloué à la Croix. » Que dire de plus, entre amis que seule la foi peut éclairer au fond de la détresse ?
Inès, je ne l’ai pas beaucoup rencontrée, suffisamment pour que son visage se soit gravé en moi. Elle avait à peu près l’âge d’une de mes filles, et je les revois jouer ensemble lors d’une joyeuse rencontre dans un joli coin du pays natal de la famille Delaroche, tout près du village où nous l’avons accompagnée à sa dernière demeure terrestre. Mais comment ne me souviendrais-je pas de sa naissance et surtout de son baptême ? C’est Philippe Barbarin, le futur primat des Gaules qui avait baptisé Inès à Saint-Maur-des-Fossés, où il était alors aumônier de lycée. Le papa avait choisi un parrain prestigieux à sa fille, en la personne de Jorge Valls, le poète cubain rescapé des geôles de Castro ! Après la cérémonie lui et le parrain étaient venus boire le champagne dans notre maison toute proche. L’avenir de cette enfant, sous de pareils auspices, n’était-il pas prometteur ?
Quand Philippe Delaroche m’a remis son livre sous pli, il y a déjà quelques mois, j’ai eu le sentiment de porter avec moi une sorte de viatique, un objet de grand prix. Il est resté sur mon bureau plusieurs semaines, sans que j’ose le sortir de son pli. J’en ai fait l’aveu à Philippe par la suite. Il m’a parfaitement compris : « Oui, il faut du courage pour lire ce livre. » Sans vouloir faire un jeu de mot, on peut tout de même risquer l’analogie. C’est un livre brûlant, oui, il brûle moralement les mains. Mais sitôt franchi le seuil, l’épreuve initiatique produit le miracle.
L’Inès souriante de la couverture se révèle être une jeune fille exceptionnelle. Et il nous importe d’accompagner l’auteur, le père, dans son mémorial qui consiste en une évocation de la personnalité et de l’existence de sa fille et en une méditation sur le deuil d’un enfant. L’anamnèse, si belle qu’elle nous paraisse, n’a pas immédiatement surgi, comme un chant, du cœur et de la mémoire : « La vie d’Inès, je n’avais pas eu la ressource de la défendre. Sa mémoire, je n’avais pas su la sauvegarder. Avenir et passé venaient de perdre quasi simultanément toute valeur. À peine avais-je entrevu quel futur vide de son absence m’attendait que, dans le même temps, ma mémoire avait laissé échapper le récit de son vivant. J’ai dû longtemps supporter le poids du deuil et l’aiguillon d’une culpabilité redoublée. » Il a fallu que se desserre l’étreinte du traumatisme immédiat, pour que, de proche en proche, l’esprit se libère et qu’Inès réapparaisse dans des moments qui se redessinent avec intensité, parfois avec les aspérités d’une relation père-fille, qui ne va pas sans incompréhension ou conflit.
Pourtant Philippe est fou de cette fille supérieurement douée, « sa Lilou ». Leur connivence évidente ne peut être indemne des accrocs dus à la responsabilité paternelle. Quand Inès décide d’abandonner la khâgne d’Henri IV, qui semble pourtant convenir à ses dons intellectuels évidents, le père se fâche et l’explication est rude : « Bref, lui répond Inès dans un courriel cinglant, on est sûrement sur deux planètes en pensant chacun que l’autre finira bien par atterrir sur la nôtre (…) c’est pour le moment apparemment impossible, père pourtant aimé… » Il y aura réconciliation, bien sûr, qui consonne avec une complicité, qui s’est sans cesse manifestée, ne serait-ce que dans les références littéraires, poétiques ou musicales.
Mais le mémorialiste a voulu aller au-delà de ses relations avec sa fille, en recueillant le plus largement possible les témoignages de tous les amis et condisciples d’Inès. En résulte un portrait, confirmé par chacun et chacune de ceux qui ont répondu par écrit à sa sollicitation. « Inès est une fée qui vole au-dessus de Paris sans plus jamais s’arrêter. Elle sera toujours là, près de nous, de nos pas, nous charmant par sa musique et ses mots. Son vol et sa voix que nous aimons tant, tel un mystère, le plus attachant de Paris. » C’est presque un poème en prose qu’a confié Camille, mais qui semble convenir tout à fait à son amie. Cette impression aérienne, ce mystère d’une personnalité qui ne se révèle pas d’emblée et qui se mérite, tous l’attestent. La même amie Camille, qui rencontra Inès en seconde au lycée Henri IV, nous donne une idée impressionnante de son indépendance : « Inès aimait profondément réfléchir et s’emparer de certaines disciplines, de certains bouquins avec passion, mais, d’un autre côté, elle méprisait la vanité, le stress caricatural et l’admiration limitée aux institutions de certains de nos camarades, (…) Inès était d’une inventivité et d’une imagination géniale pour nous faire rire, inventer des histoires, trouver des expressions ou des mots nouveaux pour parler de nos univers. »
Un père est parfois le dernier au courant des évolutions de ses enfants, de certaines de leurs aventures ou mésaventures. Il fallut, par exemple, que Philippe apprenne par Gabriel, l’ami de cœur de sa fille, que celle-ci avait poursuivi, lors d’un séjour en Syrie, une recherche spirituelle, « non sans combat ni rejet ». A posteriori, il est possible, même s’il s’agit d’interroger des paramètres délicats, d’imaginer la requête de cette fille, une intellectuelle ultrasensible. Partagée entre la rationalité moderne, celle des sciences humaines et par ailleurs « un sens de la magie, du merveilleux, de l’émoi, de la Beauté, non plus l’affaire des sciences mais cette fois de la poésie ». Le court intermède d’une rencontre avec un moine dans un monastère n’avait pu répondre à cette requête. Mais Inès n’était qu’à l’aube de son essor intérieur. Elle-même, a vingt et un ans, n’était que pure promesse.
L’évocation sollicite la méditation, celle d’un père, vivant notamment de la littérature et qui ne peut manquer d’y trouver des correspondances intimes, ne serait-ce qu’avec un Victor Hugo, frappé à plusieurs reprises par la mort de ses enfants. Il y a ainsi une innombrable fraternité des écrivains blessés au plus vif de leurs affections paternelles. Mais au terme de son parcours c’est le chrétien qui s’affirme : « Et puis j’ai accepté de dire : “Que ta volonté soit faite.” J’ai pris exemple sur Kierkegaard : “Le plus puissant est toujours celui sait joindre les mains.” J’ai fait mienne la vision du théologien Hans Urs von Balthasar, que j’avais rencontré à Bâle : “Au Ciel, chacun saura enfin qui il est en réalité et pourra faire de lui un don absolument unique. Mais ce don est commun à tous, si bien que nous plongeons éternellement non seulement dans les profondeurs toujours nouvelles de Dieu, mais aussi dans les profondeurs inépuisables de nos compagnons de Création, les anges et les hommes.” » Inès, sa fille chérie, l’aura mené ainsi au plus profond secret qui est en nous, plus nous-mêmes que nous.