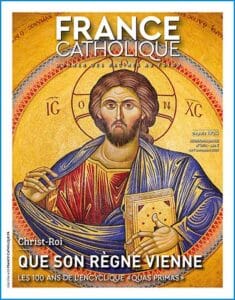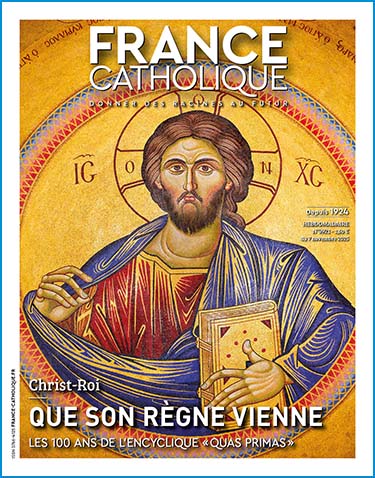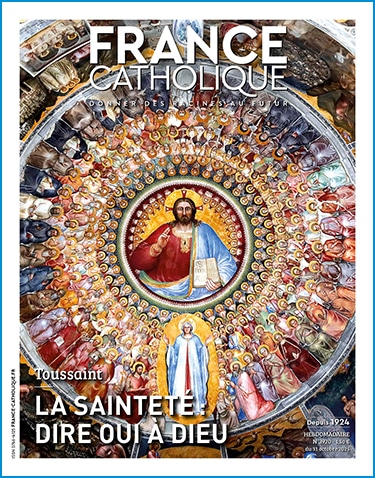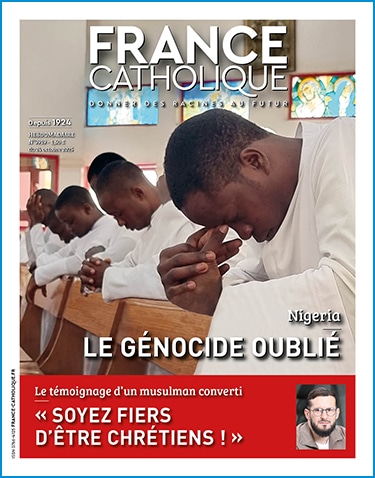La crise grecque pourrait entraîner, dit-on, une crise générale en Europe. Mais n’est-ce pas moins parce que la Grèce orthodoxe se montre rétive à la discipline nécessaire pour s’européaniser complètement que parce que l’Europe de l’Union a la prétention de s’helléniser sous la forme d’un nouvel empire byzantin ?
Les vives réticences initiales à l’Union européenne de la part de l’Eglise Orthodoxe de Grèce, l’une des plus nationalistes et longtemps des plus anticatholiques au sein de l’Orthodoxie, ont progressivement cédé la place à une participation aux côtés des autres Eglises pour la défense des intérêts religieux communs – liberté religieuse, héritage chrétien, traditions nationales d’organisation (l’Eglise dans les pays orthodoxes n’étant pas officiellement séparée de l’Etat) -. La crise financière grecque n’a pas remis en cause l’appartenance à l’Union. Après un long silence, le Saint-Synode des évêques grecs a pris position dans une lettre lue le 19 décembre 2010 qui dénonce les défauts du système politique et social grec et bat sa coulpe pour n’avoir pas réagi plus tôt. L’Eglise elle-même, comme partie du système, n’a pas été innocente. Plus gros propriétaire foncier du pays, elle n’a été soumise à l’impôt que depuis le plan d’austérité de 2010. Elle va continuer à être appelée à contribuer au second plan de redressement budgétaire, cette année, par la ponction de ses réserves. La Banque Centrale de Grèce va empocher les revenus ecclésiastiques et paiera ses charges.
La Grèce s’est longtemps pensée comme extérieure à l’Europe, géographiquement par la coupure des Balkans, alphabétiquement par l’usage du grec, religieusement en étant pendant vingt ans le seul Etat membre orthodoxe, jusqu’à être rejoint récemment par la Bulgarie et la Roumanie, et demain par la Serbie (Bulgarie et Serbie usant de l’alphabet cyrillique). Mais la société grecque s’est européanisée plus vite et, donc en partie, désorthodoxisée, la pratique reculant derrière la façade intacte de la culture.
Inversement, en Europe occidentale, on s’était longtemps demandé si l’entrée de la Grèce (en 1974 sous l’influence du président français de l’époque Valéry Giscard d’Estaing) n’avait pas été une grave erreur, en raison de ses « archaïsmes » souvent attribués à sa religion nationale. L’absence de séparation de l’Eglise et de l’Etat fait que le budget de l’Etat rémunère les popes (plus de 350 millions d’Euros). Mais la France le fait toujours pour les clergés d’Alsace-Lorraine, la Grande-Bretagne et certains pays scandinaves ont une Eglise d’Etat, les Allemands paient un impôt religieux perçu par l’Etat et redistribué aux Eglises. Bref c’était un mauvais procès. Aujourd’hui rares sont les voix qui ont osé recommander la sortie de la Grèce de l’Union.
Le problème ne viendrait pas ou plus de la « différence » grecque mais bien plutôt de la transformation mimétique (expression de l’historien britannique Arnold Toynbee) de l’Union européenne en nouvel Empire byzantin.
Rémi Brague (Europe, la voie romaine, Essais, Folio, 1992, 2e éd. 1998) a bien montré comment Charlemagne, en recréant un Empire d’Occident, avait voulu faire pièce à l’Empire d’Orient. En vain. La comparaison avec Byzance, brillante capitale de l’Empire romain depuis Constantin (330), était amère pour la petite Aix-la-Chapelle. Et Charlemagne lui-même, sacré à Rome en 800 sous le titre pompeux d’Empereur du « Saint Empire Romain », n’atteignait pas le prestige et la légitimité de Léon l’Isaurien. La continuité avec les Pères de l’Eglise, la richesse des bibliothèques, laissait la Rome des Papes elle-même plutôt pâlotte en comparaison. Nous sommes déformés par notre histoire apprise à l’école (de Charlemagne) qui exalte notre côté des choses et ne nous parle pratiquement pas de l’Empire byzantin. Très rares en sont les spécialistes universitaires. On n’aime pas les histoires qui se finissent mal. En réalité, l’Europe occidentale a toujours cultivé un complexe d’infériorité par rapport à cet empire que nous appelons byzantin mais qui se voulait à juste titre simplement l’Empire romain. Après la séparation religieuse consommée en 1054, la jalousie alla jusqu’à détourner le cours de la Quatrième croisade pour piller Constantinople (1204), provoquant un déclin dont la brillante civilisation ne se relèvera jamais.
On connaît l’expression : « Mais c’est Byzance ! » pour signifier le luxe. Mais on a aussi l’adjectif « byzantin » et le néologisme « byzantinisme » qui, me direz-vous, s’appliquent parfaitement aux procédures de Bruxelles. Mais notre propos va beaucoup plus loin. Il dépasse aussi la référence empruntée par le pape Benoit XVI à Ratisbonne en 2005 à l’un des derniers Paléologue, Manuel II, peu avant la chute de Constantinople aux mains des Ottomans de Mahomet II (1453). La thèse de Rémi Brague était que l’Europe, contrairement à Byzance, n’avait accès à la Grèce que par un intermédiaire qui était Rome, et le truchement des traductions arabes. L’Europe tient donc son identité de l’extérieur d’elle-même. Byzance au contraire était grecque de naissance et parlait grec comme langue maternelle et officielle. Byzance était « romaine » et « chrétienne » mais pas latine ni européenne. Byzance était « romaine » et « chrétienne » en descendance directe alors que l’Europe ne l’est que par secondarité.
Le drame de Byzance, selon Brague, fut de se prendre elle-même son propre miroir. Sa civilisation ne pouvait évoluer. Elle était à son apogée. Elle n’était susceptible d’aucune renaissance au sens de celle du XVIe siècle en Occident.
Le sort de Byzance, « cas classique de l’idolâtrie d’une institution menant une civilisation tout entière à l’échec » (Arnold Toynbee, Une étude de l’histoire, Payot), attend-il l’Europe bruxelloise ? Au cours des vingt dernières années, l’Europe a indéniablement évolué vers le cas byzantin, non tant par son sentiment de richesse ou de confort indépassable, c’est-à-dire aussi un sentiment de vulnérabilité, à la fois financière et religieuse, que par sa conscience d’incarner le tout de sa puissance et de son étendue, depuis son élargissement à l’Est. L’Union européenne a de plus en plus conscience de coïncider avec l’Europe géographique, mais aussi avec elle-même, d’être à elle-même son miroir. Le débat sur son identité marque, quoique de manière ambiguë, cette phase de son destin.
Mais il est une autre dimension, qui va dans l’autre sens, selon l’Américain Charles Kupchan en 2002 (The End of the American Era), qui voyait l’Union européenne comme « un pôle émergent, divisant l’Occident en deux moitiés, américaine et européenne ». L’Europe, dans ce « schéma géopolitique pour le XXIe siècle », devient géographiquement l’Empire romain d’Orient par rapport aux Etats-Unis, nouvel Empire romain d’Occident. Nous serions Byzance face à la nouvelle Rome américaine, elle-même en déclin. Il serait urgent de nous mettre à étudier ce bizarre empire byzantin dont nous ne savons quasiment rien sauf qu’il a duré mille ans de plus que l’autre, alors que sa civilisation a sombré, et que comme civilisation, l’occidentale dure encore après deux mille ans !