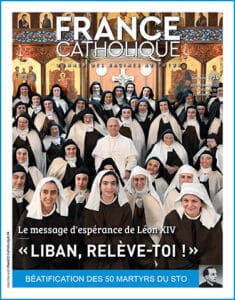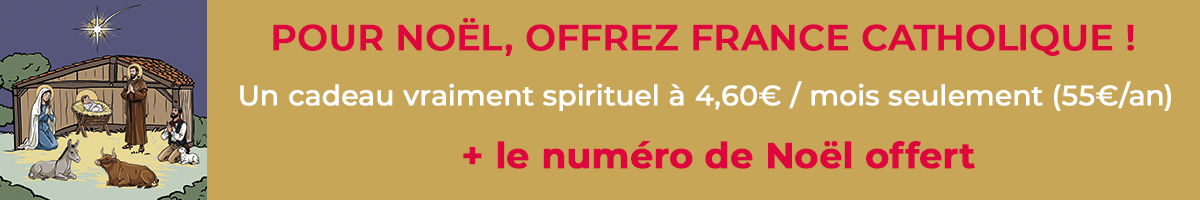Quand es-tu né à la vie intellectuelle et quel était le climat intellectuel de cette époque ? Qu’est-ce qui te passionne dans la vie des idées ?
Pour répondre à pareilles questions je suis obligé de faire un effort d’anamnèse, de revenir à mes vingt ans, à ma classe de philosophie… J’ai le sentiment que les choses sont assez simples à ce moment-là. La vie intellectuelle est commandée par la guerre froide. Le monde de l’Est est dominé par une idéologie conquérante qui impressionne grandement les intellectuels de l’Ouest. On se définit comme marxiste ou anti-marxiste et le monde catholique auquel j’appartiens est très marqué par ce rapport au marxisme. Une partie de l’intelligentsia catholique a poussé assez loin les liens avec le monde communiste.
Ça, c’est une première chose. La deuxième c’est que la vie politique est marquée par la décolonisation. En 1954 — j’ai douze ans — commence la guerre d’Algérie qui se terminera en 1962 lorsque j’aurai vingt ans. Mon adolescence et mes premières années de jeunesse ont été marquées par ce conflit qui divise la France en deux. Le monde intellectuel est massivement du côté de l’indépendance algérienne, et un nom émerge dans cette intelligentsia, celui de Jean-Paul Sartre. Sartre qui, déjà, juste après la Seconde Guerre mondiale, est apparu comme une sorte de figure de proue, avec l’existentialisme qu’on définira comme un existentialisme athée. Dans ma classe de philo on avait sans cesse afaire à Sartre, L’Être et le Néant, etc. On avait à se battre, en quelque sorte, avec une conception de la liberté qui était liée à l’athéisme.
Le milieu dans lequel je me trouvais m’a amené à m’intéresser au courant de la philosophie thomiste de l’époque, qu’on appelait encore néo-thomiste. Particulièrement Jacques Maritain et Étienne Gilson. Je leur dois énormément, même si par la suite je me suis intéressé à d’autres courants de la pensée chrétienne et philosophique. J’ai commencé à faire de la théologie. J’ai lu très tôt le père de Lubac, notamment deux livres qui m’ont marqué, Catholicisme et Le drame de l’humanisme athée. Je retrouverai le père de Lubac par la suite, mais je pense que son influence dès mes 21-22 ans a été déterminante.
Et puis, après l’affaire algérienne, une autre phase va se manifester sur le terrain intellectuel. Moi-même je ne l’ai pas découverte tout de suite. Pour me faire découvrir ce qui s’était passé dans le monde intellectuel, il faudra mon arrivée à Paris en 67-68. Je suis des cours en Sorbonne et quand j’écoute ce qu’on raconte autour de moi, je me rends compte que Sartre est en train de s’effacer au profit d’un courant intellectuel qui semble, à ce moment-là, en phase ascendante : le structuralisme, avec Levi-Strauss, Roland Barthes, Michel Foucault… C’est ce dernier qui me retiendra le plus, et que je rencontrerai par la suite.
Mais ce qui a le plus compté pour moi intellectuellement, c’est le tournant de 68. Je suis en Sorbonne. Je vois monter le mouvement de contestation, ne serait-ce qu’à travers la mobilisation des étudiants en philo, à la Sorbonne, à Nanterre, etc. Je ne suis pas tellement surpris par l’explosion qui a lieu en mai parce que j’ai senti la montée en puissance d’un mouvement qui s’était manifesté sans cesse par des appels, ne serait-ce que les annonces incessantes entre les cours. Dans le grand amphi de la Sorbonne, la mobilisation était sans cesse à l’ordre du jour. Je serai à ma manière au cœur de l’événement de 68 qui va complètement bousculer les choses et me bousculer moi-même.
J’ai raconté ça à de multiples reprises. La question qui se pose est une question politique. à quoi va aboutir ce soulèvement de la jeunesse ? Est-ce que ça va être une révolution politique ? Le Parti communiste, faut-il le rappeler, à ce moment-là est une réalité massive. Il représente un cinquième de l’électorat. C’est une puissance sociale, culturelle, intellectuelle et on n’imagine pas qu’un changement politique de fond, de caractère révolutionnaire se fasse en dehors de lui. Certes le Parti a été marqué dans les années 60 par de multiples ruptures chez les jeunes qui ont adhéré à des formations trotskistes, puis maoïstes. Mais ces formations sont extraordinairement minoritaires. Elles peuvent jouer un rôle dans la rue, mais le bénéficiaire d’un mouvement de fond, ça ne peut être que l’appareil du Parti.
Or les communistes résistent des quatre fers à une logique de prise du pouvoir. Pourquoi ? On évoque un veto de Moscou. Mais, surtout, la période d’expansion économique continue des « Trente glorieuses » a transformé la condition ouvrière. Les ouvriers accèdent à la société de consommation, avec la bagnole, le frigo, la télé… Il y a un embourgeoisement de la classe ouvrière et le Parti, qui est son porte-parole, défend en priorité les avantages acquis. Il n’est plus dans une logique de chamboulement révolutionnaire. Il est là pour engranger les bénéfices de l’expansion économique.
La CGT, le grand syndicat de l’époque, qui est dirigé par les communistes, va certes s’engouffrer dans le mouvement social de 68. Il ne faut tout de même pas oublier que ça a été une grève générale qu’on n’avait pas connue depuis le Front Populaire en 1936, et même d’une ampleur encore supérieure. Mais lorsque Georges Séguy va à Grenelle pour négocier avec le Premier ministre Georges Pompidou il veut engranger des augmentations de salaires. Il ne veut pas conquérir l’Élysée. Il y a tout de même un problème avec les jeunes ouvriers qui sont entrés dans une logique gauchiste de débordement, mais le réformisme l’emportera. Et quand de Gaulle arrête le mouvement de 68, c’est de fait, un grand soulagement pour le PC.
Ça c’est l’aspect politique de 68, il y a aussi un aspect intellectuel. On ne cesse de parler marxiste ou marxien. Dans la rue les étudiants ne cessent de débiter le catéchisme du Capital, la plus-value, les contradictions internes du capitalisme qui vont amener son explosion… Mais on s’aperçoit qu’il y a quelque chose qui ne colle pas. L’idéologie marxiste donne une explication de l’histoire, mais elle ne donne pas toute l’explication. On verra vite qu’il s’agit plus d’un mouvement de civilisation que d’un mouvement social classique. Les léninistes qui espéraient une révolution semblable à celle de 1917 seront déçus. Si révolution il y a, elle est plutôt culturelle, elle renvoie à ce que Freud appelait « un malaise dans la civilisation ». Le mouvement se trouvera des références intellectuelles qui sont plus en phase avec ses aspirations. On se tournera vers des auteurs qui, certes, ne sont pas tout à fait étrangers au marxisme, mais qui se réclament plus souvent de Freud et même d’un dépassement du freudisme.
Deux nouveaux noms émergent, Marcuse et Reich. Il faut dire qu’à l’époque très peu de monde avait lu Marcuse. Et pourtant Mai 68 va se révéler marcusien à cause d’une critique très ciblée de la société de consommation et de l’importance donnée à la sexualité. Il convient de parler d’un véritable basculement intellectuel. Le gauchisme soixante-huitard n’avait plus rien à voir avec le gauchisme dénoncé par Lénine comme une maladie infantile. Il signifie précisément la fin du marxisme-léninisme et l’avènement d’une nouvelle thématique sociale. Une thématique d’ailleurs profondément ambiguë dans la mesure où elle peut conforter de nouvelles radicalités critiques tout autant qu’un alignement sur un capitalisme de consommation. La radicalité critique se retrouvera du côté d’un Deleuze et d’un Guattari dont le livre phare, L’anti-Œdipe, sera le manifeste de toute une postérité soixante-huitarde. Le freudisme lui-même se retrouve mis en cause, car Freud est considéré comme un conservateur arc-bouté sur la structure familiale. Or, la révolution du désir détermine une subversion généralisée des mœurs.
Je vais suivre tout cela avec énormément d’intérêt. Mais c’est Maurice Clavel qui va m’éclairer sur le sens général de l’évolution en cours. Il a toute une histoire derrière lui. À la veille de la guerre, il a été sauvé de la tentation fasciste par le royaliste Pierre Boutang qui est son camarade de la rue d’Ulm. Résistant, il accueillera le général de Gaulle devant la cathédrale de Chartres à la Libération et plutôt que de suivre la carrière de philosophe à laquelle il semblait voué, il s’associera à Jean Villar dans l’aventure du festival d’Avignon. Il sera connu comme un auteur de théâtre, adaptant aussi des grandes pièces du répertoire. Il sera aussi journaliste, frôlant un moment le Parti communiste. Mais c’est surtout dans les années soixante que sa réputation grandit, grâce à Jean Daniel qui l’a accueilli au Nouvel Observateur. Sa chronique de télévision lui permet d’aborder tous les sujets possibles. Et ceux-ci débordent largement la politique. à peu près au moment où il arrive au Nouvel Observateur, Clavel s’est converti au christianisme, à la suite d’une épreuve personnelle qu’il racontera plus tard dans son Ce que je crois. Ce qui va me passionner sur le moment, c’est la façon dont Clavel rapporte la crise de civilisation à la crise personnelle qu’il a vécue. En deux mots : c’est tout un monde qui s’effondre parce qu’il ne croit plus à ce qu’il est censé croire.
La question est donc spirituelle. C’est à une conversion totale que le monde moderne est appelé à l’image de la conversion qu’il a lui-même vécue quelques années plus tôt. Les articles que le journaliste a publiés dans Combat et au Nouvel Observateur ont surpris par leur côté absolu. Clavel semble rallier la frange la plus extrémiste de la contestation. Il est l’ami des dirigeants maoïstes, ceux qui ont songé sérieusement à déborder le Parti communiste pour l’obliger à faire la révolution. Qu’est-ce que le catholique Clavel vient faire là-dedans ? Certains en perdent leur latin et le prennent pour un fou. Mais l’intéressé sait très bien où il veut mener son monde et il s’en expliquera durant la décennie qui lui reste à vivre dans une série d’essais retentissants. Le caractère absolu de la contestation n’a de sens que dans sa relation avec l’absolu. L’absolu c’est Dieu tout simplement, ce Dieu qu’il a vu ressusciter en 68. On conçoit que la radicalité évangélique de Clavel est d’une autre essence que la radicalité d’un Deleuze. C’est pourquoi il médite, depuis sa colline de Vézelay où il s’est installé, toute une stratégie ambitieuse de retournement de l’intelligence occidentale. Il ne pourra aller au terme de son entreprise disparaissant à la veille de ses 60 ans…
Clavel était persuadé que 68 pouvait aboutir à une révolution spirituelle. Était-il trop optimiste ? Ce qu’il attendait dépassait de toute façon les limites d’un projet politique. Il est probable qu’il aurait adhéré d’enthousiasme au pontificat de Jean-Paul II dont il n’a vécu que les premiers mois. Il s’était reconnu dans le mouvement charismatique, notamment lorsque la communauté de l’Emmanuel était venue, durant deux étés, à Vézelay inaugurer les grandes sessions qui se développeront par la suite à Paray-le-Monial. Avec le recul du temps, on constate que le mouvement qu’il avait impulsé n’est pas parvenu à son terme. La situation intellectuelle a beaucoup évolué après sa mort, dans les années 1980. Le retournement de l’intelligentsia contre le marxisme, va se confirmer. Après la publication de L’archipel du goulag d’Alexandre Soljénitsyne, la monstruosité du communisme est patente. Cependant, une autre voie radicale semble s’ouvrir avec le gauchisme et les penseurs de la radicalité critique, comme Deleuze, Guattari et Foucault. Paradoxalement, avec la victoire de François Mitterrand en 1981, cette radicalité va s’effacer de la scène publique, pour renaître, sous d’autres formes, dans les universités américaines. Il faut dire que l’expérience de gauche tourne rapidement court : en 1983 c’est l’alignement sur les thèses du libéralisme économique.
Plus fondamentalement c’est un tournant idéologique qui va se produire, avec le retour en force du libéralisme tocquevillien. Il faut rappeler l’importance de la remise en cause de l’historiographie classique de la Révolution française. En 1978 (l’année de l’avènement de Jean-Paul II) François Furet a publié un essai intitulé Penser la Révolution française. C’est un déni absolu des thèses enseignées à l’université, avec cette croyance que le grand projet révolutionnaire constitue toujours l’espoir à venir. Quelques années plus tard un autre livre cosigné par Furet, Julliard et Rosenvallon achèvera la démonstration : La Révolution française est terminée. La problématique démocratique, proche de celle des américains, se substitue à la rhétorique jacobine et même républicaine. Cela va se traduire par l’essor de quelques philosophes majeurs qui vont fournir les cadres nouveaux de la réflexion politique. Je pense notamment à Claude Lefort, à Marcel Gauchet et à Pierre Manent et, dans un registre un peu différent, à Régis Debray.
Le libéralisme économique n’est pas forcément lié au libéralisme politique. Cependant on conçoit difficilement une société libérale en dehors des règles du marché, d’autant que l’époque se signale par un retour à une pensée pré-keneysienne de l’économie. Ronald Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher en Angleterre veulent libérer le dynamisme économique d’une régulation étatique, et c’est l’ensemble du monde qui se trouvera engagé dans cette évolution qui correspond à la globalisation. Un théoricien comme Hayek qui avait toujours été difficilement reçu en France, finira par y trouver des disciples très convaincus.
Tu décris une espèce de prise de pouvoir d’une pensée libérale et de droite. Comment expliques-tu que certains intellectuels de gauche aient si facilement basculé dans ce libéralisme. Est-ce que cela te choque ?
Un bon nombre de jeunes normaliens formés au marxisme vont le répudier complètement. Ce sera le destin des maoïstes de l’époque qui ont été des révolutionnaires incandescents dans les années 60 et qui ont essayé de prolonger Mai 68 dans une espèce de mouvement insurrectionnel qui ne s’est pas produit.
En 1974, c’est la mort de Pierre Overney, militant maoïste tué aux portes de Renault à Boulogne-Billancourt. Cette simple mention évoque un univers disparu. On parlait à propos de Renault et de son usine de l’île Seguin de la forteresse ouvrière. Tout cela a disparu. Mais à l’époque le symbole était encore extrêmement fort. Les obsèques d’Overney rassembleront une foule considérable dans les rues de Paris. Paradoxalement, cette manifestation marque la fin du gauchisme post-soixante-huitard. Le mouvement maoïste va se dissoudre et ses dirigeants vont suivre des itinéraires inattendus. Le Pierre Victor, dirigeant charismatique de la Gauche Prolétarienne, abandonnera le marxisme et terminera sa vie dans une yeshiva à Jérusalem. Entre-temps il a accompli cet exploit de convertir Jean-Paul Sartre à la pensée d’Emmanuel Lévinas, ce qui constitue un démenti complet à toutes les thèses de l’existentialisme. Mais il est d’autres exemples, tels celui de Lardreau et Jambet qui vont explorer un moment l’aventure des origines chrétiennes, où ils pensent avoir découvert la véritable conversion révolutionnaire. Personnellement, avec mes amis proches, j’ai suivi tout cela au plus près, notamment à travers le cas de ce qu’on a appelé les nouveaux philosophes à la fin des années 70 (André Glucksmann, Bernard-Henry Lévy, Jean-Paul Dollé, Philippe Némo, etc.).
On te dépeint souvent comme théologien et philosophe, et tu t’intéresses de très près à la politique. Parmi ces trois disciplines, quelle est pour toi la plus importante et, comme j’ai un peu une idée de la réponse, comment ordonnerais-tu les trois ?
Les trois dimensions m’intéressent. Je n’ai jamais eu l’idée d’en délaisser aucune. La politique, je m’y suis toujours intéressé par la force des choses, parce que dès mon enfance j’ai découvert son importance, ne serait-ce que par les souvenirs de la guerre avec la génération de mes parents, les guerres coloniales et post-coloniales qui déterminaient les clivages de mon adolescence. Et puis j’ai vécu, j’avais seize ans en 58, l’avènement de la Cinquième République et j’ai assisté à une vraie révolution. Je n’ai jamais délaissé le souci politique, qui a toujours été chez moi en relation proche avec la pensée philosophique. Ma formation initiale a été marquée par la philosophie et la théologie. Je n’ai jamais abandonné ces disciplines, bien au contraire. Au travers d’une carrière journalistique poursuivie depuis 68, je n’ai cessé de me confronter aux grands penseurs, suivant attentivement l’ensemble de la production intellectuelle en ajoutant à la philosophie et à la théologie l’espace des sciences humaines.
Je dois préciser que parallèlement aux événements politiques et aux évolutions intellectuelles, j’ai vécu tout ce qui s’est passé dans l’Église avec intensité. L’événement majeur de ce point de vue demeure le concile Vatican II et ses suites. J’ai toujours adhéré à l’enseignement du Concile, à l’encontre du courant traditionaliste qui l’a répudié dès le départ. Ce n’est pas pour autant que je suis resté indifférent à certaines objections, mais cela ne pesait pas eu égard aux grandes orientations des constitutions conciliaires. J’ai toujours eu le sentiment que l’inspiration profonde du concile se situait dans la ligne du cardinal Newman et à ce qu’il appelait le développement organique du dogme.
Je dois dire la dette que j’ai contractée à l’égard d’un certain nombre de maîtres que j’avais commencé à lire autour de mes vingt ans. Je songe au cardinal Jean Daniélou, avec qui j’eus une longue rencontre, quelques semaines avant sa mort. Je n’ai jamais fait mon deuil de sa disparition, parce qu’il jouait alors un rôle d’éclaireur que facilitait son aisance dans l’expression publique. Mais le théologien que j’ai le mieux connu demeure le cardinal Henri de Lubac, dont j’avais lu les œuvres très tôt, et que j’aurai la chance de côtoyer pendant une dizaine d’années, ayant de longues conversations avec lui. J’ajoute que la parution de la trilogie de Hans Urs von Balthasar dans les années 70-80 a été pour moi un véritable éblouissement. Le père de Lubac qui avait été son professeur, disait que c’était l’homme le plus cultivé de son temps. Il avait une maîtrise de la culture européenne à commencer par les langues. Il avait traduit une partie essentielle du patrimoine littéraire européen en allemand. Et il opérait une liaison entre la littérature et la théologie, qui conférait à cette dernière une nouvelle dimension. Je pourrais également parler de Louis Bouyer mais aussi de Joseph Ratzinger sans oublier Yves Congar et bien d’autres.
Je mets la théologie au-dessus des autres savoirs, non seulement par conviction personnelle mais parce que l’éclairage anthropologique qui vient de la Bible et de la Tradition est incomparable.
Depuis des années, tu t’intéresses aux débats d’idées. Tu t’es aussi beaucoup engagé, politiquement et auprès de l’Église. Est-ce qu’on peut changer le monde avec des idées et des échanges d’idées, ou bien est-ce juste un outil pour comprendre le monde et ses évolutions ?
Les deux. On ne peut pas comprendre le monde sans cet extraordinaire outil qu’est la pensée, dans tous ses domaines. J’ai parlé de philosophie, mais j’aurais pu élargir aux sciences humaines, la sociologie, la psychanalyse, l’histoire, voire l’économie où je suis certes moins à l’aise. Le monde dans lequel nous vivons n’est intelligible qu’à travers la pensée, les courants de pensée qui nous permettent de le comprendre de l’intérieur.
Mais est-ce que cette pensée permet véritablement d’agir sur le monde ?
Oui. Mais elle montre d’abord les limites de l’action. Marx disait que les philosophes jusqu’ici avaient interprété le monde et que maintenant il s’agissait de le transformer. Mais le prométhéisme, le rêve d’une transformation absolue du monde par l’homme, est dangereux. C’est le mythe révolutionnaire qui a amené aux grandes catastrophes du vingtième siècle. Ceci dit, comprendre le monde c’est aussi vouloir agir, ne serait-ce que pour nous protéger des catastrophes et aussi pour peser dans le sens de plus de justice. Mais les choses sont subtiles : comment agit-on vraiment sur le monde ? Comment fait-on un monde plus habitable ? Un monde plus habitable, c’est aussi un monde qui est ordonné à la beauté, à un certain art de vivre et ça, c’est autre chose que la transformation proprement politique voire « révolutionnaire » pour changer les choses.
Revenons à Mai 68 qui a été une période importante dans ta formation intellectuelle. Est-ce que ça a été une période de démolition ou est-ce que cela a malgré tout permis une utile libération de la parole que l’on n’aurait pas pu imaginer avant ?
Il y a eu incontestablement les deux. Comme disait le père Michel de Certeau, en 68 on a pris la parole comme on avait pris la Bastille en 89. Il est certain qu’il y a une œuvre d’accouchement intellectuel. On essaye de réfléchir plus profondément à notre condition, à ce qui se passe. Une période de démolition aussi, oui. Il y a des gens qui ont vécu durement les conséquences de 68, ne serait-ce que par l’éclatement de la cellule familiale. Cela n’a pas été sans conséquences graves et à longue portée. Sans compter des mouvements culturels qui ont amené à des catastrophes humaines, les phénomènes de drogue, etc. Il y a aussi un nihilisme rampant. Les anciennes idéologies ont été contestées, mais du coup, une grande incertitude s’est répandue sur une société déstabilisée. L’Église catholique a été très touchée par la crise des années 60 avec une rupture qui a amené la fin des grandes congrégations religieuses, le déclin du clergé. Mais ce serait un autre chapitre considérable à écrire. Je l’ai esquissé dans quelques-uns de mes livres. Je m’en sortirais provisoirement par une formule célèbre : « Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve » (Hölderlin). J’ai assisté depuis les années 60 à un véritable effondrement de civilisation, et en même temps à la naissance d’une espérance qui prend parfois un visage. Je pense à celui de Jean-Paul II.
Que retiendrais-tu dans les dialogues positifs que ça a pu ouvrir ?
Au-delà de ce que j’ai déjà dit, je pense, aux frontières de la philosophie et de la théologie, à un renouveau qui est encore appelé à se développer. J’ai découvert René Girard à la publication de ses livres fondateurs comme La violence et le sacré. Il a révolutionné la pensée, avec des implications au-delà de la littérature, de l’ethnologie. On s’aperçoit que la théologie en est marquée, la politique évidemment aussi.
Je pense également à un auteur considérable qui s’inscrit dans le mouvement de la phénoménologie et qui a développé une pensée puissante et originale. Significativement, elle est de même à la frontière de la théologie. Il s’agit de Michel Henry dont les derniers livres ont été écrits dans l’intimité de l’évangile de Saint Jean. Pour moi, il s’agit là d’événements qui dépassent leur temps.
La rencontre avec un intellectuel est-elle le prolongement nécessaire de la lecture de ses livres ?
Ça a été un grand bonheur et une grande chance de faire la connaissance d’un certain nombre de gens qui m’ont marqué. Clavel je l’ai lu, mais je l’ai rencontré, j’ai eu des conversations avec lui qui m’ont permis de le mieux connaître et de le mieux comprendre. J’ai dans la tête des souvenirs inoubliables, notamment une montée de la colline de Vézelay jusqu’à la basilique. Je le revois encore face à face avec Pierre Boutang, son complice de toujours. Des rencontres de cette nature font le charme d’une existence. Et puis on ne saurait passer tout son temps dans les livres. Ceux-ci s’inscrivent dans l’histoire qui se fait, et à laquelle on tente, même modestement, de s’associer. Je ne pourrais faire la liste de tous les livres que j’ai avalés depuis mon adolescence ni même établir le catalogue des quelques milliers d’articles que j’ai pu écrire. Mais tout cela perdrait beaucoup de son sel et de sa densité, si l’on perdait de vue l’histoire vécue. En deux mots, j’appartiens à cette génération qui a vu la chute du marxisme. J’ai donc été mêlé aux mises au point, aux redéfinitions radicales qui nous ont fait changer d’époque.
J’ai déjà évoqué l’importance de François Furet. Je ne l’ai pas souvent rencontré, mais sa conversation a eu sur moi des effets dont je me suis rendu compte par la suite. Lorsqu’il m’a expliqué ses relations très singulières avec le Nouvel Observateur et l’intelligentsia, j’ai encore mieux compris son travail critique non seulement dans le domaine historiographique, mais aussi dans celui de l’analyse politique. J’aurais beaucoup à dire à ce propos qui concerne la part de l’histoire des idées associée à la chose publique. Qu’on me permette encore un souvenir, celui d’une rencontre à l’archevêché de Paris, lors d’une réunion pour préparer le bicentenaire de la Révolution française. Furet était en face du cardinal Lustiger parmi d’autres historiens. J’ai eu le sentiment de vivre un moment clé, où tout se remettait en perspective : l’Histoire au sens général du terme, les idées, l’Église et toutes les interconnexions possibles. Vingt ans avant, c’était impensable. Remettre en cause l’historiographie jacobine ou marxisante, c’était s’exposer aux pires invectives.
Quels ont été les auteurs, outre ceux que tu as déjà cités, qui ont le plus marqué ta vie de lecteur ?
J’ai analysé des centaines et des centaines de livres dans des domaines très divers. Je songe à l’histoire qui ne se résume pas au nom de François Furet. Je pourrais parler de Pierre Chaunu qui m’a beaucoup impressionné autant par ses capacités de travail décapant que par ses qualités de cœur, d’Emmanuel Le Roy Ladurie, de Georges Duby, et de tant d’autres. Au moment du bicentenaire de la Révolution déjà évoqué, j’avais mis le nez dans l’immense littérature des deux siècles écoulés. J’ai lu ainsi Michelet et fait la découverte de Taine, proprement inoubliable. J’avais même commencé sur le moment un livre dont les deux premiers chapitres sont perdus dans mes archives. Mais ce travail n’a pas été vain. Il n’a cessé de nourrir mes réflexions sur les sujets les plus divers, notamment sur l’amour et la famille. Et je m’aperçois qu’il me faut saluer impérativement au passage le grand souvenir de l’extraordinaire Philippe Ariès et la présence stimulante de Michel Rouche.
J’ai parlé de la théologie, comment ne pas dire ma proximité avec l’équipe de la revue Communio. Jean-Luc Marion, Rémi Brague, Jean Duchêne et beaucoup d’autres me renvoient à toute une galaxie intellectuelle à laquelle je dois énormément. Je suis forcément ingrat dans ce retour sur mon passé. Les visages se bousculent. Par chance il y a tous ceux que je puis rencontrer dans Paris. Il y a aussi tous les disparus : un Jean-Marie Domenach et son entourage d’Esprit. Le grand économiste François Perroux, rencontré dans ses dernières années, a laissé aussi sur moi une trace indélébile. Je reste très ignorant dans cette discipline, mais il m’arrive de rouvrir ses œuvres majeures.
Et puis, parce qu’il faut bien conclure, j’évoquerais cette autre figure aimée et inoubliable : le cardinal Jean-Marie Lustiger. Ce fut une chance assez prodigieuse pour moi de pouvoir l’approcher souvent. Il s’est identifié à un moment de l’Église, bien au-delà de Paris. Peut-être aurai-je aussi l’occasion d’exprimer un jour tout ce dont je lui suis redevable et tout ce dont il est le symbole pour hier et pour demain.
Quels sont les auteurs que tu aurais aimé rencontrer et que tu as manqués ?
Il y a un homme que je n’ai pas rencontré et avec qui j’aurais bien aimé parler, c’est Philippe Muray ! Lorsque j’ai lu Le XIXe siècle à travers les âges, j’ai été littéralement ébloui. Je ne crois pas avoir manqué grand-chose par la suite de toutes ses publications, sauf le domaine des romans que j’ai laissé de côté. Je me suis retrouvé pour ses obsèques en l’église Notre-Dame-des-Champs avec l’impression curieuse d’une rencontre manquée. Mais une vie entière ne suffit pas pour épuiser les possibilités de contacts avec les gens que l’on a estimés. Je n’ai rencontré ni Jacques Ellul, que de proches amis interrogeaient pourtant fréquemment, ni Paul Ricœur et c’est de ma faute… En revanche, j’ai eu la grâce de côtoyer René Girard, le père Bernard Bro et tant d’autres dont je demeure tributaire !