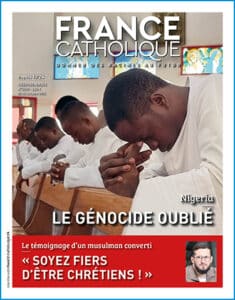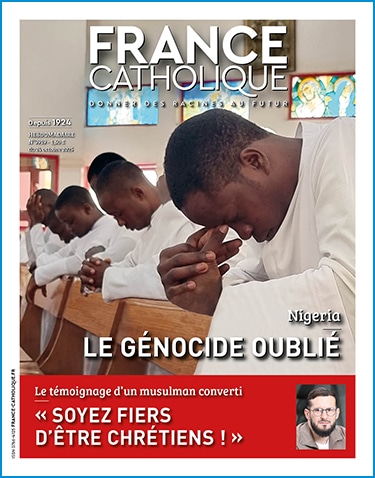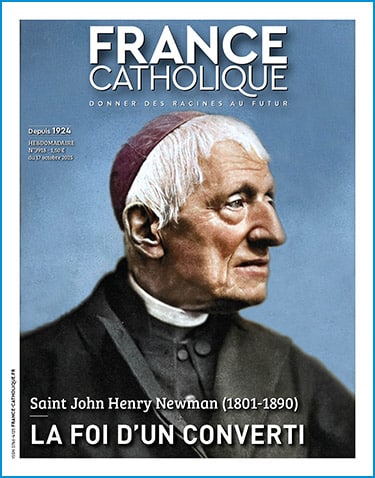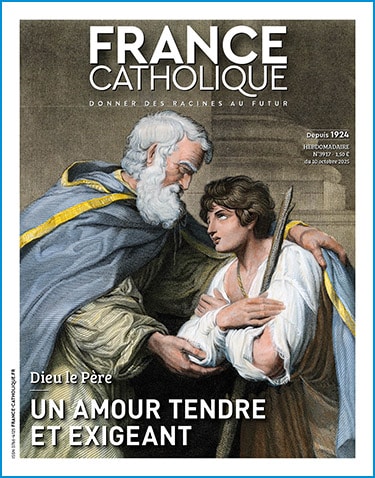La réforme de l’Islam, que d’aucuns réclament à grands cris, se produit sous nos yeux. On est aveuglé peut-être parce que les uns et les autres ne donnent pas le même contenu au mot « réforme » : on entend les uns appeler un Luther, les autres réclamer un concile Vatican II. On oublie le principal : Calvin. L’Islam traverse bel et bien une période d’effervescence réformatrice que la fin des empires a libérée. Ne le reconnaît-on pas implicitement en lui conférant le vocable de « fondamentalisme » hérité du mouvement de réveil religieux protestant américain des années 1920, vivant jusqu’à présent ?
Il conviendrait donc de réévaluer dans cette perspective les études traditionnelles sur les guerres de religion en Europe. Si les situations nationales sont bien connues, les interactions transversales, transfrontalières, sont parfois négligées. L’un des mérites de l’ouvrage de Blandine Kriegel (« la République et le Prince moderne », PUF, 2011) est de révéler l’influence à l’origine de l’indépendance des Provinces-Unies (actuels Pays-Bas et Belgique, étendus à la Flandre et à l’Artois pas encore devenus français) de quelques intellectuels réformés français, les monarchomaques. Interactions également avec des penseurs germaniques, scandinaves, anglais et écossais (encore indépendants). Interactions qui se poursuivront dans l’histoire vers les Etats-Unis, l’Afrique et l’Asie (la Corée est aujourd’hui l’une des nations les plus dynamiques sur la cartographie réformée).
La mise en valeur de l’internationalisation du fait religieux, de sa mondialisation, dépasse aujourd’hui le cadre de la « mission ». S’il a toujours paru inhérent à la catholicité, on ne l’avait jamais trop associé à la Réforme pour la bonne raison que c’était elle qui semblait responsable de l’organisation dite westphalienne du monde, du nom des traités de Westphalie (1648) qui avaient mis un terme à la guerre de trente ans et aux guerres religieuses. L’indépendance des Provinces Unies dès 1581, la création de l’Eglise d’Angleterre, avaient anticipé ce mouvement de nationalisation du fait religieux, qui imprégnera également les pays dits catholiques.
Ce mode de raisonnement privilégiait les formes politiques associées aux idées de souveraineté, luthériennes, anglicanes, gallicanes, sur le mode du « Prince », non plus celui de Machiavel restreint aux cités italiennes, mais du « prince moderne », comme celui d’Orange-Nassau (plus tard transposé à Londres), ou celui de Brandebourg (future Prusse), des fondateurs d’Etats. Blandine Kriegel décrit justement ce « moment hollandais ».
Par comparaison, l’on minimise trop souvent les formes dites « extrêmes » de la Réforme, politiquement moins assimilables, moins souverainistes qu’internationalistes, comme les Anabaptistes et de manière générale les Calvinistes. Si les premiers ont été écrasés dans leur cité-modèle, Münster (1534), les seconds ont su à l’inverse ériger leur cité d’origine, Genève, en centre international, à la manière de Rome, mais sans la papauté.
Or c’est ici que le parallèle avec l’Islam ressurgit : issu de Médine, la cité-Etat par excellence, (Médine voulant simplement dire ville en langue arabe), l’Islam s’est répandu à travers le monde sans jamais théoriser l’Etat, la nation ou la république, mais la « Communauté des croyants » (Umma), ce qui correspond à l’idée de « Commonwealth » développé sur la base du modèle religieux « congrégationnel » ou « presbytérien », comme il s’appelle en Ecosse (qui a plus directement influencé la formation des Etats-Unis que les « Pilgrim Fathers » de Nouvelle Angleterre, certains « puritains », d’autres non, à ne pas confondre avec les « Founding Fathers » en majorité franc-maçons, de l’indépendance américaine un siècle et demi plus tard). L’idée de contrat ou d’alliance est très présente dès les débuts de l’Islam, sinon dans le Coran lui-même, comme les Réformés, spécialement chez Calvin, la déduisaient de l’Ancien Testament (« covenant »).
Le défi des traités de Westphalie n’était pas seulement adressé aux Empires et à l’autorité temporelle de la Papauté (qui les condamnera) mais aussi à la liberté religieuse revendiquée par les « communautés de croyants » se refusant à adhérer à la religion du « Prince » (Cujus Regio ejus religio). Tout l’effort du droit international, dans la lignée d’un autre hollandais remarquable, Hugo Grotius (persécuté chez lui, il ne dût sa vie qu’à son exil en France), a tendu à « gommer les aspérités » religieuses des « radicaux » ou des « fondamentalistes » comme on dira plus tard, ou les ultra-calvinistes, pour pouvoir les faire entrer dans le moule westphalien.
J’ai longtemps pensé que l’effort du droit international contemporain devait viser à faire de même avec les nations du tiers-monde. Au cours du XXe siècle, le système put ainsi intégrer progressivement les nations dites révolutionnaires, communistes, soviétiques ou chinois, ou non-alignées. L’Islam continue à faire difficulté, dans sa dimension extra-souveraine, ou supra-nationale, comme nos ultra-calvinistes hier. « Nationaliser » l’Umma, n’est-ce pas conduire à figer l’alliance du prince et de la mosquée, de l’Etat et de la religion (Din wa Dawla) que l’on reproche déjà à l’Islam de ne pas séparer ? Ce qui est possible au Maroc, ou en Arabie saoudite, peut-il être reproduit ailleurs ?
On ne parle ici que du sunnisme, puisque le chiisme connaît un mode d’organisation politico-religieux complètement original. La Turquie est également un cas à part. Hormis ces quelques pays, la situation n’est pas stabilisée, ce qui favorise l’éclosion de tous les mouvements de « réforme » les plus divers et les plus aberrants. Une réflexion à la fois théologique et pratique est plus que jamais nécessaire.