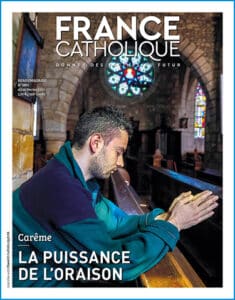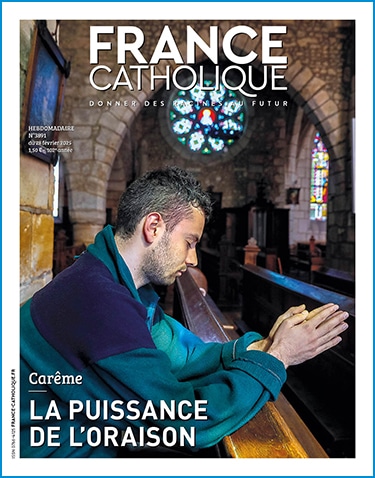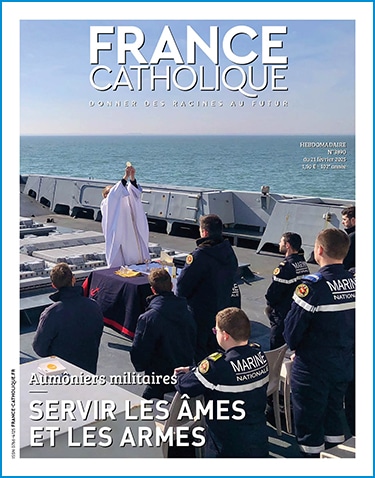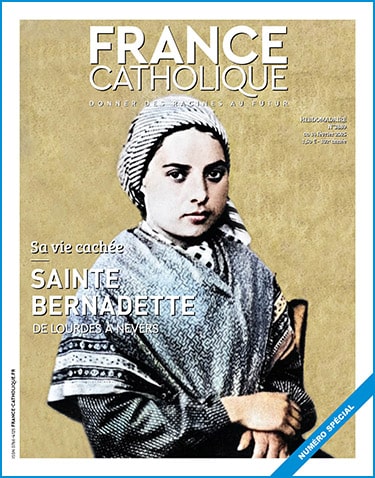« Si c’était à recommencer, disait Einstein, je me ferais plombier-zingueur. » Sans vouloir médire des plombiers-zingueurs, il existe, du moins en France, une autre profession très recherchée et jouissant de la considération générale : c’est celle des signeurs de manifeste.
Le signeur de manifeste est un personnage investi d’une autorité morale, d’un discernement et d’un prestige surhumain. La preuve, c’est qu’il est toujours prêt à nous éclairer quand nous n’y voyons guère et à trancher quand nous hésitons. Et la preuve que c’est par investiture qu’il sait faire tout cela et par qualification professionnelle, c’est la stabilité de sa profession : ce sont toujours les mêmes qui signent. Par exemple, j’ai voulu un jour trouver un manifeste ne portant la signature ni de Jean-Paul Sartre, ni de Simone de Beauvoir, ni de Jacques Monod. Il m’a fallu abandonner à une date reculée cette recherche sans espoir. Il existe certainement, signé de ces trois noms illustres, un manifeste réclamant pour les philosophes le droit d’embêter la postérité en buvant de la ciguë.
Sauf erreur (car seul un spécialiste peut se tenir au courant de la question), le plus récent des manifestes réclame le droit à l’euthanasie. Ce manifeste fermera sûrement la bouche aux derniers rebelles qui, de temps à autre, s’élèvent encore pour dire que les signeurs n’en savent pas plus que vous et moi : jamais, en effet, leur profession n’avait produit un document montrant plus clairement qu’ils savent justement ce que le commun ignore. 1
L’accorder à qui la demande ?
C’est ce que je m’en vais montrer ici dans l’espoir de me faire bien voir, d’être un jour admis dans la corporation très fermée des signeurs, et d’atteindre ainsi à la juste notoriété que le public, toujours très bouché, risquerait de refuser à mes seuls travaux personnels.
Supposé réglé le problème mineur de savoir si l’on a le droit de tuer, la difficulté avec l’euthanasie, c’est de dire clairement qui l’on va tuer pour son bien et de le dire assez clairement pour que n’importe qui ne se mette pas à tuer n’importe qui sous la protection de la loi.
Commençons par le cas apparemment le moins embarrassant, celui du souffrant qui réclame lui-même la mort. Faut-il accorder la mort à qui la demande ?
Mais d’abord, il existe des douleurs passagères tellement atroces qu’avant l’invention des calmants et des analgésiques, une forte proportion des patients se suicidaient. Par exemple, dans certaines névralgies faciales. À ceux-là, évidemment, il faudra donner le médicament qui calme, et non pas la mort, puisque la douleur passée, ils se retrouvent tout heureux de contempler encore la lumière du jour.
Décidons alors que nous n’accorderons la mort qu’au patient qui :
1. la demande,
et :
2. n’a aucune chance de s’en tirer. Sommes-nous sortis de nos difficultés ?
Non. Car, d’abord, celui qui la demande, même s’il n’a aucune chance de s’en tirer, cessera souvent de la demander après l’administration d’une drogue adéquate. Le moribond va donc demander ou non la mort selon que le médecin choisira de lui donner ou non telle ou telle drogue ; c’est le médecin qui va décider si la mort sera demandée ou non.
Dès lors, et compte tenu de l’arsenal existant de la pharmacologie, ou allons-nous ? Seul un signeur juré pourra le dire, car il existe des drogues qui provoquent littéralement l’angor mortis (a). Ces drogues ont un effet pharmacologique primaire. Mais par-dessus le marché, elles donnent envie de mourir. Nous voici affrontés à la responsabilité du médecin. C’est aussi le médecin qui va dire si le malade a ou non une chance de s’en tirer.
Admettons qu’il existe des cas parfaitement clairs. Il y a ceux qui le sont moins, et ceux qui ne le sont pas du tout. 2
Un choix solitaire
Seul le médecin peut trancher. Devant qui sera-t-il responsable de son choix ? Devant lui-même ? Je doute que les médecins soient disposés à accepter une situation où l’on pourrait les soupçonner d’avoir donné la mort impunément par intérêt 3. Devant les proches du malade ? Voilà qui, assurément, simplifiera beaucoup de successions délicates, divorces à l’italienne et autres situations exigeant une prompte expédition. Devant la loi ? La loi étant impuissante à définir l’infinie variété des cas cliniques, voilà le médecin renvoyé à son choix solitaire.
Certes (toujours supposé réglé le problème du droit de tuer), on pourra toujours citer des cas où le bon sens et l’humanité réclament clairement une mort prompte et douce. Mais pour tuer, il faut une loi 4, et si le bon sens et l’humanité pouvaient se définir légalement avec précision, cela se saurait. On les aurait depuis longtemps rendus obligatoires, comme le service militaire.
Ce mystère qui l’a sondé ?
Et enfin, il y a le mystère de la mort 5. Le dernier numéro de la revue Question de publie le témoignage d’une infirmière dont le métier est d’assister les mourants (b). Elle a vu mourir des centaines et des centaines d’êtres humains. Écoutons-la :
« (Même) des gens qui n’ont pas habituellement d’intuition vivent, au moment de leur mort, des choses qu’ils ne connaissaient pas 6… Comme si leur esprit libéré de leur corps s’agrandissait, sortait des limites de la matière… Certains ont vraiment l’air de savoir où ils vont… Depuis que j’ai vu cela de près, c’est assez semblable pour la mort de n’importe quel être, bien que les circonstances soient totalement différentes… On se dit alors : le mystère est beaucoup plus proche de nous qu’on ne croit. » 7
Ce mystère de la mort, qui l’a sondé ? Depuis le commencement du monde, personne, à part Lazare et quelques messieurs du Tout-Paris intellectuel. Si vous avez oublié leurs noms, ne vous impatientez pas et attendez le prochain manifeste, qui ne saurait tarder.
Aimé MICHEL
(a) V.-G. Longo : Neuropharmacology and Behaviour (W. H. Freeman, édit., San Francisco, 1972).
(b) Mon métier est la mort, par Geneviève X…, dans : Question de, N° 4, p. 21 (114, Champs-Élysées, Paris-8e).
(*) Chronique n° 196 parue dans F.C. – N ° 1441 – 26 juillet 1974. Reproduite dans La clarté au cœur du labyrinthe, chap. 10 « Biologie et éthique », pp. 290-292.
Les notes (1) à (7) sont de Jean-Pierre ROSPARS
Actualité du 5 septembre 2011
Division des professionnels sur l’affaire Bonnemaison
http://www.genethique.org/revues/revues/2011/Septembre/20110905.2.asp
- Aimé Michel poursuit ici une réflexion déjà engagée dans les chroniques n° 190, Avortement et biologie (11 juillet 2011) et n° 191, La biologie moderne et les choix moraux (2 août 2011). Ces deux textes sont reproduits au chapitre 10 de La clarté au cœur du labyrinthe, Aldane, 2008.
- En 1987 et 1988 Aimé Michel hospitalisé (voir les chroniques Fidélité de Teilhard, in La clarté au cœur du labyrinthe, op. cit. p. Erreur : source de la référence non trouvée, et Dans la nuit de l’hôpital, p. Erreur : source de la référence non trouvée) entend les cris de souffrance de patients condamnés. Ceux-là lui parurent, me sembla-t-il quand il m’en parla, au nombre des cas parfaitement clairs. Plusieurs drames récents ont attiré l’attention. Ce fut Marie Humbert en 2003 qui accéda au vœu de son fils Vincent en le faisant entrer dans un coma profond : il était tétraplégique, muet et aveugle depuis plusieurs années. Ce fut Chantal Sébire en mars 2008 qui mit fin à ses jours en raison de souffrances intolérables dues à une tumeur des sinus et de la cloison nasale.
- Le comité d’éthique (CCNE) et les sociétés savantes médicales ont confirmé la réticence des médecins à exercer cette responsabilité ultime : « Donner la mort ne relève pas de la compétence du médecin qui a prêté le serment d’Hippocrate ». Cependant des médecins célèbres comme les professeurs Alexandre Minkovski et Léon Schwartzenberg ont déclaré avoir mis fin à la vie de certains patients, grands prématurés promis à une vie végétative ou malades cancéreux sans espoir.
La situation actuelle a été résumée ainsi par le ministre de la Santé le 25 janvier 2011 lors d’une discussion au Sénat : « Ce qui est en jeu, c’est l’angoisse de souffrir. Les soins palliatifs permettent de les apaiser : ils soulagent la douleur, accompagnent la peur de la solitude, soulagent le sentiment d’indignité. L’accompagnement psychologique joue un rôle essentiel. C’est la loi. Il faut la faire connaître, pour qu’elle soit mieux appliquée. (…) Elle proscrit l’acharnement, autorise l’arrêt de traitement et la prescription d’antalgiques. Quand le malade est inconscient, la volonté qu’il a exprimée antérieurement prévaut, ou le témoignage de ses proches. » (http://www.senat.fr/cra/s20110125/s20110125_14.html)
- Ce point est contesté par certains. Dans son autobiographie, Mon évasion (Grasset, 2008, Livre de Poche n° 31837, pp. 343-344), la romancière et essayiste Benoîte Groult, célèbre pour son engagement féministe, inscrite à l’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité (ADMD) depuis 1982, écrit : « “On ne va tout de même pas légiférer sur la mort”, s’écrient nos bons apôtres. Or il ne s’agit nullement de faire une nouvelle loi, mais au contraire d’en supprimer une vieille, qui fait de l’aide à mourir un crime. Tout comme l’IVG en 1975, il ne s’agissait pas de légiférer mais d’abroger la vieille loi de 1920, qui faisait de l’avortement un crime. » Ce point de vue établit une différence nette entre les vies pleines et entières dont l’interruption est un crime et diverses formes de demi-vies qui peuvent être interrompues.
- Cette évocation finale du mystère de la mort replace le débat entre partisans et opposants de l’euthanasie dans sa véritable perspective.
Pour les premiers ce « mystère » est négligeable, la mort est une fin définitive, rien n’existe au-delà, l’homme est seul maître du jeu et le combat pour l’euthanasie est dans la continuité de luttes séculaires, audacieuses et courageuses pour les libertés, le progrès, la modernité, contre le conservatisme rétrograde des « bien pensants ».
Pour les seconds le mystère est réel, la mort n’est pas une fin, l’homme n’est pas seulement une individualité, eux aussi entendent lutter pour un monde plus humain et moins souffrant et ne s’estiment pas moins porteur de la modernité véritable. Une plage de recouvrement des objectifs pratiques paraît donc exister malgré les options métaphysiques irréconciliables.
Laissons la parole à deux personnalités représentatives des pro- et des anti-euthanasies :
Benoîte Groult dans son autobiographie (op. cit., pp. 342-344) présente un plaidoyer en faveur de l’euthanasie et poursuit son parallèle avec l’IVG en ces termes : « Que la formule du “laisser-mourir”, inventée par M. Léonetti sans frémir, soit considérée comme une avancée en France, me paraît consternant. Elle ramène en arrière au contraire, aux temps que j’ai bien connu du “laissez-les vivre”, inventé par les mêmes bien-pensants. Faute de budget, faute de structures, faute de volonté publique surtout, les conséquences de la loi Léonetti, dans les rares cas où elle est appliquée, commencent à apparaître dans toute leur cruauté. Un exemple récent suffit à l’illustrer : au lieu de lui injecter une dose létale, les médecins de Denis P., 28 ans, dans le coma depuis huit ans, ont choisi de le débrancher en application de la loi, le livrant pendant une semaine à de torturantes convulsions, auxquelles ont dû assister ses parents impuissants, en l’absence de tout secours médical puisque les débrancheurs avaient appliqué la loi, toute la loi, mais rien que la loi. Marie de Hennezel, la croisée des Soins palliatifs pourtant, vient d’ailleurs de le reconnaître : depuis trois ans aucun ministre de la Santé n’a jugé nécessaire de prévoir un budget et de mobiliser les services hospitaliers pour assurer l’accompagnement décent des patients en fin de vie. L’échec est patent : il faut euthanasier la loi Léonetti avant qu’elle ne fasse d’autres victimes. (…) Le simple fait de pouvoir ouvrir un dossier, de savoir qu’on pourra être aidé le jour venu, apaise l’angoisse et apporte une telle sérénité que les demandes d’euthanasie ont nettement diminué depuis cinq ans aux Pays-Bas, qui a la plus longue expérience en cette matière. » Conclusion surprenante qui conforte l’idée que l’euthanasie n’est réclamée que faute de mieux…
Dominique Laplane, professeur honoraire de neurologie à la Salpétrière, co-fondateur et vice-président de l’Association pour les Soins Palliatifs (ASP), dans Un regard neuf sur le génie du christianisme (éditions François-Xavier de Guibert, Paris, 2006, pp. 232), après avoir rappelé l’efficacité des soins palliatifs (qui commencent mais ne se limitent pas à un traitement de la douleur et de l’angoisse), estime que sur cette question des soins aux mourants « la réponse purement “laïque” (…) ne va pas au-delà de l’euthanasie, entendue comme mort donnée par son semblable, si possible choisie par l’intéressé et administrée par qui veut bien s’en charger si le patient n’a pas la force de se suicider. (…) J’entends bien que, sous la pression de la comparaison, l’ADMD a fini par mettre au premier rang de ses revendications la lutte contre la douleur. Mais c’est tout ce qu’elle a retenu des soins palliatifs. Où est l’aide aux patients, où est leur écoute (…) ? Où est l’attention portée aux familles, le suivi du deuil qui pourrait après tout, s’appliquer aux familles des euthanasiés ! Tout cela est sans doute de peu d’intérêt pour elle. D’un côté on dit : “je comprends bien que dans ton état tu veuilles mourir… Cela demande seulement quelques formalités. Mais on va t’aider”. Cela n’exige à coup sûr aucun investissement personnel. De l’autre côté, on dit : “viens avec nous, vis ta vie jusqu’au bout ; ta peine on t’aidera à la porter, ne crains pas la mort, tu ne souffriras pas, tu ne seras pas seul, pense aux tiens, relis ta vie si tu le désires. Et le fait est que dans les services de soins palliatifs, les demandes d’euthanasie, quand elles existent au départ disparaissent presque toujours. Aux grands vieillards, aux futurs Alzheimer, nous disons : “même si tu es décati, gâteux, enlaidi, nous t’aimerons (c’est-à-dire : nous nous efforcerons de te faire vivre au mieux) tel que tu es, tel que tu seras, nous te respecterons et nous honorerons ta dignité d’homme. Entre nos mains tu mourras dans la dignité”. »
- La citation complète est : « (…) des choses qu’ils ne connaissaient absolument pas et qu’on peut vérifier. » Et un peu plus loin : « C’est alors que des dialogues qui semblent aberrants au niveau humain deviennent peut-être compréhensibles. Par exemple, un malade qui est seul, ne peut voir personne placé là où il est, et qui dit : “Ah ! tu es venu ! Ah ! bonjour ! c’est merveilleux de te trouver là !” On peut dire qu’il délire mais, si on entend des centaines dire des choses pareilles, cela pose des questions. »
- Il s’agit du témoignage d’une infirmière de vingt-sept ans. En deux ans elle a assisté plus de trois cents mourants dans un hôpital parisien tenu par des religieuses où différents « patrons » envoient leurs malades incurables. À leur arrivée « ils sont souvent non pas inconscients mais abrutis » par des calmants forts qu’on leur a administré « pour une quantité de raisons (et surtout le manque de personnel soignant) ». « Mais ici, explique l’infirmière, on a comme habitude (…) d’essayer de les désintoxiquer pour qu’ils reprennent conscience de leur être », car « on arrive, avec des associations de calmants dits “mineurs”, à calmer assez bien ». Elle explique le déni des malade (« il y en a bien peu qui disent : “Je veux savoir ce que j’ai !” ») et celui des familles (« les malades ne s’intéressent plus à la vie courante. Au lieu d’essayer d’établir autre chose, les visiteurs s’en vont » ; à l’approche de la fin, parfois ils reviennent, « non par curiosité mais par soif d’apprendre »). Elle observe la force de la vie (« la vie est forte même quand on est malade. Même un vieillard, même celui qui se dit : “Je suis au bout du rouleau, je vais partir”, a des réactions pour garder sa vie »), mais aussi sa limite (« la personne qui veut se laisser mourir, qui largue ses amarres, peut mourir en très peu de temps : il n’y a plus de ressort, plus de répondant, la maladie gagne à ce moment-là. La maladie est une sorte de désespoir, comme si le malade coupait lui-même les réactions de son organisme. » Elle exprime son refus de l’obstination thérapeutique : « Quand quelqu’un va mourir, il y a des gestes que je suis obligée de faire : un tonicardiaque, de l’oxygène pour aider à respirer etc. (…) Au début je ne pouvais pas les faire, j’étais obligée d’envoyer quelqu’un d’autre ; j’étais révoltée ; je savais très bien que le malade allait mourir et que ce n’était pas la peine de jouer la comédie. Mais on ne peut rester les bras croisés devant un mourant, ne serait-ce qu’à cause des autres malades qui se diraient : “Alors, si j’ai un malaise, on va me laisser mourir ?” ». Rares sont les patients qui ont la foi (« La foi, ce n’est pas le lot commun des gens. Ils sont pour la plupart catholiques, mais ce n’est pas cela qu’ils mettent en avant »), mais plus nombreux sont ceux qui espérent en un « autre monde » (« Il y a des tas de gens qui semblent vraiment médiocres et assez bas au niveau de la conscience, et qui ont quand même cette… espérance − le mot n’est pas trop fort. On se demande si c’est parce qu’ils le voient, de là où ils sont, avec une puissance d’esprit qui viendrait (…) une vision que l’on n’a pas, nous (…). Un regard nouveau sur les choses, découvrir le sens nouveau des choses, savoir des choses que les gens ne savent pas » ; ici se place la citation retenue par Aimé Michel, complétée à la note précédente). Enfin survient le dépouillement : « Quand on meurt, on lâche vraiment son corps physique. Les mourants ont souvent ce geste de vouloir se dénuder, il y en a même qui arrive à articuler : “Ouvrez la porte, ouvrez la fenêtre, ôtez-moi ça !” Ils repoussent les couvertures comme s’ils voulaient écarter les atomes de la matière pour s’en aller. Au niveau de la démarche intérieure, c’est très profond. »
Dans le même numéro de Question de, ce témoignage est suivi d’une méditation d’Aimé Michel sur la mort, intitulée Si tu n’étais immortel, l’un ayant peut-être suscité l’autre. Elle se termine par ces mots empreints de stoïcisme et d’espoir : « Tu ne passerais pas si tu n’étais immortel. Car il est vrai que ta machine passe, mais elle n’en sait rien. Toi qui sais que tu passes, tu ne passes donc pas. (…) Là où tu vas, tu ne cesseras de devenir plus que toi-même, éternellement. Déjà tu es plus que tu ne fus. Aime donc la vague qui te porte. Aime le rocher qui la brise. Aime les ténèbres où tu voyages et qui déjà t’ont conduit où tu es. Ces ténèbres t’aiment, puisqu’elles t’ont tiré des étoiles. Elles savent ce que tu ignores. Là où tu vas, depuis toujours elles t’attendent. Avant que tu ne fusses, elles sont. Et si c’est par la mort qu’elles te font, c’est que la mort est le chemin de la vie. »