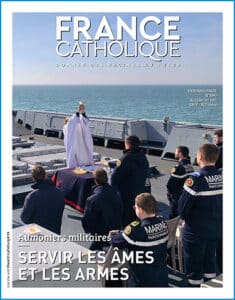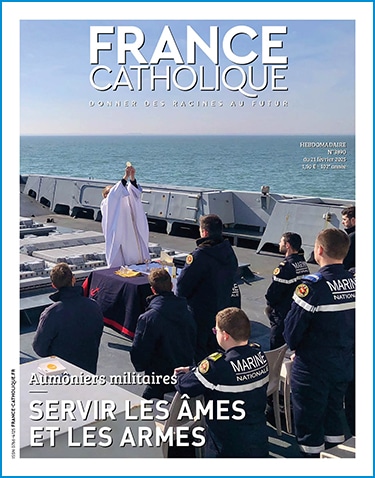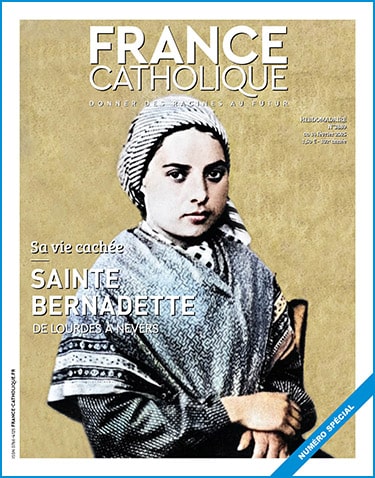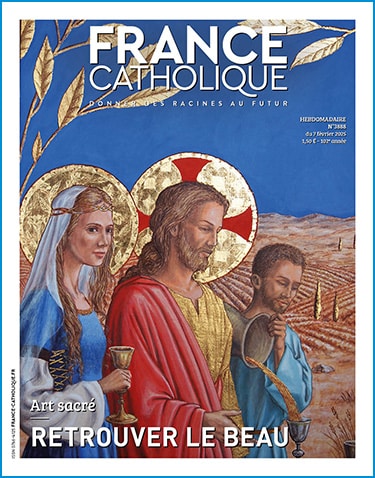L’ardeur des affrontements électoraux nous cache que, sur certains points essentiels, tous les adversaires sont désastreusement d’accord. Personne ne met en cause l’orientation actuelle de l’expansion industrielle. Personne ne conteste que la vie citadine à l’occidentale ne soit destinée à devenir un modèle universel, valable naturellement pour la campagne française dépeuplée, mais aussi à la longue pour le monde entier, tiers monde compris. Seuls quelques esprits solitaires, comme Jacques Ellul, discutent ces postulats indiscutés. On ne les écoute guère.
Voici pourtant quelques faits qui invitent à la réflexion. Contrairement à ce qu’on croit, ce n’est pas la progression du cancer qui constitue le premier problème dans les pays hautement industrialisés. Ce sont les maladies mentales 1 . Plus un pays est « évolué », plus les maladies mentales se multiplient 2. Aux Etats-Unis, le nombre des lits occupés dans les hôpitaux par les malades mentaux dépasse depuis 1956 celui de tous les autres malades réunis (a).
Une suprématie peu enviable
Alors que les désordres mentaux sont à peu près égaux chez tous les peuples dans des conditions comparables, on constate qu’il y en a deux fois plus dans les villes que dans les campagnes. Plus la ville est grande, plus la proportion augmente. L’accroissement est encore plus net si l’on tient compte de la densité démographique, c’est-à-dire de l’entassement. Les hommes donnent nettement plus de malades mentaux que les femmes 3.
Mais c’est chez les enfants que le drame de la maladie mentale est le plus clairement observable et où l’on voit le mieux en quoi il est lié à la vie moderne.
Voici par exemple une statistique établie par deux Américains, Yerbury et Newell (b). Ces deux auteurs ont étudié 56 enfants psychotiques et comparé les traits observés avec les caractéristiques correspondantes de 56 enfants normaux pris au hasard.
On ne s’étonnera pas de trouver d’abord confirmée l’importance du facteur héréditaire dont j’ai parlé dans ma dernière chronique 4. Sur les 56 enfants psychotiques, 38 avaient des parents également psychotiques, alors que l’on ne trouve, parmi les parents des 56 enfants normaux, que deux psychotiques ; de même, sur 56 enfants malades, 50 ont des frères ou sœurs psychotiques, alors qu’on n’en trouve que deux dans les familles des enfants normaux.
Mais d’autres facteurs apparaissent dans les chiffres, qui montrent que le terrain héréditaire ne suffit pas à faire apparaître la maladie mentale précoce.
Parmi ces 56 petits malades mentaux, on en trouve 45 qui sont des « cas sociaux », 24 qui n’ont pu être élevés dans leur famille, 33 qui habitent des zones insalubres, 43 qui vivent dans un environnement « turbulent », 29 dont la famille est indigente, 22 qui ont subi des brutalités, 33 qui sont livrés à des autorités contradictoires, 31 dont la mère a eu une grossesse agitée, 22 dont la famille est « dépendante » (c’est-à-dire que leurs parents sont des « gens de maison »).
L’examen des chiffres correspondants chez les enfants normaux n’est pas moins significatif : il y a des épreuves plus ou, moins néfastes à la santé mentale de l’enfant. Par exemple, il ne se trouve aucun enfant normal, parmi ces 56, qui ait été élevé dans une maison de placement ou un orphelinat. Cela n’implique nullement l’inverse, bien entendu. On peut avoir été élevé ainsi et avoir préservé son équilibre. Mais il est certain que c’est plus difficile : la dissolution de la famille est très nettement l’événement le plus désastreux pour la santé mentale de l’enfant. De même, on ne trouve parmi ces 56 enfants normaux que 8 d’entre eux dont la mère ait eu une grossesse agitée, 9 qui aient habité des zones insalubres, un dont la famille soit « dépendante », 4 qui aient subi des brutalités, un dont la famille soit indigente.
Si l’on fait le bilan de ces résultats, on constate que les psychoses, quoique largement héréditaires, apparaissent dans l’enfance à l’occasion de certains troubles familiaux, ce dont on se doutait, mais que ces troubles familiaux sont eux-mêmes essentiellement en relation avec la vie citadine, surtout sous ses aspects les plus déshérités. Particulièrement frappants sont les chiffres sur la « turbulence » de l’environnement, les zones insalubres, les cas sociaux, l’indigence, la « dépendance » des familles, les disciplines contradictoires.
Si, par opposition, on essaie d’imaginer le milieu le plus favorable à l’éclosion normale de l’enfant on est conduit à décrire assez précisément le type de vie familiale que l’évolution socio-économique actuelle est en train de détruire. Par exemple, rien n’est plus certain que le besoin du petit enfant pour la présence de sa mère. Il a autant besoin de sa chaleur, de son bavardage, de ses caresses et de son sourire que de la nourriture qu’elle lui prépare. Les découvertes de l’éthologie rejoignent ici l’observation humaine. Le petit singe séparé de sa mère, geint, il tremble, il a des cauchemars, il est effrayé de tout. Souvent il refuse de s’alimenter. Il attrape toutes les maladies. Parfois, il meurt, surtout quand il ne trouve aucun substitut stable à l’affection maternelle (c).
Les cruelles expériences faites sur les petits singes reproduisent en laboratoire ce qui s’observe dans les hôpitaux d’enfants et les orphelinats, où l’on sait que, malgré l’excellence des soins physiques, la mortalité est beaucoup plus élevée. Les petits enfants y trouvent certainement des soins matériels plus suivis et compétents que dans la majorité des familles. Et cependant, ils y sont plus susceptibles à la maladie et la mortalité y est supérieure à la moyenne.
La seule révolution nécessaire
Dans une précédente chronique, nous avons réfléchi sur des faits qui déconcertent notre idée traditionnelle de l’âme en mettant en évidence l’action du corps sur des facultés tenues pour spirituelles 5. Ici, nous constatons un effet exactement inverse. Les sourires et les tendres bavardages d’une mère n’ont rien de matériel. Et cependant, ils ont des effets matériels. Or, cette part essentielle de la vie enfantine et humaine est ignorée par l’évolution socio-économique actuelle, ce qui nous ramène aux idées développées avec autant de persévérance que de profondeur par Jacques Ellul 6 . L’exemple électoral des crèches en est un piquant et dramatique exemple. A droite, à gauche, au centre, c’est à qui nous promettra le plus de crèches. Tout le monde est d’accord là-dessus : il faut multiplier les crèches.
Mais pourquoi multiplier les crèches ? Pour permettre aux mères de travailler comme leurs maris. Et pourquoi doivent-elles travailler comme leurs maris ? Oh ! pour une foule de raisons qu’on osera difficilement mettre en question : une conception erronée de l’égalité des sexes ne fait en réalité que recouvrir ici les mécanismes sociaux propres à la société industrielle, quel que soit le régime qui la gère. La femme a droit à la « liberté du travail », tout le monde est d’accord là-dessus, de l’Amérique à la Chine. Belle liberté, qui déguise une servitude économique ! Qui nous parlera du droit de la femme à ne faire que son travail de femme, quand elle veut être mère ? 7
Mais pour retrouver des valeurs de cet ordre, il faudrait réorganiser tous nos mécanismes économiques. Il faudrait une utilisation de la technique radicalement différente. Ce serait la seule révolution nécessaire, et personne ne sait, ou peut-être ne peut, nous la proposer. On ne voit pas comment pourrait se faire cette réorganisation assurant le respect des instincts les plus fondamentaux de la nature. Jamais l’histoire n’a eu besoin de tant de patience, d’imagination et de bon sens.
Aimé MICHEL
(a) J. Coleman : Abnormal Psychology and modern Life (Glenview, Illinois, 1964).
(b) E. Yefbury et N. Newell : Genetic and environ mental factors in psychoses in children (American journal of Psychiatry, n° 100, p. 599).
(c) H. Harlow et R. Zimmermann : Affectional Responses in the infant Monkey (Science, 130, p. 42?)
Les Notes de (1) à (7) sont de Jean-Pierre Rospars
(*) Chronique n° 132 parue initialement dans France Catholique-Ecclésia – N° 1367 – 23 février 1973.
- Que recouvre exactement l’expression « maladie mentale » ? Selon P. Pichot et J.D. Guelfi (dans l’édition française du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux DSM-III ; Masson, Paris, 1983, p. 9), le trouble mental est « typiquement associé à un symptôme de douleur (détresse) ou à un handicap dans l’un, au moins, des principaux domaines de fonctionnement (incapacité) », à condition toutefois que « la perturbation ne se limite pas à la relation entre l’individu et la société. (Quand la perturbation est réduite à un conflit entre un individu et la société, cela peut correspondre à une déviance qui peut, ou non, être socialement approuvée sans être un trouble mental). ». Cette dernière remarque s’inscrit dans le débat sur l’antipsychiatrie (voir la chronique n° 37, L’antipsychiatrie et la boutonnière, parue ici le 8 février 2010) et a eu pour effet d’exclure l’homosexualité de la liste des désordres psychiatriques car les homosexuels ne répondent pas en général aux critères de détresse et d’incapacité liés à cette définition de la maladie mentale.
Cette question de définition supposée résolue, se posent les difficiles problèmes du diagnostic de la maladie mentale, de son explication et des soins à apporter au malade. Ces difficultés proviennent de ce que la frontière entre le normal et le pathologique est mal définie ; qu’un même symptôme peut être présent dans des maladies différentes et, inversement, qu’une même maladie peut se traduire par des symptômes distincts ; enfin, que les causes, multiples, de ces maladies font toujours débat. Trois types de causes sont invoqués : biologiques, psychologiques et sociales qui ne sont nullement exclusives les unes des autres. Les causes sociales peuvent aider à comprendre pourquoi certaines maladies sont propres à un pays ou à une époque. Citons par exemple la « grande hystérie » de Charcot et les « fous voyageurs » en France à la fin du XIXe, disparus aujourd’hui, ou l’épidémie des « personnalités multiples » aux Etats-Unis à partir de 1973 (Ian Hacking : L’âme réécrite. Etude sur la personnalité multiple et les sciences de la mémoire, Les Empêcheurs de penser en rond, Paris, 2006).
Aujourd’hui la classification la plus connue et la plus utilisée est celle du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) publié par l’Association américaine de psychiatrie. Apparue dans les années cinquante, elle est fondée sur la description des troubles et non sur leurs causes, car les causes présumées, notamment par les psychanalystes, ne faisaient pas l’unanimité et paraissaient trop subjectives. A l’époque où Aimé Michel écrit ces lignes, la troisième édition du Manuel (DSM-III) est en préparation. Publiée l’année suivante, l’un des changements les plus notables qu’elle introduit est l’abandon du terme « névrose » avec ses hypothèses psychanalytiques associées (complexe d’Œdipe, refoulement etc.). Dès lors les symptômes « névrotiques » ont pu être réexaminés d’un œil neuf et des troubles négligés comme les TOC (troubles obsessionnels compulsifs) être pris en compte. Ce manuel qu’on a pu qualifier de « triomphe de la psychiatrie américaine » en est à sa 4e édition (2003) et la 5e doit paraître en 2013 (voir www.dsm5.org).
Les travaux rapportés par Aimé Michel dans cette chronique portent sur les maladies les plus graves, les psychoses, mais il existe bien d’autres pathologies mentales de gravité et de prévalence fort variables. Selon le DSM-IV, ces pathologies incluent les troubles de l’humeur, que ce soit par défaut (les dépressions : diminution marquée de l’intérêt ou du plaisir, réduction de l’énergie ou augmentation de la fatigabilité) ou par excès (les manies : élévation de l’humeur avec parfois des symptômes psychotiques tels qu’idées délirantes, et hallucinations), les troubles anxieux tels que les phobies sociales (crainte d’être dévisagé), l’agoraphobie (peur des endroits publics ou de voyager seul), les attaques de paniques, l’anxiété généralisé et l’état de stress post-traumatique, les troubles somatoformes qui sont des douleurs, paralysies, cécité etc. sans cause organique identifiable, les troubles du comportement alimentaire tels que boulimie et anorexie, les troubles du sommeil, les psychoses aiguës ou chroniques (perte du contact avec la réalité, désorganisation de la personnalité et transformation délirante du vécu, dont la schizophrénie et les pathologies apparentées avec paranoïa et hallucination), les troubles du développement cognitif tels que l’autisme, les addictions aux substances (alcool, tabac, drogues) mais aussi comportementales (achats compulsifs, jeu, etc.), les perversions sexuelles (dites paraphilies), le risque de suicide.
- Une étude récente, réalisée entre 1999 et 2003 auprès de 36 000 personnes de 18 ans et plus en France métropolitaine, dresse un tableau d’ensemble des pathologies mentales. Intitulée « Troubles mentaux et représentations de la santé mentale : premiers résultats de l’enquête Santé mentale en population générale », elle a été publiée dans la revue Etudes et Résultats de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), n° 347, octobre 2004, (disponible sur Internet). Voici un résumé de quelques-uns des résultats obtenus :
Pour les troubles de l’humeur, les épisodes dépressifs sont beaucoup plus fréquents que les épisodes maniaques. Une femme a un risque 40% supérieur à celui d’un homme présentant les mêmes caractéristiques sociodémographiques d’avoir eu un épisode dépressif dans les deux semaines précédant l’enquête. C’est l’inverse pour les épisodes maniaques qui ont été repérés chez 2% des hommes et 1,2% des femmes sur la vie entière. Les épisodes dépressifs diminuent avec l’âge de 13,6% (18-24 ans) à 10,1-11,9% (25-64 ans) puis 8,9% (65-74 ans) pour remonter ensuite à 11% (75 ans et plus). La présence d’un épisode dépressif a plus fréquemment été repérée chez les personnes célibataires (13,2%), veuves (13,8%) ou divorcées (17,4%) que chez les personnes vivant en couple (8,5%). A âge, sexe, situation vis-à-vis de l’emploi et niveau d’études égaux, une personne divorcée a ainsi 2,2 fois plus de risque d’avoir eu un épisode dépressif dans les deux semaines précédentes qu’une personne mariée et un célibataire 1,5 fois plus (mais comme le rappelle les auteurs, cette corrélation ne permet pas d’en déduire que la situation matrimoniale est la cause du trouble). Le deuxième facteur le plus corrélé aux épisodes dépressifs est le fait d’être au chômage. À âge, sexe, situation maritale et niveau de formation égaux, une personne au chômage a deux fois plus de risque d’avoir eu un épisode dépressif qu’une personne en emploi. Les troubles de l’humeur diminuent avec le niveau de scolarité : 19% (pas de scolarité), 12,2% (primaire), 11,8% (secondaire), 7,6% (étude supérieure).
Le trouble anxieux le plus fréquemment repéré est l’anxiété généralisée survenue durant les six derniers mois (13% de la population de plus de 18 ans) suivi des troubles paniques et phobie sociale (4%). Agoraphobie et stress post-traumatiques sont rares. Ces troubles anxieux touchent plus les femmes que les hommes et ils diminuent avec l’âge (6% des 18-29 ans contre 1,5% des personnes de 75 ans et plus). Comme pour les troubles dépressifs, les personnes séparées ou divorcées sont plus fréquemment sujettes à des troubles anxieux généralisés (18,6%) que les personnes célibataires (13,4%), mariées (12%) ou veuves (11,2%). La corrélation avec le fait d’être au chômage et le niveau d’étude est forte bien que moins élevée que pour les troubles dépressifs.
Les syndromes d’allure psychotique touchent 2,8% de la population de plus de 18 ans et plus. Contrairement aux troubles dépressifs ou anxieux, les hommes auraient plus souvent ce type de syndrome que les femmes. Là encore, ces symptômes sont fortement corrélés à l’état marital (une personne divorcée a 2,6 fois plus de risque qu’une personne mariée de présenter ce type de syndrome et un célibataire 2,5 fois plus de risque) et l’activité (une personne au chômage au moment de l’enquête a deux fois plus de risque qu’une personne en emploi).
Le risque suicidaire est considéré comme élevé si, au cours du mois écoulé, la personne a pensé à se suicider (à condition d’avoir déjà fait une tentative dans sa vie) ou fait une tentative de suicide. Ce risque élevé touche 1,9% de la population, dont 2% des femmes et 1,7% des hommes. Par contre, à tout âge, le taux de mortalité par suicide des hommes est plus élevé que celui des femmes. Contrairement au suicide, dont le taux augmente, le risque suicidaire élevé diminue avec l’âge de 2,8% (18-29 ans) à 1% (60-74 ans). Le risque est plus élevé pour les personnes divorcées ou séparées (4,7%) et célibataires (3%) que pour les personnes mariées. Il est également plus élevé pour les personnes au chômage (4,7%) ou sans emploi (étudiant, femme au foyer,…, 3%) que pour les personnes en emploi (1,5%) ou retraitées (1%). Le risque suicidaire élevé est fortement lié aux troubles dépressifs. A âge, sexe, situation vis-à-vis de l’emploi, niveau d’études et situation matrimoniale égaux, une personne ayant eu un épisode dépressif dans les deux dernières semaines connaît un risque suicidaire élevé 11,6 fois plus important qu’une personne ne l’ayant pas connu.
Cette étude ne donne aucune indication sur le lieu de résidence des personnes affectées (ville ou campagne, importance de la ville). Elle ne permet donc pas de recouper les indications d’Aimé Michel. Mais, de toute façon, peut-on encore parler de campagne aujourd’hui ?
- L’étude ci-dessus confirme que les syndromes d’allure psychotique (isolés et récurrents, actuels et passés) touchent 3,1% des hommes contre 2,5% des femmes. Les troubles graves, à la différence des troubles plus légers, affectent donc davantage les hommes que les femmes.
- Avant dernière en réalité : il s’agit de la chronique n° 130, Une chimère qui se porte bien, F.C.-E. du 9 février 1973, que nous publierons ici ultérieurement. Aimé Michel y note que « le terrain d’apparition de la névrose est essentiellement héréditaire et les chiffres montrent que les chances de passer à côté de la névrose quand le terrain existe sont assez minces. »
- Sur cette action du corps sur l’esprit, voir par exemple la chronique n° 14, Matière et mémoire 1971 parue ici le 3 septembre 2009, ou la n° 69, Pascal en cartes perforées (à paraître ultérieurement).
- Jacques Ellul (1912-1994), sociologue et théologien protestant, est l’auteur de nombreux ouvrages davantage connus aux Etats-Unis qu’en France. Aimé Michel, qui les découvrit dans une bibliothèque universitaire américaine, se déclara par la suite « admirateur fidèle et fervent propagateur de Jacques Ellul ». Nous reparlerons de cet auteur une autre fois.
- Gilbert Keith Chesterton développe cette idée à contre courant dans son Ce qui cloche dans le monde (1910 ; trad. par M.-O. Fortier-Masek sous le titre Le monde comme il ne va pas, L’Age d’Homme, Lausanne, 1994). Dans cet ouvrage, qui date d’un siècle tout juste et dont certains thèmes, l’humour, les paradoxes et la forme même ne sont pas sans rappeler Aimé Michel, le célèbre journaliste et écrivain anglais (1874-1936) attaque d’un même élan le féminisme (« L’erreur sur la femme ») et, ce qu’on jugera sans doute plus convenable aujourd’hui, l’impérialisme (« L’erreur sur l’homme »).