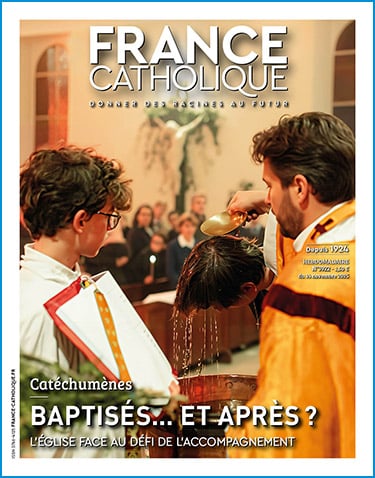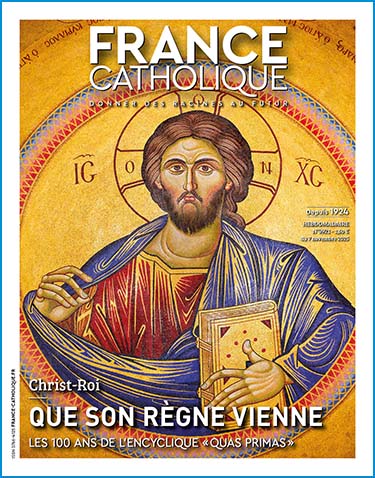Petite incursion chez Jean d’Ormesson, grâce à ses confidences confiées en 2008 à un essai intitulé Qu’ai-je donc fait ? (Robert Laffont). J’ai bien regretté d’avoir manqué, il y a quelques années, avec l’académicien, le rendez-vous de Combourg, où notre jury avait eu l’honneur de lui remettre son prix. Ne lui revenait-il pas de droit, à cet admirateur de Chateaubriand, dont l’attachement au vicomte est de l’ordre de la passion ? Sans jamais vouloir s’égaler à celui qu’il considère comme le plus grand, Jean d’Ormesson l’a, depuis toujours, choisi pour modèle. Avec René Girard, dans le modèle, il faut aussi considérer l’obstacle, car l’admiration est toujours en passe de tourner à la rivalité amoureuse. Il peut y avoir des limites au conflit, lorsque l’on aime et admire trop, pour pouvoir détester, d’autant que le modèle se situe désormais dans l’empyrée des génies et des hommes d’exception.
Pourtant, il en fait bel et bien l’aveu : « Autant le dire tout de suite : il y a quelque chose en moi de tendu, de pressé, d’un peu rageur. Une ambition rentrée et cachée avec soin. Une manie honteuse d’elle-même et vaguement chafouine d’être le premier parmi les premiers. » Et encore : « Ce que j’aurais aimé devenir dans ma jeunesse égarée, c’est Virgile ou L’Arioste, peut-être Conan Doyle, ou n’importe lequel de cette bande-là. » Faute de pouvoir se hisser à de tels sommets, « j’étais bien contraint de réviser à la baisse mes délires et mes ambitions. » Plus que la sagesse, explique-t-il, c’est la paresse qui l’a conduit à la modestie. « Devenir pompier, banquier, ambassadeur de France, représentant de commerce m’apparaissait comme un suicide. Tout m’amusait. Rien ne me retenait. Tout me plaisait. Rien ne m’attirait. Je ne voulais rien de définitif. Je voulais laisser l’avenir ouvert et ne jamais rien fermer. J’étais insouciant et très gai. J’étais un bon garçon. »
Toujours est-il que ce paresseux a quand même beaucoup travaillé et s’est voué à la littérature, où il s’attribue une place modeste. Académicien, il siège Quai Conti depuis 1973, donc depuis près de quarante ans. Je l’ai toujours considéré comme le pur représentant d’un certain esprit français, et sûrement de l’esprit de nos lettres. Il aime nos écrivains et parmi eux les meilleurs. Il cultive un style classique, pimenté par un humour qui ne le rend jamais ennuyeux. Cela explique mon désaccord sur ce point précis avec l’ami Sébastien Lapaque avec qui je suis si souvent d’accord. Dans une superbe chronique sur le bon usage de sa bibliothèque, il glisse perfidement au passage : « cela se bouscule aux lettres M, N, O et P dans ma bibliothèque. Non que j’affectionne particulièrement Catherine Mansfield, Frédéric Mistral, Jean d’Ormesson ou Jacques Pradon : aucun titre, de ces gens-là. » Ca tombe plutôt sèchement et ça fait d’autant plus mal que les voisins de l’alphabet sont exaltés… On me dit que Jean d’Ormesson l’a assez mal pris. Moi, je me consolerais aisément avec Mistral. Quitte à être dédaigné, l’être avec le poète provençal, ce n’est pas si déshonorant… (Sébastien Lapaque, Au hasard et souvent, Actes Sud).
Toujours dans Qu’ai-je donc fait ?, parmi les souvenirs agréablement rapportés, on trouve ce qu’on pourrait appeler « Les liturgies de Saint-Fargeau ». Dans le cadre rêvé de Au plaisir de Dieu, on goûte avec quelque nostalgie l’évocation de la religion de cette famille aristocratique, bercée par la ferveur de ses hymnes et de ses cantiques. Je ne puis, cependant, me retenir de méditer sur une remarque bien significative : « Dieu était une forteresse. Eine Fest Burg disait Bach dont nous écoutions les cantates. Il ne pouvait rien nous arriver. Tout était dans sa main. La Providence veillait. Elle faisait le travail à notre place. Nous ne théorisions pas. L’histoire de l’Église nous était inconnue. La théologie, la métaphysique, la transcendance, nous ne savions même pas ce que c’était. Sauf ma grand-mère qui était confite en dévotion, la foi ne nous étouffait pas. Mais le doute nous était étranger. Les choses étaient ce qu’elles sont, ce que Dieu le voulait ainsi. C’était une consolation formidable, une sorte de cure de sommeil permanente et à jamais réparatrice, une assurance sur la vie et sur l’éternité. »
Il faudrait citer toute la suite qui prolonge cette description-analyse d’une foi traditionnelle, qui reflète les pratiques et les habitus de ce qu’on appelle une civilisation de chrétienté. Le rite, les sentiments, vécus en commun possèdent cette force très particulière d’un univers mental partagé, que l’individualisme et le scepticisme n’ont pas encore fait éclater. Dans un tel régime l’adhésion est première et spontanée. Tandis qu’après lui et hors de lui, l’adhésion est seconde et reconstruite. Elle requiert, sauf conversion fulgurante, réflexion toujours éveillée, contrôle et vérification. Si je me remémore ma propre enfance, elle ne ressemble que partiellement à celle de Jean d’Ormesson. J’ai connu la même ferveur collective, mais sur fond de dénégation. Je ressentais que la foi et la pratique religieuse n’étaient pas unanimement partagées et cela me posait beaucoup de problèmes. Peut-être est-ce là qu’il faut déceler l’origine de mon appétit de mieux comprendre, ne serait-ce que pour pouvoir rendre compte. Je suis frappé aussi par l’exemple de mon père, issu d’un catholicisme fortement enraciné – celui des Flandres – et pourtant si désireux d’approfondir et de parfaire sa formation religieuse. Quelle ne fut pas mon émotion de retrouver après sa mort un petit bureau où il avait rassemblé les livres qui avaient assuré ma propre éducation théologique. Et cela concernait toutes les disciplines, de l’exégèse biblique à la dogmatique en passant par la morale. Je n’ai pas été tellement surpris sur le fond, mais tout de même émerveillé qu’il ait, tout seul, entrepris des études solitairement. Cela devait compenser aussi la déception qui était souvent la sienne, lors d’émissions de télévision où il avait l’impression que les représentants patentés de l’institution ecclésiale n’avaient pas répondu à ses exigences intellectuelles, et à celles de l’attestation de la foi.
Faut-il faire des reproches à « feu la chrétienté » sur ses carences et ses défauts constitutifs ? Ce serait injuste, si on ne rappelait d’abord ses mérites. Sommes-nous tellement autorisés à faire les fiers, avec ce que nous avons substitué à l’héritage qui se défaisait ? Toujours est-il que la trajectoire du jeune aristocrate correspond à la disparition de l’univers d’Au plaisir de Dieu et à l’entrée dans une modernité qui imposait une tout autre rationalité. L’intéressé la résume d’une formule très caractéristique : « Nous nous sommes débarrassés d’une Providence qui avait régné sur l’univers pendant treize milliards d’années et nous avons pris en main notre propre destin. C’est une charge un peu lourde. Elle nous remplit d’orgueil. Et elle nous épouvante. » Je ne suis pas du tout sûr que cette formule corresponde vraiment à la révélation du Dieu de la Bible, qui n’est pas à proprement parler providentialiste, même si sa présence est attestée au long de l’histoire. L’expérience de l’absence, lorsque le chaos et la catastrophe surviennent, peuvent renvoyer au Dieu caché, qui est le véritable. Car s’il a créé la terre et le ciel, il est surtout celui qui se révèle au plus intime du cœur, ne serait-ce que dans l’expérience du buisson ardent. Ce n’est pas l’Olympe, et Prométhée ne peut pas grand-chose à l’encontre du « Dieu sensible au cœur ».
Il y aurait aussi beaucoup à dire sur la métaphysique de ce littéraire qui n’a jamais renoncé à la philosophie, celle qui remplit plusieurs de ses livres, et – si j’ai bien enregistré le message – constitue la substance du prochain à paraître 1. Cette métaphysique, d’une façon très classique depuis les Grecs, s’enracine dans la physique, les énigmes de l’espace et du temps, celles de la cosmologie et de l’origine de l’univers. Ce qui n’empêche pas l’écrivain de tenir ferme à la différence ontologique propre à l’homme. Mais à l’aune cosmologique, cette différence peut effrayer, tel Pascal devant les espaces infinis : « Je me voyais immense et si proche du néant qu’il m’arrivait de me demander s’il n’aurait pas mieux valu en finir une fois pour toutes au lieu de me traîner avec gaieté, sur un chemin pavé de tant de hasards et de crimes vers ma mort annoncée. Je me voyais nécessaire et tout à fait inutile, capable de tout et perdu. » Pascal échappait à ce vertige en entrant dans le mystère chrétien et en répondant à l’appel du Christ en son cœur.
Jean d’Ormesson semble s’éloigner de cette voie, en ne retenant de l’Évangile que la parole du psaume prononcée par Jésus en croix : « Seigneur, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
Sa perception de la personne du Christ témoigne alors d’une sorte d’arianisme, très courant aujourd’hui, contredisant tout ce que les évangiles rapportent de l’intimité incessante du Fils avec le Père. L’arianisme coexiste alors avec un agnosticisme, par ailleurs loyal, parce qu’il ne se thématise pas en certitudes rationnelles : « Je n’assène pas des certitudes. Je ne défends aucune doctrine. Je ne propose aucune recette. Je m’interroge sur l’évidence. »
Faut-il incriminer un certain scientisme dans cette démarche où tout se raccroche à la seule science ? Non, car l’auteur prend la précaution de marquer la distance de cette science avec la vérité. Mais que répond-il à Heidegger, qui prétend, lui, que « la science ne pense pas » ? Ne subsiste-t-il pas un saut entre les protocoles de la science et l’interrogation métaphysique, a fortiori cosmologique ? Au terme, Jean d’Ormesson avoue ne pas croire en l’inexistence de Dieu. Et son scepticisme radical débouche sur un paradoxe intéressant : « Je doute en Dieu. » Intéressant, mais non décisif. Car il faudrait considérer aussi avec Pascal la révélation de la Bible. Pourquoi se désintéresser de cette révélation ? Et s’exposer à manquer l’essentiel du Dieu vivant et vrai ?