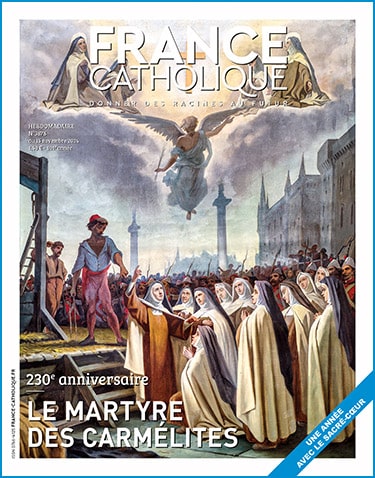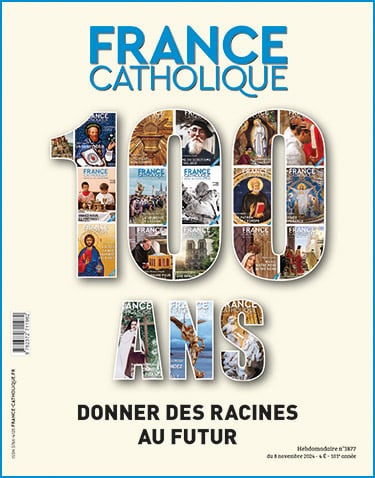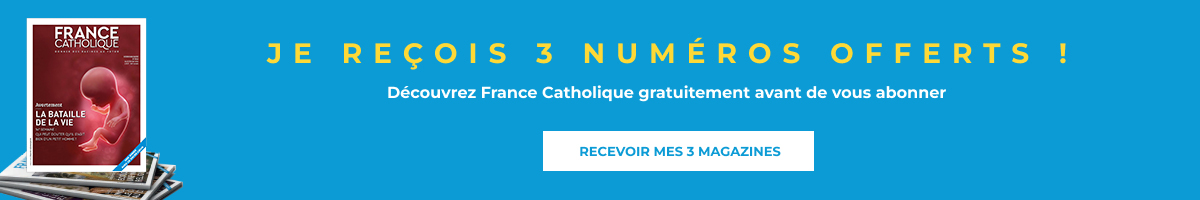L’économiste Friedrich Hayek (1889-1992), que tout le monde considère comme conservateur, s’était astreint à prouver le contraire : Pourquoi je ne suis pas conservateur ? (1960, traduit en français en 1994). Il reprochait même aux conservateurs de « ne rien proposer ». Esprit pratique et constructif, il refusait en effet l’étiquette au sens que de récents auteurs donnent encore à ce mot : le simple fait de persévérer dans l’être, de suspendre le temps, d’habiter un petit coin de terre, de « durer », de temporiser (qui a dit qu’il fallait « donner du temps au temps » ?), de paraître « retarder », d’être toujours décalé par rapport à l’actualité immédiate, de dédaigner le changement et la nouveauté, d’égaler les vivants et les morts et même de prétendre faire revivre les morts. Le dernier maître à penser encore vivant de ce conservatisme à l’ancienne, Roger Scruton (né en 1944) a trouvé sa devise : « Delay is life ». On peut traduire comme le fait sa traductrice, Laetitia Strauch-Bonart : « Retarder c’est vivre ». Mais cela veut dire aussi que « la vie est suspendue au temps », comme l’écrivait le marquis de Salisbury, homme politique britannique important – trois fois Premier ministre entre 1881 et 1902 – peut-être le moins connu des historiens de cette époque, mais pas le moins intéressant pour autant.
Par définition, le conservatisme n’a pas de programme ni d’idéologie. Il rejette toute construction ou théorie abstraite, bref tout intellectualisme. On était conservateur de père en fils. Bientôt néanmoins vint le temps où les choses n’allèrent plus d’elles-mêmes. Lorsqu’il devint nécessaire de définir ce qu’était le conservatisme, c’était qu’il n’était plus naturel. Le premier essai de définition demeure à ce jour inégalé, quoique datant de 1953 : The Conservative Mind de l’Américain Russell Kirk. L’essai de Jean-Philippe Vincent (Qu’est-ce que le conservatisme ?) en est une sorte d’actualisation. Sous le patronage du philosophe de la London School of Economics (le Sciences Po londonien) Michael Oakeshott (1901-1990), il en reste au titre de Kirk – pour le sceptique Oakeshott le conservatisme est un « état d’esprit » –, à ses catégories – légèrement remodelées et passées de six à sept –, et surtout à son inspiration catholique – élargie au judaïsme.
Par pragmatisme, il n’y a pas de politique conservatrice – sauf à usage polémique. On rappelle le mot de Disraeli, le plus brillant chef du Parti conservateur : « Conserver quoi ? » ; « Qu’est-ce qui vaut d’être conservé ? » Ce qui voulait dire que le principe du conservatisme n’était pas pratiquement de conserver mais, encore une fois, d’habiter son temps et si l’on n’est pas heurté par le mot, de réformer, voire de changer, « tout changer pour tout conserver » comme dit le seigneur de Lampedusa dans le fameux Guépard. Faut-il faire une politique sociale ou ultra-libérale ? la paix ou la guerre ? la Nation ou l’Europe ? La réponse dépendra des circonstances. Le conservateur anglais prend le parti de l’opportunisme et non pas, comme souvent son homologue français qui ne s’y résout qu’en dernier ressort, contraint et forcé, s’il ne peut vraiment pas faire autrement, constamment sur la défensive, ce qui fait toute la différence.
Ni intellectuel, ni politique, ni économique, qu’est-ce que le conservatisme ? Marcel Gauchet, dans l’enquête de Lætitia Strauch-Bonart, avance une hypothèse : l’Église, ou ce qui en tient lieu quand elle a disparu. George Orwell, fameux auteur de 1984 et de La ferme des animaux, définissait déjà l’Église anglicane comme « le parti Tory en prières ». Or le nombre de Britanniques se déclarant sans religion vient de dépasser les 50 % et la majorité des églises de paroisse sont désaffectées, démolies ou réaffectées à des usages non religieux. Quoi qu’il en soit, l’Église y demeure une institution établie et respectée comme telle. En France, la situation est différente à bien des égards : l’Église est largement regardée à travers le prisme des communautés catholiques qui s’affirment comme le réceptacle de formes d’action sociale dans la société civile, transmettrices de valeurs et fournisseuses de services. Jean-Philippe Vincent dans sa généalogie du conservatisme a bien montré, sur chaque thématique, l’apport des penseurs chrétiens voire avant eux de l’Antiquité romaine (Cicéron).
Finalement, pour Roger Scruton, ce ne sont donc pas des monarchistes cléricaux qui sauveront le conservatisme mais des républicains agnostiques, non des aristocrates férus de chasse à courre mais des amateurs de jeux de rôle sur écran tactile. Il ne s’aventure si avant sur la prise en compte des racines chrétiennes du conservatisme que parce qu’il est convaincu que l’arbre est réduit à ces racines, qu’il n’y a plus d’arbre où s’abriter. Le dernier chapitre de son De l’urgence d’être conservateur, est joliment intitulé : « Un adieu qui interdit le deuil, mais admet la perte ». L’agonie du christianisme européen ne date pas d’hier puisque Scruton se fonde sur le célèbre poème de Matthew Arnold Sur la plage de Douvres qui date de 1867. Il l’oppose à Nietzsche en ce que « la mort de Dieu » ou plutôt ici la perte de la foi s’inscrit dans le cadre de l’Église anglicane au lieu que le protestantisme allemand ne laisse subsister aucune institution. La congrégation ne vit que de ses membres tandis que l’Église est de fondation divine. La perte chez Nietzsche est totale et absolue. Ayant perdu la foi, cette foi-là, il a tout perdu. L’anglican qui a perdu la foi continue à demeurer membre de l’Église. C’est absurde ? Donc c’est bien conservateur ! Le poète anglo-américain T.S. Eliot, que Russell Kirk plaçait au terme de sa recension des conservateurs, n’a jamais rien dit d’autre. Scruton conclut : nous nous tenons au-dessus du vide que nous recouvrons. Être conservateur, c’est être capable de se confronter au vide, avec ou sans la foi.
—
Retrouver notre dossier sur le retour du conservatisme dans le numéro 3524 du 27 janvier 2017 de France Catholique.