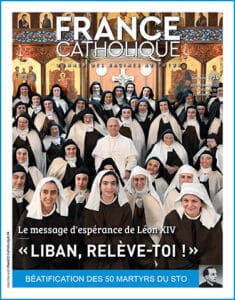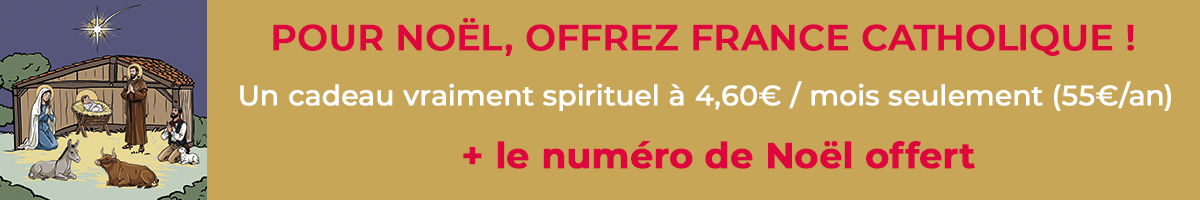La deuxième Section de la Cour européenne des droits d’homme (CEDH) a rendu public aujourd’hui son premier arrêt relatif à l’accès au diagnostic préimplantatoire (D.P.I.), c’est-à-dire à la technique de dépistage et de sélection d’embryons fécondés in vitro en vue de la procréation d’un enfant non atteint les caractères génétiques considérés. Il résulte de cet arrêt que l’accès au DPI peut être de fait considéré en Europe comme un droit, un droit garantit de façon indirecte par la Convention européenne des droits de l’homme. Cet arrêt n’est pas définitif et est susceptible de renvoi devant la Grande Chambre pour réexamen.
Une autre affaire, relative à l’accès au diagnostic prénatal et à l’avortement, est actuellement pendante (affaire K. c Lettonie n° 33011/08 concernant le non dépistage d’un enfant atteint de trisomie 21). L‘ECLJ intervient devant la Cour dans ces deux affaires, en tant qu’amicus curiae, et a été autorisé à soumettre des observations écrites. Précédemment, la Cour ne s’était prononcée que sur l’accès aux techniques de procréation artificielle (fécondation in vitro), notamment par un important arrêt de Grande Chambre (S. H. contre Autriche, voir commentaire de l’ECLJ).
Cette affaire Rosetta Costa et Walter Pavan contre Italie (n° 54270/10 introduite le 20 septembre 2010) concerne un couple d’italiens porteurs sains de la mucoviscidose. Ils ont précédemment avorté afin d’éviter la naissance d’un enfant malade. Désirant avoir un enfant non atteint de la mucoviscidose, le couple soutenait devant la Cour que l’interdiction du diagnostic préimplantatoire (D.P.I.) par la loi n° 40/2004 porte atteinte à leur vie privée et familiale. Le D.P.I. leur permettrait de sélectionner un embryon sain avant l’implantation, plutôt que de procéder à une sélection, a posteriori, par avortement. Cette loi n° 40/2004, qui règlemente la procréation assistée (P.M.A.), a été adoptée en Italie à la suite d’un long et difficile débat national. Après son vote au Parlement, ses opposants ont essayé à plusieurs reprises d’obtenir son abrogation par référendum. Ces referendums s’étant soldés par un échec, ils se sont finalement tournés vers la Cour européenne pour obtenir sa censure, sans même saisir les juridictions nationales.
La deuxième Section a accepté de porter un jugement sur le droit interne italien et a donné raison aux requérants en estimant, en substance, que le législateur n’a pas été cohérent en interdisant le diagnostic préimplantatoire alors qu’il tolère par ailleurs l’avortement thérapeutique. En application de cet arrêt, l’Italie devrait légaliser le diagnostic préimplantatoire, à moins que l’affaire ne soit renvoyée devant la Grande Chambre.
Cet arrêt est critiquable sous plusieurs aspects, notamment :
Tout d’abord, la Section a jugé la requête recevable alors même que les requérants n’ont fait aucune démarche en Italie et n’ont saisi aucune juridiction interne, ce qui apparente leur recours à une actio popularis. Un tel recours interne n’était pourtant pas condamné d’avance, en attestent plusieurs décisions de justice récentes ayant ordonné l’accès au diagnostic préimplantatoire à d’autres couples, ce que semble ignorer la Cour. Un tel recours interne aurait pu en outre mener à une décision de la Cour Constitutionnelle sur la loi 40. Ce faisant, le caractère subsidiaire de la Cour européenne aurait été respecté. La Section, pourtant très stricte habituellement quant aux conditions de recevabilité, n’a pas jugé nécessaire d’attendre que les juridictions nationales aient eu l’occasion de se prononcer pour imposer son propre arbitrage.
En statuant sur une situation générale en absence de procédure particulière devant les juridictions internes, la Cour s’est prononcée directement sur le choix du législateur national ; qui plus est dans un domaine dans lequel il devrait jouir d’une ample marge d’appréciation selon la jurisprudence antérieure de la Cour (S. H. c. Autrcihe). Comparée à d’autres affaires déclarées irrecevables, notamment l’affaire suisse relative à l’interdiction constitutionnelle des minarets, les critères de la Cour deviennent imprévisibles, à moins que l’on ne s’oriente vers une pratique de « pick and chose » à l’américaine par laquelle la Cour choisit de traiter seulement les affaires qui l’intéresse. Quoi qu’il en soit, en déclarant cette requête recevable, la Cour ouvre la possibilité de contester directement une loi devant elle, sans même avoir prouvé sa qualité de victime ni avoir saisi la moindre juridiction.
Pour faire entrer cette affaire dans le champ d’application de la Convention, la Cour énonce que « le désir » d’avoir un enfant non malade « constitue une forme d’expression de leur vie privée et familiale » et « relève de la protection de l’article 8 » (§ 57). Par suite, l’impossibilité légale de réaliser ce désir au moyen des techniques de P.M.A. et de D.P.I. donnerait aux requérant la qualité de « victimes » et constituerait une ingérence de l’Etat dans le droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale (§58), lequel droit contiendrait le « droit [des parents] de mettre au monde un enfant qui ne soit pas affecté par la maladie dont ils sont porteurs sains » (§ 65), c’est-à-dire leur droit de mettre au monde un enfant sain.
Même si la Section s’en défend (§ 53), il faut constater l’énonciation d’un droit nouveau : un droit à ne pas transmettre ses mauvais gènes, un droit à l’eugénisme. On ne saurait prétendre que ce droit porte seulement sur l’accès aux moyens de sélection, dès lors qu’il a une finalité supérieure : la procréation d’un enfant non affecté. Il s’agit bien d’un droit à l’enfant sain, lequel droit implique de pouvoir accéder aux moyens de sélection. Ce droit correspond à une obligation de moyen. Ainsi, il n’est effectivement pas invocable contre toute maladie dont serait affecté un enfant, mais le serait à l’encontre du personnel médical dont un manquement fautif aurait eu pour résultat de laisser naître un enfant malade, par exemple trisomique C’est le cas de l’affaire K . contre Lettonie.
Ayant énoncé un « droit de mettre au monde un enfant qui ne soit pas affecté par la maladie » (§ 65), il s’agit pour la Section de juger si l’interdiction du D.P.I. porte atteinte à ce droit.
Sur le fond, l’arrêt ne soutient pas – et en serait bien incapable- que l’interdiction du D.P.I. est en soi contraire à la Convention. Il écarte d’ailleurs d’emblée cette question telle que posée par les requérants, à savoir si « l’interdiction qui leur est faite d’accéder au D.P.I. est compatible avec l’article 8 de la Convention » (§ 60). L’arrêt reformule la requête en la faisant porter sur la proportionnalité de l’interdiction du DPI à la lumière de l’autorisation de l’avortement thérapeutique (§60). Ainsi, dans cet arrêt, la Section change de référentiel : elle ne juge plus l’affaire par rapport aux exigences de la Convention, mais par rapport à la « cohérence » que devraient avoir entre-elles les dispositions de la législation italienne pour être justifiable devant la Cour européenne. Le contrôle de la Cour européenne va ainsi très loin, il porte sur la cohérence entre différentes dispositions de droit internes qui prises séparément ne sont pas en elles-mêmes contraires à la Convention.
C’est aussi au motif de cette exigence de cohérence que la Cour a condamné des Etats qui avaient imparfaitement légalisés l’avortement (notamment A. B. et C. c. Irlande et R. R. c. Pologne) et à la procréation artificielle (S. H. c. Autriche). Dans ces matières qui fonctionnent sur le mode « interdiction/dérogation », l’exigence de la cohérence de l’ordre juridique interne permet d’agrandir les brèches ouvertes par les dérogations. En effet, sa logique fondamentale est de juger le principe à la lumière de l’exception, et non l’inverse. Finalement, le droit interne doit être mis en cohérence et réordonné à la transgression initiale. Selon le raisonnement de l’arrêt, l’Italie n’aurait pas pu être condamnée si elle interdisait l’avortement dit thérapeutique. Ce n’est que parce que l’Italie autorise cet avortement que l’arrêt a trouvé une base pour imposer, in fine, la légalisation du DPI.
Quoi que l’on puisse penser de la cohérence interne de la législation italienne, dès lors que l’interdiction du D.P.I n’est pas en soi contraire à la Convention, on ne voit pas comment cette « incohérence » autoriserait la Section à se substituer au législateur national et aux juridictions nationales en leur imposant son propre arbitrage éthique, et à énoncer ce qu’il faut bien se résoudre à reconnaître comme un véritable « droit à l’eugénisme ».
Pour ces motifs, l’ECLJ considère qu’il est nécessaire que cette affaire soit renvoyée devant la Grande Chambre, ce qui est probable dès lors qu’un arrêt porte sur une question nouvelle et pose des problèmes juridiques sérieux, ce qui est le cas en l’espèce.
Documents joints :
CEDH, arrêt Rosetta COSTA et Walter PAVAN contre l’Italie, (n° 54270/10),
Observations écrites de l’ECLJ,
Observations complémentaires du Movimento per la Vita
Observations du gouvernement italien.
S. H. et autres contre Autriche, No 57813/00, Observations écrites de l’ECLJ
Affaire K. contre Lettonie, no. 33011/08, Observations écrites de l’ECLJ
Pour aller plus loin :
- Affaire Ulrich KOCH contre Allemagne : la Cour franchit une nouvelle étape dans la création d’un droit individuel au suicide assisté.
- Affaire S H contre Autriche: une victoire majeure pour la famille et la souveraineté des Etats devant la Cour européenne des droits de l’homme.
- La « Legge 40 » sur l’assistance médicale à la procréation soumise à la Cour de Strasbourg.
- Le diagnostic préimplantatoire fait débat
- L’adoption homosexuelle devant la Grande Chambre de la Cour européenne