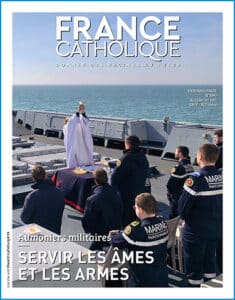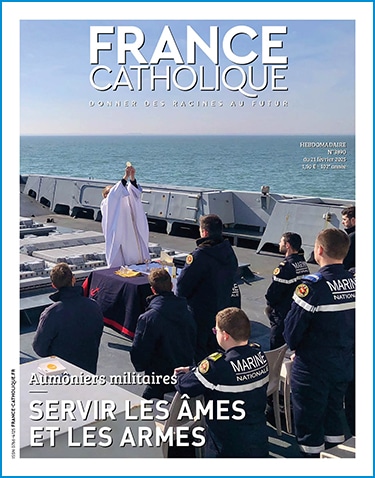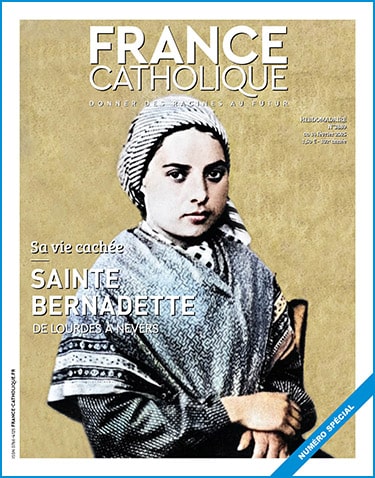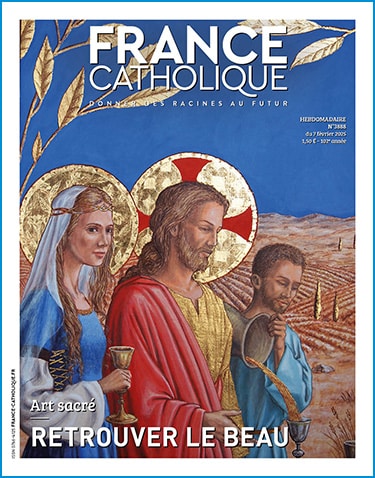«Le gouvernement de la République reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français. » C’était en 1802. À l’époque incarnée par Bonaparte, Premier consul, la République proclamait officiellement la primauté du catholicisme en France, mettant fin par le Concordat à dix années d’une lutte sans merci contre l’Église.
Par la Constitution civile du clergé adoptée dès 1790, la Révolution avait tenté de réduire les prêtres au rang de fonctionnaires ; elle avait exterminé ceux qui n’avaient pas prêté serment à la Nation ; elle avait privé le successeur de Pierre de son autorité sur le clergé français : les curés et les évêques seraient désormais élus par les citoyens, catholiques ou non.
Pie VI condamna ces dispositions comme hérétiques. Déposé par les troupes du Directoire en 1798, retenu prisonnier en France, il mourut l’année d’après à Valence, épuisé par ce conflit. Son corps ne sera rendu à Rome qu’en 1802. Par Bonaparte. « Une des grandes qualités du Premier consul fut d’avoir compris très vite la nécessité de la pacification religieuse », souligne le P. Michel Viot dans Les papes et la France (Via Romana). La cohabitation de deux clergés, l’un schismatique, l’autre fidèle à Rome, était un foyer de troubles que l’État devait éteindre.
La sève de la civilisation française
« Le pape [Pie VII] aurait souhaité voir le catholicisme déclaré religion d’État, ce qui était un juste souhait de sa part, mais parfaitement impossible après ce qu’il s’était passé à la Révolution », poursuit le Père Viot. En inscrivant dans le Concordat que les Français étaient majoritairement catholiques, « Bonaparte trouva la formule qui convenait ». En politique habile et réaliste, il reconnaissait que le catholicisme a toujours imbibé la civilisation française. Qu’il en est la sève. Un État soucieux de préserver la paix civile et la santé morale de ses citoyens ne peut pas l’ignorer, sous peine d’un délitement de la nation. Napoléon l’avait compris. Le Concordat assurait l’Église et ses fidèles de la « protection particulière » de la République.
L’Empereur commit ensuite bien des fautes contre Pie VII. Il fut aussi tenté d’enrégimenter les évêques. Mais le Concordat régla les rapports entre l’Église et l’État pendant un siècle sans que les fidèles aient à s’en plaindre. Le catholicisme connut même en France une vitalité peu commune au cours du XIXe siècle. C’est précisément ce que ne pouvaient pas supporter les Républicains, dont le pouvoir s’affermit progressivement après la chute du Second Empire. En 1877, Gambetta, alors député, proclame : « Le cléricalisme, voilà l’ennemi. » Et Jules Ferry, qui fut ministre de l’Instruction publique, veut « organiser l’humanité sans roi et sans Dieu ».
À partir des années 1880, ce n’est qu’une suite de mauvais coups contre l’Église. En 1875, les constituants avaient décidé : « Le dimanche qui suivra la rentrée [parlementaire], des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées. » Cet article est abrogé en 1884. Bien que le pape Léon XIII ait demandé aux catholiques, en 1892, « d’accepter la Constitution pour changer la législation », la gauche républicaine ne modifie rien à ses plans. D’abord séparer l’école de l’Église – les congrégations sont interdites d’enseigner avant d’être expulsées en 1903 – puis en séparer l’État : c’est la loi de 1905. « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » Le Concordat est abrogé sans que le Saint-Siège ait jamais été consulté.
Pie X réagit par l’encyclique Vehementer nos : la séparation de l’Église et de l’État est « une très pernicieuse erreur [car] le créateur de l’homme est aussi le fondateur des sociétés humaines. Nous lui devons donc, non seulement un culte privé, mais un culte public et social, pour l’honorer ». En réduisant la foi à l’intime, en confinant la religion dans la sphère privée, on veut « lui interdire toute influence sur la vie de la cité », résume le Père Viot : les catholiques sont ostracisés au nom d’une conception dévoyée de la laïcité.
Depuis, le temps a fait son œuvre, les relations entre l’Église et la République se sont pacifiées. On se souvient encore du clocher qui figurait sur l’affiche de campagne de François Mitterrand, en 1981. On se rappelle aussi le discours de Nicolas Sarkozy au Latran, en décembre 2007 : « Les racines de la France sont essentiellement chrétiennes. J’assume pleinement le passé de la France et ce lien particulier qui a si longtemps uni notre nation à l’Église. »
Primauté du catholicisme
Il est vrai que l’adoption du mariage homosexuel, en 2013, avait abîmé le lien entre Paris et le Vatican. Et que le poste d’ambassadeur de France près le Saint-Siège était resté vacant plus d’un an, de mars 2015 à mai 2016, François Hollande s’obstinant à vouloir y nommer un diplomate récusé par le Vatican. Emmanuel Macron s’est employé à renouer le dialogue avec l’Église : « La laïcité n’a certainement pas pour fonction de nier le spirituel au nom du temporel, ni de déraciner de nos sociétés la part sacrée qui nourrit tant de nos concitoyens », a-t-il dit en 2018, au Collège des Bernardins, en appelant les catholiques à faire entendre leur voix dans les débats politiques. On sait aussi qu’il a tenu à aller accueillir le Saint-Père à Marseille, le 22 septembre.
Faut-il voir dans ces marques de déférence plus qu’une habileté visant à séduire « l’électorat catholique » ? Au regard de l’histoire de France, de son identité et de sa vocation, les catholiques sont-ils plus qu’une simple « communauté » dans le pays qu’ils ont forgé ? Le catholicisme n’y est-il qu’une religion parmi d’autres ? Le Concordat avait inscrit sa primauté dans le droit. Une pratique agressive de la laïcité – « exagérée », dit le pape François – a voulu le marginaliser. Les temps ont changé mais il ne suffit plus de se dire, comme Emmanuel Macron, « convaincu que la sève catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation ». Qu’adviendra-t-il, par exemple, de la loi sur la fin de vie ? Vient un temps où l’on doit mettre ses actes en conformité avec ses mots.
—

Les papes et la France, P. Michel Viot, Via Romana, 350 pages, 25 €.