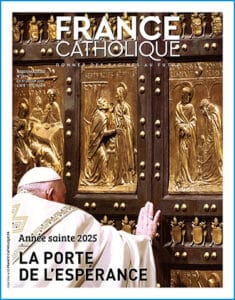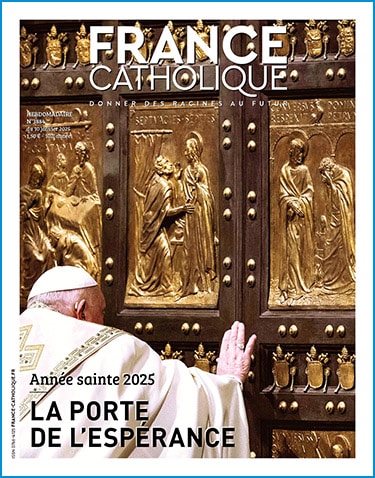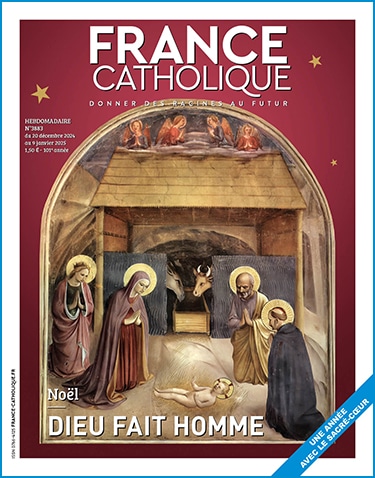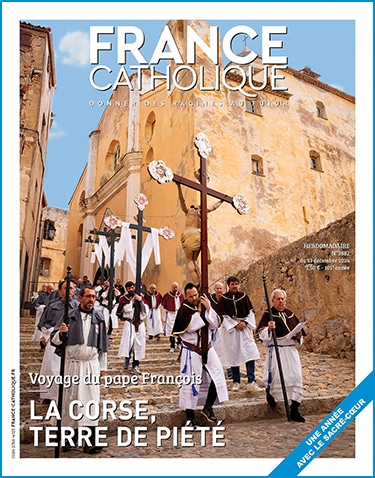Il est curieux de voir comme la plupart des gens supposent que la foi chrétienne et la pensée humaine sont en somme des étrangères. Sans doute, admettront-ils, on peut les réconcilier, et même tout simplement les concilier. Mais il ne viendrait à l’idée de personne, croirait-on parfois, qu’elles puissent couler ensemble de la même source. Il en serait pour elle comme pour l’eau froide et l’eau chaude, le doux et l’amer : vous pouvez bien en faire des mélanges savants, menacés d’ailleurs par un danger perpétuel d’insipidité, mais il ne vous viendrait pas à l’idée qu’on pût les puiser au même robinet.
Le préjugé est si couramment admis qu’on ne remarque même plus que c’est un préjugé. On ne se demande plus, d’ordinaire, où et quand il a surgi. On se demande bien moins encore s’il est fondé.
En fait, c’est une école de pensée d’un protestantisme rationaliste qui est arrivé, au XIXe siècle, à inoculer ce postulat peu à peu aux chrétiens eux-mêmes, et jusqu’aux catholiques. Avec cette manie qu’ont les catholiques de recueillir pieusement (sous la rubrique « idées modernes ») les idées toutes faites des autres au moment où ceux-ci les abandonnent, il n’y a pas lieu d’être surpris qu’un préjugé, si bien accordé avec ladite manie, se trouve chez nous aujourd’hui mieux installé que nulle part ailleurs.
L’école rationaliste de Tübingen, à laquelle nous devons un héritage apparemment si précieux, ne l’avait tiré d’aucune savante recherche historique. Au contraire, elle en a imprégné « a priori » les recherches mêmes qui auraient dû le démentir. Car il n’y a rien de plus commode, pour trop d’esprits, que de faire de l’histoire « a priori », de telle sorte qu’on ne trouve, au bout des recherches, que ce qu’on avait dans sa manche avant de les entreprendre. Hegel, à cet égard, n’a pas fini de faire le bonheur des historiens paresseux, comme le prouve la fidélité inébranlable vouée à sa dialectique par les marxistes… Mais il y a tout de même des cas gênants, où la poussée des faits devient si forte que toutes les cloisons de papier finissent par crever devant eux. Il semble bien que c’est ce qui se produit dans le cas qui nous intéresse.
Les historiens hégéliens des origines chrétiennes avaient trouvé un schéma mirobolant pour faire entrer cette histoire dans la filière : thèse, antithèse, synthèse. A un christianisme « primitif », et comme tel nécessairement inculte, et plus particulièrement doué de cette nécessité sentimentale et de cette nullité intellectuelle qui doivent caractériser le « primitif » qui se respecte, se serait heurtée la Pensée (avec un grand P). Autant dire que celle-ci ne pouvait être que grecque (comme le miracle du même nom).
A un christianisme juif, par définition sans trace de pensée, aurait donc succédé un pagano-christianisme, par définition hellénique. Sa forme parfaite serait le gnosticisme. Les Pères de l’Eglise surviendraient par là-dessus pour opérer l’inévitable synthèse : le catholicisme apparaissant donc comme un produit bâtard d’une forme de judaïsme particulièrement inapte à la pensée (c’est ainsi qu’on se représente le « pur » christianisme) et d’une forme de pensée particulièrement inapte à exprimer toute religion tant soit peu biblique. La synthèse en question serait ainsi, en fait, un complexus oppositorum, ou, pour parler moins savamment, un ramassis de données inconciliables…
Il ne faut pas trop s’étonner après cela si la polémique protestante s’est emparée avec allégresse du beau joujou tout neuf qu’on lui offrait. Les protestants de 1958 peuvent être aussi loin de l’école de Tübingen que l’est par exemple un Karl Barth ; néanmoins, dès qu’il s’agit de pourfendre le catholicisme, un Karl Barth lui-même ne croira rien pouvoir brandir contre lui de plus efficace que cette arme rutilante, mais peut-être pas plus solide, en effet, qu’un fusil de bois, même fraîchement repeint.
Ce qui est plus curieux, évidemment, c’est que les catholiques en soient venus à ne plus mettre en question le schéma historique qui, précisément, devrait être mis en question par eux les premiers. Mais nous savons de reste la tentation invincible qu’ont bien des catholiques à confondre l’humilité avec le masochisme !
Cependant, il y a tout de même des historiens qui respectent les documents et les textes plus que la dialectique et, grâce à Dieu, ils n’ont pas manqué, depuis un siècle, même chez les protestants. Le résultats, c’est qu’il apparaît maintenant que l’histoire des origines chrétiennes telles que l’avait conçue l’école de Tübingen repose sur des bases chimériques. Un très vivant ouvrage du Père Jean Daniélou, s.j., vient de la mettre en aveuglante lumière. C’est sa Théologie du judéo-christianisme1.
Le titre seul de ce livre est une offense intolérable à l’histoire dialectique si longtemps acceptée comme parole d’évangile. Ce titre, en effet, manifeste que la pensée n’est pas venue du dehors s’ajouter à la foi chrétienne. Le christianisme primitif, pas plus que le judaïsme où il est né, n’ignorait la pensée, une pensée mûrement réfléchie et formellement élaborée. La théologie n’y est pas un produit tardif, dû à des influences étrangères. Elle y naît d’elle-même, conformément à ses propres exigences, sur la base de ses ressources propres.
Tout ceci ne veut pas dire, bien entendu, que la pensée chrétienne n’ait pas eu à rencontrer, le moment venu, la pensée grecque. Mais le christianisme, pas plus que le judaïsme qui l’avait précédé, n’avait nul besoin de cela pour se mettre à penser…
On voit tout de suite les conséquences capitales de ce fait. On peut dire qu’elles sont doubles. La première est que la pensée, la théologie, n’est pas un développement accidentel, et toujours foncièrement bâtard, de la foi. Elle en est le produit naturel et spontané. Pas de foi qui n’implique, si simples que puissent être ses formulations, des croyances bien définies. Qui plus est, pas de foi qui n’engage d’elle-même dans une pensée cohérente…
Et voici la seconde conséquence : si importantes que puissent être, dans les développements ultérieurs de la pensée chrétienne ses confrontations avec les autres pensées, antérieurement à cela elle existe. Elle a sa consistance propre ; elle a ses objets, humains et divins tout ensemble, et c’est d’eux-mêmes qu’elle se nourrit, à partir d’eux-mêmes qu’elle se développe…
Est-il besoin de souligner plus explicitement combien ces considérations s’opposent à l’attitude de tant de chrétiens modernes, toujours en quête d’une pensée étrangère à leur foi et qui soit la pensée du jour, comme si ce celle-ci d’abord devait dépendre leur pensée ? Bien sûr, il ne s’agit pas de mettre notre lumière sous le boisseau en nous fermant au monde extérieur ! Mais il s’agit, précisément pour comprendre ce monde extérieur, afin de l’éclairer, de mettre sur le chandelier cette lumière que nous avons reçue, mais qui n’est pas nôtre : la lumière de Dieu.
Louis BOUYER