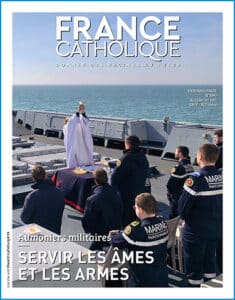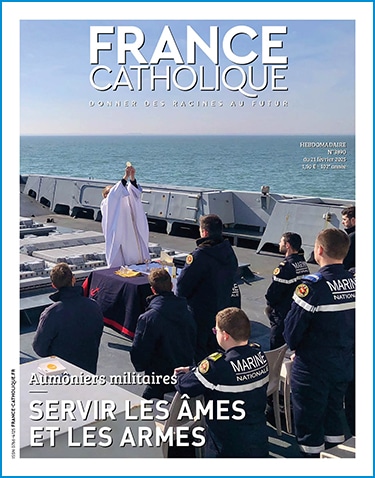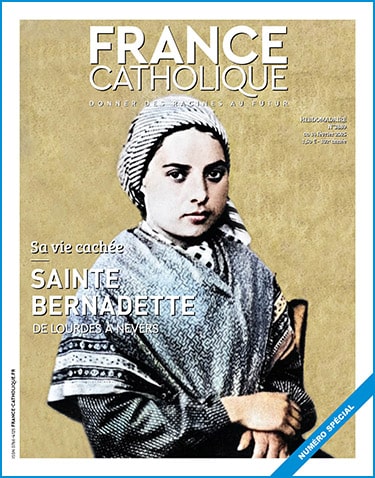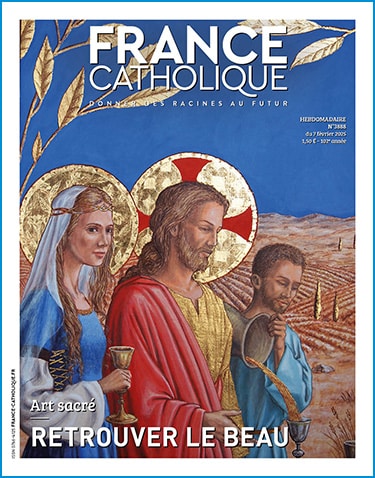En 1936, le sociologue américain Harold D. Lasswell lançait la formule « qui dit quoi à qui ? » et ouvrait la voie à une recherche nouvelle dans une certaine mesure sans le savoir.
Cette question qui dit quoi à qui ? résume, en effet, dans une formule lapidaire, un phénomène sociologique de capitale importance, aussi ancien que la société humaine et que connaissent toutes les sociétés existantes, y compris animales, celui de la communication.
Les absents ont toujours tort
Quand, dans une fourmilière comptant des centaines de milliers d’individus, on introduit une fourmi d’une autre fourmilière, mais appartenant à la même espèce, elle se fait aussitôt expulser ou massacrer. Quand, dans un groupe de rats, on en isole un pendant quelque temps, puis qu’on le rend aux siens, ceux-ci l’exterminent sur-le-champ. Quand, dans une ruche, la reine meurt, aussitôt toutes les abeilles changent leur économie générale ; et si la saison s’y prête, elles se mettent à nourrir une larve avec des hormones spéciales et refabriquent une autre reine. Faut-il admettre que chacune des centaines de milliers de fourmis connaît toutes les autres, que chez les rats les absents ont toujours tort, que les abeilles passent leur temps à se demander des nouvelles de leur reine ? C’est l’idée qui vient irrésistiblement à l’esprit quand de ses yeux on voit (ou croit voir), les choses se dérouler.
Et cependant, quand des centaines d’énormes fourmilières de Formica polyctena occupent ensemble une forêt, les dizaines de millions d’insectes entretiennent des rapports relativement étroits et peuvent impunément pénétrer dans des colonies qui ne sont pas les leurs ; cependant encore, on peut réintroduire le rat voyageur chez les siens sans danger pour lui, moyennant une simple manipulation olfactive ; cependant aussi, il existe des pathologies de la ruche qui la font mourir sans reine.
Tous ces paradoxes ont été expliqués par des faits sans aucun rapport avec ce que semblait montrer l’évidence. C’est ainsi, par exemple, que la communication entre insectes sociaux se fait essentiellement par régurgitation mutuelle de nourriture ; dans le cas de la ruche, une hormone propre à la reine est sans cesse recueillie et redistribuée de proche en proche ; la présence de cette hormone dans la nourriture régurgitée atteste l’appartenance à la même communauté. C’est une sorte de mot de passe.
J’étudie depuis quinze ans au Service de la Recherche de l’ORTF ces phénomènes de communication, m’attachant surtout à discerner ce qu’il y a de commun dans la communication humaine et animale (1). Il est frappant de relever, à travers des instruments physiologiques et des supports techniques totalement différents, la similitude des résultats recherchés et atteints.
Si, par exemple, on considère la diffusion d’une information dans deux collectivités comptant un même nombre d’individus, l’une d’abeilles, l’autre d’hommes (une ruche et une grande ville), on constate que, dans la mesure où l’information concerne la collectivité, les moyens humains de diffusion de masse (nos mass media) sont très largement battus par ceux du monde animal. La « nouvelle » de la mort de la reine n’est plus ignorée par une seule abeille de la ruche quelques dizaines de minutes à peine après l’événement.
Certes, il faut s’abstenir de tout anthropomorphisme ; compte tenu de nos physiologies respectives, la disparition de la reine est un événement beaucoup plus dramatique pour l’abeille que pour nous celle (qu’il me pardonne !) de M. Pompidou. Il serait plus juste, dans une certaine mesure, et sans aller trop loin là non plus, de comparer la mort de la reine à une panne électrique ou à une grève des épiciers. Mais même si l’on compare des événements comparables, comme l’incendie du CEG parisien (2) et le jet d’une allumette dans une fourmilière, l’information de masse circule bien plus vite dans la fourmilière que dans la ville, et elle atteint tout le monde.
Ces exemples non humains de communication de masse sont primitifs et je ne les donne que pour faire sentir la généralité du phénomène et inciter à la réflexion. On peut descendre encore plus bas dans l’élémentaire en retrouvant les mêmes phénomènes. La diffusion d’une réaction pathologique dans un organisme, l’installation d’une immunité lors d’une vaccination, la mobilisation des leucocytes autour d’une plaie, sont aussi des phénomènes primitifs de communication de masse. Je soulignais déjà il y a une dizaine d’années, le remarquable parallélisme par lequel, actuellement, sous nos yeux, l’évolution des télécommunications copie littéralement la paléontologie du système nerveux (3), à cela près toutefois que la copie artificielle réalisée sans le savoir par nos ingénieurs a parcouru en quelques dizaines d’années ce qui n’a pu être atteint pour la première fois par le jeu des lois de la nature qu’en plusieurs millions de siècles.
L’infrastructure matérielle de nos communications de masse actuelles correspond en gros à la complexité du système nerveux de certains invertébrés, disons d’un crustacé doté de ganglions nerveux. Les centres de dispatching automatisés dotés d’une mémoire (par exemple les ordinateurs qui règlent le trafic d’Air France), montrent les mêmes éléments théoriques que de tels ganglions. On peut en donner un schéma identique, où l’on est étonné de retrouver les mêmes fonctions disposées dans le même ordre.
Le cerveau humain, avec ses quinze ou vingt milliards de neurones et le nombre incalculable de ses connexions (le professeur Debray parle prudemment de centaines de milliards), fournit en revanche un modèle qui, même du point de vue strictement matériel, semble dépasser les possibilités de toute fabrication par l’extérieur. Le vulgarisateur qui, il y a quelques années, croyait proposer une image frappante en écrivant qu’une fourmi fabriquée avec des transistors serait plus grosse que l’Empire State Building, n’avait aucune idée de la complexité d’un simple neurone.
Le gland contient le chêne
Le neurone, que l’on peut, en ne considérant que sa fonction de corrélation, comparer à un transistor, est en effet déjà en lui-même une formidable machine. Il est déjà une cellule vivante, et le seul problème de la membrane de la cellule la plus primitive est en lui-même inextricable. Cependant, entre les mécanismes respectifs de la communication de masse à l’échelle humaine (les mass media), la communication animale, la communication organique et, plus bas encore, la communication biochimique et biomoléculaire, il existe plus qu’une analogie : il y a bel et bien un schéma commun que la science s’efforce d’expliciter.
Ceux qui posent le problème de l’évolution en ne considérant que les êtres et les machines ne voient pas l’essentiel. L’ordre d’apparition de ces êtres et de ces machines suggère et même impose l’existence, dans l’ultime réalité du monde matériel, au cœur de l’atome, et plus loin dans la particule, voire dans la définition primordiale de l’énergie qui enfante les champs, les particules et les rayonnements et, qui sait, plus loin encore tout être, d’une latence antérieure à tout ce que nous voyons et étudions.
Cette latence contient déjà tout l’ordre ultérieurement développé, comme le gland contient le chêne. Dire que la physique quantique « explique tout », c’est donc ne rien dire : par quelle nécessité la physique quantique contiendrait-elle déjà l’homme ? C’est à cela qu’il faut répondre. Et si l’on dit que cette question n’a pas de sens, alors, on doit m’expliquer bien clairement, à partir d’où la science doit abdiquer et renoncer à s’interroger. (4)
Aimé MICHEL
Les Notes de 1 à 4 sont de Jean-Pierre Rospars
(*) Chronique n° 141 parue dans France Catholique-Ecclésia − N° 1376 − 27 avril 1973.
(1) Il s’agit là d’un des rares passages où Aimé Michel évoque son activité professionnelle au Service de la Recherche de l’ORTF dirigé par son ami Pierre Schaeffer, polytechnicien, musicien et professionnel des media. Cette recherche sur la communication animale et humaine est à rapprocher de son intérêt pour l’éthologie.
(2) Le collège d’enseignement secondaire (CES) Edouard-Pailleron, nommé en l’honneur de l’homme de lettres E. Pailleron (1834-1899), est situé au 35 de la rue du même nom dans le 19e arrondissement de Paris. Le soir du 6 février 1973 quatre classes de solfège du conservatoire du 19e y travaillent pour la première fois, les salles de la mairie étant trop exiguës pour accueillir tous ces élèves. A 19h40, un premier foyer d’incendie se déclare à l’entresol et très rapidement d’autres foyers apparaissent aux différents étages. L’une des classes réussit à sortir, deux autres brisent les vitres et sortent sur une terrasse et sont évacués à l’aide d’une échelle. La plupart des rescapés sont intoxiqués par l’épaisse fumée et les gaz. A 19h50 les premiers pompiers arrivent mais ils ne connaissent pas les lieux et ne savent pas où sont les bouches d’incendie. L’instituteur de la première classe et la concierge du collège tentent de secourir la dernière classe ; ils ne ressortiront pas : à 20h10, le collège s’effondre provoquant la mort de 20 personnes, 16 élèves et 4 adultes.
L’incendie est d’origine criminelle. De jeunes pyromanes ont mis le feu à une bouteille de white spirit. Mais la lourdeur du bilan provient de la conception du bâtiment réalisé selon un procédé industrialisé de type « constructions modulaires ». Il comporte une structure métallique avec des panneaux de façade en béton, les toitures et les cloisons étant en panneaux de bois. La structure métallique n’est pas protégée ; après un certain temps d’exposition à des températures élevées (500° ou plus), l’acier perd ses propriétés mécaniques, devient mou et se déforme sous le poids. Les vides horizontaux et verticaux, associés à des matériaux isolants comme le bois de sapin et le polystyrène facilitent la propagation des flammes et l’émission de fumées toxiques.
L’Education Nationale tente de réduire le drame à la folie des pyromanes. Les familles des victimes regroupées en association mettent en cause les règles de construction. Dès 1973, elles sont revues et, en 1979, trois hauts fonctionnaires, le constructeur et l’architecte sont condamnés à des peines de prison avec sursis, puis amnistiés. Au total entre 1960 et 1975, 1061 établissements à structure métallique ont été construits en France pour faire face à la poussée démographique et à la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans (1959). Parmi eux, 57 bâtiments scolaires l’ont été selon le procédé « constructions modulaires » (dit « Pailleron » après l’incendie). Ils seront par la suite détruits ou feront l’objet de travaux importants.
(3) C’était dans l’article : Nos systèmes électroniques ? Des crustacés… (Science et Vie, n° 529, octobre 1961, pp. 94-99). L’article s’achevait par cette annonce qu’Internet, Google et autres sont en train de réaliser : « Un jour viendra – dont parlent déjà les spécialistes – où toutes les mémoires artificielles, toutes les bibliothèques, tous les centres de documentation, en fait tout le patrimoine culturel de l’humanité, seront unifiés dans un réseau planétaire où tout travail humain, tout progrès individuel, toute trouvaille, toute idée nouvelle s’intégreront à mesure pour être aussitôt utilisés collectivement. L’homme aurait alors involontairement fait de l’humanité un être unique promis à de nouveaux progrès. C’est peut-être un rêve, mais la logique de l’évolution actuelle semble nous y conduire inéluctablement. »
(4) La question posée par Aimé Michel est plus d’actualité que jamais. Ce « schéma commun que la science s’efforce d’expliciter », cette « latence » (et son corollaire l’émergence), sont notamment étudiés dans le cadre des systèmes complexes (voir note 3 de la chronique n° 107, La question de Ponce Pilate, parue ici il y a deux semaines). La communication entre individus ne sert pas seulement à transmettre des informations (la mort de la reine ou celle du président de la République) mais surtout à résoudre des problèmes. Les fourmis, par exemple, sont capables de trouver le chemin le plus court entre la fourmilière et une source de nourriture. Comment font-elles ? Elles déposent des phéromones sur le sol et tendent à suivre les pistes les plus intensément marquées. La fourmi qui a trouvé (par hasard) une source de nourriture et est revenue la première au nid, a marqué deux fois le chemin, à l’aller et au retour. Ce chemin se trouve donc favorisé et renforcé par les autres fourmis. Les fourmis n’ont pas choisi le chemin le plus court mais le chemin le plus marqué, et la sélection de l’itinéraire le plus court est le résultat de l’activité de l’ensemble de la colonie. Jean-Louis Deneubourg de l’Université libre de Bruxelles, Guy Théraulaz de l’Université Paul Sabatier de Toulouse et leurs collègues se sont illustrés dans ces recherches. Ils ont proposé le terme d’« intelligence en essaim » pour désigner les solutions qui émergent du comportement collectif des insectes sociaux et ont mis au point sur ces bases des algorithmes informatiques qui se sont révélés très puissants.
Ces travaux ne sont pas récents : Rémy Chauvin en particulier s’y est très tôt intéressé. Il est à l’origine d’un des premiers (sinon du premier) algorithme simulant ce type de comportement : cf. F.G. Gallais-Hamonno et R. Chauvin : Simulations sur ordinateur de la construction du dôme et du ramassage des brindilles chez une fourmi (Formica polyctena), C. R. Acad. Sc. Paris, 275D : 1275-1278 (1972). On trouvera au chapitre 2, judicieusement intitulé « Une mécanique sans panne » de son livre Dieu des fourmis, Dieu des étoiles (Belfond-Le Pré au Clerc, Paris, 1988) d’autres exemples de ces comportements où « la fourmi erre au hasard, ramasse au hasard, construit au hasard » mais où le hasard est infléchi, piégé. On en vient ainsi à des questions plus générales sur l’émergence de propriétés nouvelles au cours de l’évolution et à la possibilité même de ces émergences. Nous y reviendrons une autre fois…