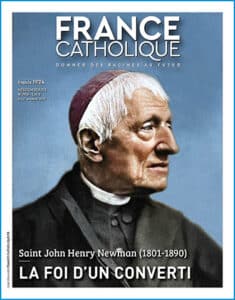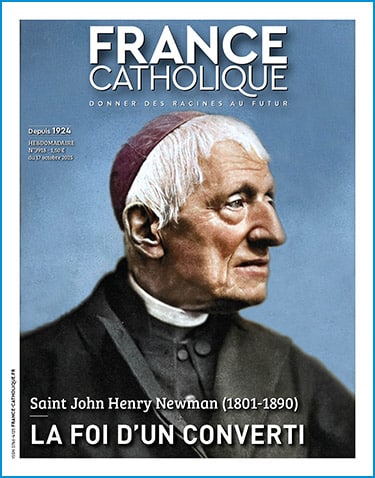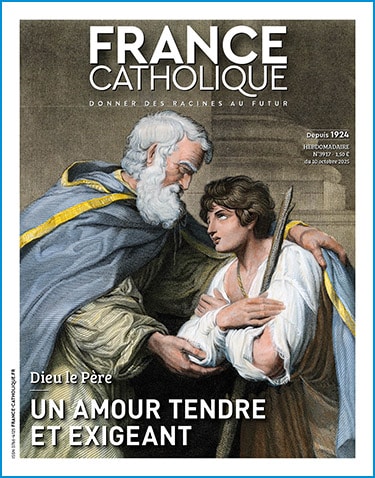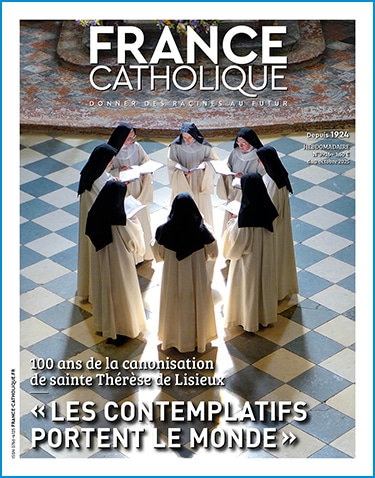Vatican II est désormais un événement majeur de l’Histoire. Ceux qui le découvrent aujourd’hui n’en ont pas la même perception que ceux qui l’ont vécu. Que peut-on dire de ce décalage et quelles conséquences a-t-il pour la compréhension du Concile ?
La question de la réception d’un concile s’est toujours posée, parce que l’Église vit dans l’histoire et au risque de l’histoire. C’est une des raisons pour lesquelles le cardinal Newman parlait de développement. Les choses ne sont pas écrites une fois pour toutes, même s’il y a une cohérence rigoureuse de la doctrine. Par ailleurs, des problèmes et des difficultés ne cessent d’apparaître qui sollicitent sans cesse des réponses et une ressaisie d’un éclairage doctrinal. Je suis d’autant plus sensible à cet aspect des choses que j’ai vécu le déroulement de Vatican II. Lorsque je me remémore les conditions dans lesquelles il s’est déroulé, je suis contraint de faire l’analyse de ce qui nous sépare aujourd’hui de la culture des années soixante. À certains égards, nous avons changé de monde : les problématiques d’aujourd’hui ne ressemblent guère à celles d’il y a cinquante ans. Est-ce pour autant que Vatican II aurait perdu de sa pertinence et de son autorité, je ne le crois pas. Mais cela demande de longues explications.
Le Concile précède — mais le verbe est-il approprié ? — une crise de civilisation qui va se révéler pleinement en 1968. L’hésitation s’explique parce que, probablement, la mutation est déjà là au cours des quatre années des sessions conciliaires, mais on ne la perçoit pas encore. Les événements qui se sont produits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont été suffisamment marquants pour qu’on n’anticipe pas sur d’autres mutations. Le mouvement de décolonisation s’achève à peine, la reconstruction de l’Europe a débouché sur une expansion économique sans précédent qui a donné la société de consommation. Je rappelle aussi pour mémoire que le monde est dominé par l’opposition entre l’empire communiste qui n’a cessé de s’affermir et les pays qui se réclament de la liberté. Il y a, à ce moment, un espoir de coexistence pacifique, inaugurée par l’ère Khrouchtchev-Kennedy.
Ces données sont présentes dans la tête des Pères conciliaires et elles orienteront particulièrement les travaux de la constitution Gaudium et Spes. Il est vrai que ceux-ci sont tenus à une relative prudence : c’est ainsi qu’ils s’interdiront une condamnation explicite du communisme qu’une minorité d’entre eux appelait de ses vœux. Un historien comme Alain Besançon s’est montré particulièrement sévère à l’égard de cette timidité, y dénonçant un silence condamnable à l’égard d’un totalitarisme meurtrier et persécuteur des chrétiens. Jean XXIII s’était voulu complètement positif, ne désirant pas un concile de condamnation, ayant choisi la voie de la proposition positive de la foi. Mais il faut noter à ce propos une certaine équivoque qui apparaîtra immédiatement après la clôture de Vatican II. En saluant l’évolution du monde contemporain et en reconnaissant tous ses mérites, l’Église ne courait-elle pas le risque de s’identifier à une sorte d’humanisme consensuel où on ne verrait plus l’affirmation de sa différence ?
Déjà, le désaccord sérieux qui s’était manifesté entre l’épiscopat français et l’épiscopat allemand lors de l’élaboration du texte sur les rapports de l’Église et du monde anticipait cette réelle ambiguïté. Les Allemands s’opposaient à une vision unilatéralement positive du monde moderne. Un Maurice Clavel quelques années plus tard pourra dénoncer la liquidation humanistique du christianisme. L’humanité n’est-elle pas toujours à sauver et n’y avait-il pas risque d’oubli de la Rédemption avec cette adhésion à un optimisme parfois très mondain ?
Mais les termes mêmes d’un tel optimisme vont être démentis à travers la révolution intellectuelle des sixties. Un philosophe de la post-modernité comme Lyotard parlera de la disparition des grands récits. Ce qui avait fait le succès du marxisme va disparaître au profit d’un individualisme souvent éclaté. Dans la société de consommation, qui s’est bien établie, s’affermit le règne des égos, ceux-ci se désintéressant d’une philosophie de l’histoire reprise du XIXe siècle. Beaucoup de sociologues tenteront la radioscopie de cette société différente. Un François Ricard parlera d’une « génération lyrique » déliée de toutes les valeurs sacrificielles d’antan. Un Gilles Lipovetski parlera pour sa part de « l’ère du vide ». Les destins labyrinthiques d’un chacun ne sont plus inspirés par les grandes idéologies mais par la simple quête d’un bonheur privé. L’explosion de 1968 correspondra tout à fait à ces données, et l’Église sera cruellement atteinte dans son âme et dans sa chair par des phénomènes de société qui la déstabiliseront, au point de mettre à mal nombre d’espoirs portés par le Concile.
Cette formidable crise de société qui affecte l’Église a-t-elle rendu vain le grand labeur de Vatican II ?
Je ne le crois pas du tout. C’est Marx qui expliquait que les hommes ne font jamais l’histoire qu’ils croient faire. C’est la postérité qui établit le sens des événements vécus par ses prédécesseurs. On peut dire dans le même sens que les acteurs de Vatican II ont tracé des voies pour un monde qu’ils ne soupçonnaient pas. Mais il faut prendre quelque distance pour mieux discerner ce que fut l’apport de Vatican II et qui, très souvent, ne correspond pas aux analyses et aux attentes des contemporains.
Revenons au souci positif de Jean XXIII. On peut faire quelques réserves sur l’optimisme du bienheureux qui dans son discours d’ouverture dénonçait les prophètes de malheur. Il m’est arrivé de dire malicieusement qu’à vouloir combattre de tels prophètes, c’est la Bible qu’il faudrait expurger. Mais ce parti pris positif avait aussi ses avantages. Il s’agissait d’exposer dans un discours suivi les richesses de la doctrine chrétienne pour qu’elles brillent aux yeux des hommes et des femmes d’aujourd’hui, surtout en climat d’ignorance et d’indifférence. Il est vrai que c’était une rupture par rapport à la tradition conciliaire qui avait très souvent procédé par anathème pour condamner les erreurs et défendre la pureté de la foi. Sans doute la modernité était-elle traversée par d’autres erreurs, et des plus pernicieuses, mais il pouvait être judicieux de mettre en évidence le miracle de l’Évangile et la beauté de l’Incarnation et de la Rédemption.
Par ailleurs, les responsables de l’Église ne pouvaient pas ne pas tenir compte des nouveaux équilibres internationaux et sociétaux. Depuis 1870 et la tenue du premier concile du Vatican, l’Église catholique elle-même avait été confrontée à des changements politiques et civilisationnels, auxquels il avait bien fallu s’adapter. La définition de l’infaillibilité pontificale correspond dans le temps à la fin des États pontificaux. L’évêque de Rome va être libéré du souci immédiat d’un gouvernement politique, ce qui lui permettra de s’identifier beaucoup plus à sa mission spirituelle. Ce qui est vrai de la papauté l’est aussi des Églises nationales qui vont progressivement se trouver séparées des États nationaux. La loi de séparation des Églises et de l’État en France correspond à un changement de positionnement de l’Église par rapport à l’autorité politique et à la société. Dans les anciens régimes, l’Église s’identifiait aux symboles du pouvoir, même s’il y avait une autonomie du spirituel. Désormais, elle est une institution libre qui jouit de son indépendance et qui n’est plus reçue comme officielle. Il importait dans ces conditions d’en tirer toutes les conséquences.
D’où l’importance de la déclaration sur la liberté religieuse. Ce texte qui n’a pas l’autorité d’une constitution dogmatique n’en revêt pas moins une grande importance, car il clarifie une situation de fait en apportant un éclairage théologique.
A-t-il pleinement répondu à sa tâche ? On peut en discuter, comme l’abbé René Laurentin qui aurait désiré un approfondissement biblique de certaines notions. Comme tel ce texte s’est révélé précieux pour légitimer l’existence d’un corps religieux dans une société de type libéral. Il n’empêche que des interrogations demeurent, notamment à propos de la laïcité et de la place de l’Église dans la société. Si l’État est laïque, la société peut être religieuse dans nombre de ses aspects et la liberté d’évangélisation ne saurait être formelle.
À l’heure de la mondialisation, Vatican II n’a-t-il pas été prophétique en posant la question d’un dialogue globalisé avec les autres religions et les réalités d’un monde en voie d’unification ?
On retrouve ici l’autre déclaration du Concile dont l’élaboration fut pénible et qui continue à susciter des interrogations. Nostra Aetate a été libératrice à bien des égards, notamment avec la redéfinition des rapports entre le judaïsme et le christianisme. C’était pourtant la reprise pure et simple du grand enseignement de saint Paul dans l’épître aux Romains, mais il est vrai que celui-ci avait été souvent oublié ou masqué. Ce sont les brûlures du passé, singulièrement de la seconde guerre mondiale qui avaient obligé à cette mise au point qui aura des conséquences considérables, notamment sous le pontificat de Jean-Paul II. En ce qui concerne les autres religions, les choses sont plus mêlées, à mesure que l’on s’éloigne d’une inspiration proprement biblique. Il suffit de penser à l’islam d’aujourd’hui avec la dimension politique mondiale qui est la sienne et qui ne cesse de retentir dans l’actualité. Il y a eu aussi le risque de relativisme et de syncrétisme dénoncé par Dominus Iesus, un document très important de la Congrégation pour la doctrine de la foi pour prendre conscience de la gravité de certaines dérives. Il faut souligner ici combien Vatican II a été à l’origine d’une nouvelle pratique ecclésiale à l’égard des réalités contemporaines. L’indépendance spirituelle ne signifie nullement le désengagement à l’égard des grands défis du moment. On s’est d’ailleurs aperçu qu’un tel engagement pouvait être conflictuel et que l’Église demeurait un signe de contradiction, lorsqu’elle s’engageait contre la culture de mort, thème dominant du pontificat de Jean-Paul II.
Mais il faut en venir au cinquantenaire lui-même. N’est-il pas remarquable que Benoît XVI ait décidé que cet anniversaire donnerait lieu à une année de la foi ?
Cela paraît en effet capital. Mais Benoît XVI ne rejoint-il pas le bienheureux Jean XXIII dans sa volonté de mieux affirmer le message évangélique ? Un tel souci correspond d’abord à une nécessité élémentaire, celle qui s’est traduite par l’institution d’un nouveau secrétariat au Saint-Siège pour la nouvelle évangélisation. Ce terme même de nouvelle évangélisation est à rapporter à l’héritage conciliaire. Il ne faut pas oublier qu’un des premiers synodes épiscopaux, réuni à l’initiative de Paul VI, avait eu pour thème l’évangélisation, ce qui avait donné lieu à l’exhortation apostolique Evangelii nuntiandi. Mais tout ce qui s’est passé ces dernières décennies a marqué l’effondrement de la foi chrétienne en Europe, ce qui nécessite une entreprise missionnaire de première grandeur. Certes l’Église y est accoutumée. À plusieurs reprises il a fallu réévangéliser l’Europe. Mais cette fois la tâche paraît d’autant plus considérable qu’elle se fait dans une phase d’oubli assez radical de la culture chrétienne. On en est au point où la simple mention des racines chrétiennes de l’Europe est dénoncée comme une atteinte insupportable à la neutralité des institutions. Il ne s’agit pas seulement du principe de séparation, mais d’un combat culturel d’une ampleur nouvelle. Nous avons vécu toutes les conséquences de l’éclatement sociétal des années soixante. On en est aujourd’hui à la dictature du relativisme et plus encore à des mutations anthropologiques qui rompent avec les structures sociales modelées par 2000 ans de christianisme.
Il me semble que la priorité reconnue par le Pape va à la transmission d’un patrimoine obstinément refoulé. En cette période de rentrée scolaire, mais aussi catéchétique, les statistiques révèlent qu’il n’y a plus que 20% des enfants d’Île-de-France à être catéchisés. On conçoit donc l’effort considérable qu’il s’agit de développer afin de retrouver le contact avec les familles et les enfants. Il y a cinquante ans on n’en était pas là, l’Église catholique avait encore des assises populaires considérables. C’est peut-être le moment de s’interroger, même s’il ne s’agit pas de stigmatiser, sur ce qui a été à l’origine de cette déculturation et de cet éloignement de la société par rapport à ses traditions.
Le cinquantenaire de Vatican II ne sera pas pour l’Église un moment de célébration mais il constituera un moment de mobilisation intense. Il s’agira pour tous de revenir aux sources vivantes de la Révélation, comme y invitait la Constitution Dei Verbum, trop peu étudiée et cela afin de faire connaître l’Église comme Lumen Gentium. On comprend ainsi que Vatican II n’est pas un événement d’hier mais constitue une sollicitation pressante à la conversion et à l’évangélisation.
— –
À relire :
Gérard Leclerc, Les dossiers brûlants de l’Église, 320 pages, Presses de la Renaissance.
Luc Baresta, Jean XXIII, un bienheureux dangereux ?, 332 pages.