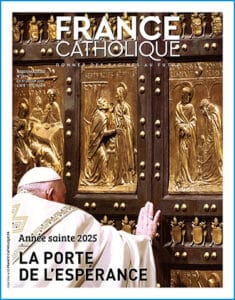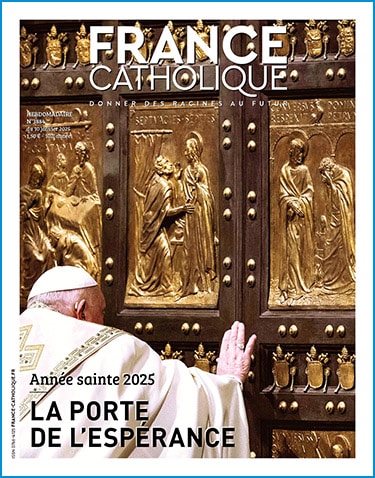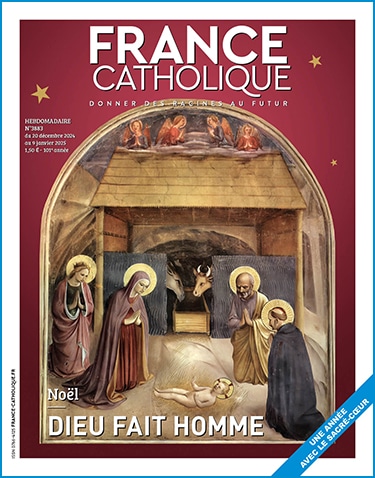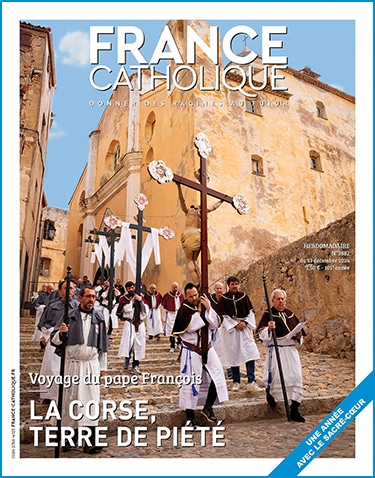Chronique n° 412 parue initialement dans France Catholique – N° 2039 – 24 janvier 1986
Le bourdonnement des nouveautés techniques nous cache la vraie science…
– qui n’est pas l’énergie, ni la bombe atomique ;
– qui n’est pas l’informatique ;
– qui n’est ni la pilule, ni les mères porteuses, ni la télévision câblée, ni Ariane, ni le poulet aux hormones, ni la guerre des étoiles, ni le TGV, ni rien de ce chaos qui transforme notre environnement si vite que, nous n’avons même plus le temps de nous y habituer avant de le voir disparaître.
Tout cela n’est que techniques, c’est-à-dire application de découvertes parfois vieilles d’un demi-siècle, voire de plusieurs siècles. L’informatique, par exemple, utilise une électronique dont les principes datent du début du siècle. La miniaturisation (les « puces »), c’est de la physique appliquée, certes plus récente, mais ne faisant appel à aucun principe physique inconnu il y a cinquante ans.
Quant aux recherches qui nous étonnent et nous étonneront encore, comme la traduction automatique ou l’ « intelligence artificielle », elles se développent essentiellement sur la « base numérique deux » à laquelle réfléchissait déjà Leibnitz, et la logique formelle d’Aristote.
Mais alors, la science où est-elle ? Elle est dans les recherches (et découvertes) d’où sortiront demain des techniques différentes et imprévisibles. Elle est surtout dans les recherches qui changent notre vision du monde (a) et de nous-mêmes, et qui (« N’ayez pas peur », premier mot du Pape) pénètrent au cœur de nos plus anxieuses interrogations métaphysiques, voire théologiques. Non pour y répondre, car la science ne résout les questions qu’en posant d’autres questions plus difficiles, mais pour nous renouveler, pour nous montrer un peu plus avant l’insondable profondeur de la Genèse Créatrice.
Exemple : une des grandes découvertes de ce siècle est l’expansion de l’univers : les astres lointains de grandes dimensions (les galaxies) s’éloignent tous de nous, et, plus lointains ils sont, plus vite ils s’éloignent. Serions-nous au centre d’une explosion cosmique ? Non. Les mesures montrent que toutes les galaxies s’éloignent les unes des autres, où que l’on se place, et qu’il n’y a pas de centre de dispersion. L’univers (en expansion) est un volume dont le centre est partout et la surface externe nulle part.
On peut à peu près comprendre cela par une image. Sur un ballon d’enfant, peignons des galaxies, puis gonflons le ballon : toutes les distances entre ces galaxies, mesurées à la surface du ballon, augmentent à mesure que l’on gonfle.
Si donc les galaxies. s’éloignent les unes des autres (Hubble, 1929), cela signifie que dans le passé elles étaient plus proches. Que plus le passé considéré est ancien, et plus elles étaient rapprochées. Qu’à un certain moment, elles n’occupaient qu’un point unique. Et qu’« avant » ce moment…. eh bien, avant ce moment, il n’y avait pas d’ « avant », puisque c’est à ce moment-là que le point unique apparaît, produisant l’espace et le temps. II ne peut y avoir ni lieu ni temps en l’absence d’espace temps.
Voilà déjà une belle question métaphysique. Et la science, en la traitant, possède sur la métaphysique un bel avantage : le calcul. En l’occurrence, il est facile de mesurer la vitesse d’éloignement mutuel (on dit de récession) des galaxies, et, connaissant leur distance, de calculer par une simple division la date où tout cela commence. On trouve 16 milliards d’années. L’univers a commencé il y a 16 milliards d’années. « Avant »… il n’y a pas d’« avant ». Le temps a commencé il y a 16 milliards d’années.
La lumière ne se propage pas instantanément. Pour venir de la lune, il lui faut une seconde. Du soleil, huit minutes. La plus proche étoile, plusieurs années. Nous voyons donc une étoile telle qu’elle était il y a quelques années.
Mais alors, si l’on observait des régions de l’espace tellement éloignées que la lumière, pour parvenir à nous, a voyagé pendant 16 milliards d’années, que verrait-on?
On verrait, répond mi-figue, mi-raisin l’astronome américain, Carl Sagan, on verrait « la Main de Dieu». On verrait, en tout cas, les premiers instants de l’univers, son apparition dans le néant, bref, ce que l’on appelait sa « création» tant qu’on se croyait bien assuré que « la création » était un fantasme religieux inventé par une classe dominante pour terrifier ses esclaves dans les ténèbres de la préhistoire.
Les astronomes américains sont actuellement en train d’envoyer leur premier grand radiotélescope multiple, destiné à recevoir les ondes radio plus anciennes que 10 ou 12 milliards d’années. Cet appareil colossal est formé de plusieurs radiotélescopes répartis sur une distance de 8 000 kilomètres (jusqu’aux îles Hawaï), comme un seul œil de 8 000 kilomètres de diamètre.
La presse n’a consacré que quelques paragraphes à cet événement. Parce qu’elle est stupide ? Parce que les journalistes sont ignares ? Non pas : parce que nous, le public, sommes stupides et ignares. Parce qu’à tout Homo sapiens sensé et se préparant gravement pour les ides de Mars, la curiosité de ce qui a pu se passer aux premiers instants de l’univers apparaît infantile, sénile, débile, stérile, imbécile, digne de ces personnages irresponsables que sont les savants, gaspillant notre argent dans leurs thébaïdes.
Si, au lieu des dernières rumeurs du Palais, des derniers meurtres à la mode, des derniers mots murmurés par les Augures et les Augustes, un journal se mettait à consacrer chaque jour, pendant des mois, plusieurs pages à nous expliquer ce que l’on voit à l’origine des choses, il perdrait tous ses lecteurs et M. Hersant serait obligé de le racheter.
Nous sommes ainsi, Messieurs et Mesdames. Sincèrement, ce radiotélescope américain ne vous fait-il pas baîller d’ennui ?
Tant pis, je poursuis.
Si l’on sait depuis un demi-siècle que l’univers a commencé il y a un temps quelconque (évalué à 16 milliards d’années, mais qu’importe le chiffre), si l’on sait qu’« avant » il n’y avait pas d’« avant », comment existe-t-il encore un seul astronome athée ? Il y a force discussions sur ce point dans le livre que je n’ai pas lu.
Peut-être est-ce parce que les mots « Dieu » et « création » ne sont pas prononcés ? On peut en effet approfondir indéfiniment, et peut-être infiniment, les calculs sur les premières micro-secondes de l’univers (cf. le beau livre de l’astrophysicien Hubert Reeves « Patience dans l’azur ») et la vocation de la science est de ne jamais laisser place à l’incertitude métaphysique. Mais, tout de même, sans sortir de leurs équations, les savants énoncent des idées vertigineuses, et ils les énoncent pour la première fois, devançant les philosophes dans l’élaboration de concepts nouveaux, jusqu’ici réputés philosophiques ou métaphysiques.
Par exemple, précédant l’observation par le nouveau radio-télescope des premiers instants du temps, une réflexion peut se développer logiquement grâce au schéma fourni par la physique quantique.
Dans ce schéma, le mot « création » est remplacé par l’expression « fluctuation quantique ». Peu importe ce que sont cette physique et cette fluctuation : ce n’est pas sous l’effet d’une horreur sacrée pour le concept théologique de « création » que les physiciens se passent de ce concept ; c’est parce que leur physique, jusqu’ici, suffit très bien à expliquer ce qu’ils observent dès qu’il y a quelque chose à expliquer. La physique décrit très bien ce qui se passe dès qu’il y a quelque chose. Et « quand » (si l’on peut dire) il n’y a rien, la physique n’a pas à se faire de souci.
Ah ! que j’aimerais lire quelques belles réflexions philosophiques, métaphysiques ou peut-être théologiques sur ces minces détails. De belles réflexions, j’en lis, mais sous la plume de physiciens qui n’ont pas une âme moins brûlante que ceux dont le métier serait de brûler. J.A. Wheeler : « Dès le premier instant du temps, tout est logique. Mais qu’est-ce que cette logique plus primitive que toute existence ? » (b)
Wheeler (et d’autres) ont proposé des réponses à cette, question. La plus saisissante est une critique du mot « être » considéré dans son explication quantique, il est évident que l’univers n’« est » pas (encore une fois peu importe la nature de cette « explication quantique » : je me borne à noter que seuls les physiciens s’en soucient). Eh oui : c’est curieux, mais parfaitement évident, tout physicien théoricien le sait, l’univers n’« est » pas. Comment, 1’univers n’« est » pas ?
Eh non. L’univers, hors l’opération de mesure faite par l’observateur, n’appartient pas à l’ontologie, « connaissance de l’être ». Les physiciens parlent de « nature virtuelle » ou « potentielle » (c). Certains ont même redécouvert le concept d’« ontologie », pour remarquer que, hors la mesure expérimentale, on ne sait rien à quoi ce concept soit applicable. Rien ? Et personne ne répond ?
Qu’il serait intéressant le gros livre métaphysique, voire théologique, qui traiterait de ces questions (d). Mais bah, je suis vieux, j’ai appris à m’en passer. Ce gros livre appartient sans doute, comme le reste, à la « nature virtuelle ». II suffit de le savoir et de renoncer à le chercher (1).
Aimé MICHEL
(1) Il existe à vrai dire, en anglais, et écrit par un physicien. Faute de combattants, il démontre lumineusement que « Dieu » est une idée creuse. Quel Dieu ? Celui du physicien. Qui reprocherait à un physicien d’ignorer tout du Dieu vivant ? Davies : « God and the New Physics » (Londres, 1983, Dent éditeur). (e)
Notes de Jean-Pierre Rospars
a) C’est là le rôle historique de la science et la raison pour laquelle elle mérite qu’on prenne le temps de s’informer de ses résultats. Même si ces résultats semblent loin de nos préoccupations quotidiennes, voire des défis que l’humanité doit relever, il s’agit là d’une apparence trompeuse, comme la chronique de la semaine dernière, Plus loin que la vie et que la mort, l’affirmait également. Mais, comme on le voit ici, Aimé Michel n’ignorait pas les difficultés du lecteur partagé entre l’ennui de faits abstraits qui ne le touchent pas et l’effroi que peut soulever le dévoilement d’une réalité fort éloignée du rassurant quotidien. Il accompagne donc ce dévoilement d’une incitation à la contemplation et à la confiance et voit dans cette attitude de foi une nécessité de survie pour l’humanité.
b) John Archibald Wheeler (1903-2008) est un physicien théoricien américain qu’Aimé Michel cite souvent. Imaginatif et disert, il n’hésitait pas à avancer des idées « à moitié cuites » pour inciter à la réflexion. C’est lui qui aurait proposé le nom évocateur de « trous noirs » pour désigner ces effondrements de l’espace-temps prévus par la relativité générale dont nulle lumière ne peut s’échapper.
c) C’est un des enseignements de la physique quantique. Aimé Michel y a beaucoup réfléchi. En contact direct avec des physiciens, il a été un excellent vulgarisateur de cette discipline dont il a bien mis en valeur l’importance philosophique. Nous y reviendrons.
d) Aimé Michel regrette régulièrement le désintérêt des philosophes contemporains pour les « grandes questions » : qui sommes-nous ? d’où venons-nous ? où allons-nous ? Ce gros livre potentiel il l’aura finalement lui-même écrit comme le montre ses nombreux textes dispersés. On pourra en juger dans La Clarté au cœur du labyrinthe et L’Apocalypse molle qui ne rassemblent pourtant que ses chroniques de France Catholique et sa correspondance avec Bertrand Méheust. Un autre « gros livre » (537 pages) aurait certainement été salué par Aimé Michel comme une de ces synthèses qu’il appelait de ses vœux : « Notre existence a-t-elle un sens ? Une enquête scientifique et philosophique » de Jean Staune (Presses de la Renaissance, 2007). Il offre un parallèle instructif avec l’œuvre d’Aimé Michel. Bien qu’indépendant de celle-ci il reprend certains de ses éléments (mais non pas tous) et en poursuit la réflexion. Il s’appuie souvent sur les mêmes travaux qu’Aimé Michel et sur ceux que j’ai indiqués en notes dans La Clarté lorsqu’ils sont parus après sa mort en 1992.
e) Aimé Michel revient ici sur le livre de Paul Davies auquel il a déjà consacré une chronique peu après sa parution, Quand les physiciens relaient les philosophes : Le retour en force des grandes questions (reproduite dans « La clarté au cœur du labyrinthe », pp. 63-66). Il m’avait conseillé ce livre, certes passionnant, mais dont j’avais trouvé l’argumentation sur Dieu quelque peu légère et dont j’avais mis du temps à comprendre ce qu’il y trouvait de réjouissant. Pourtant c’était un point essentiel : la « mort de Dieu » version Aimé Michel, à savoir la distinction radicale à faire entre le Dieu-hypothèse de Davies, « celui des philosophes et des savants, celui même des théologiens qui se croient modernes », et le Dieu vivant, celui du croyant qui « ne considère pas la foi comme une hypothèse scientifique vérifiable » mais comme une « expérience personnelle ». En tout cas c’était le premier livre de vulgarisation d’un physicien qui a beaucoup écrit depuis lors et acquis une grande notoriété. Aimé Michel, comme a son habitude, avait repéré avant tout le monde un auteur de talent.