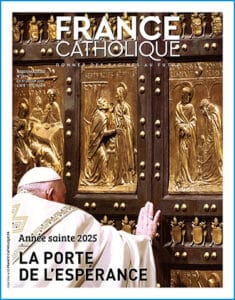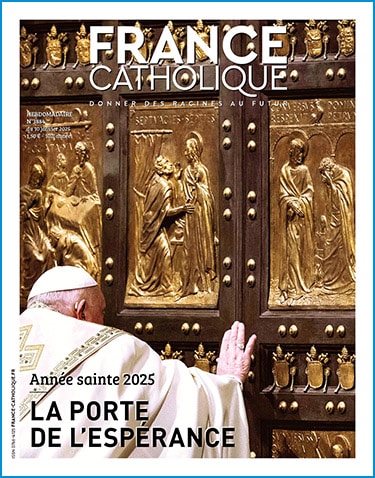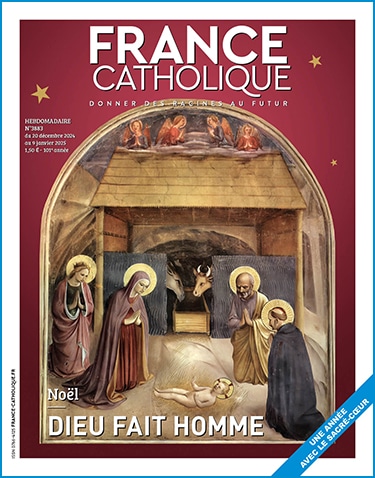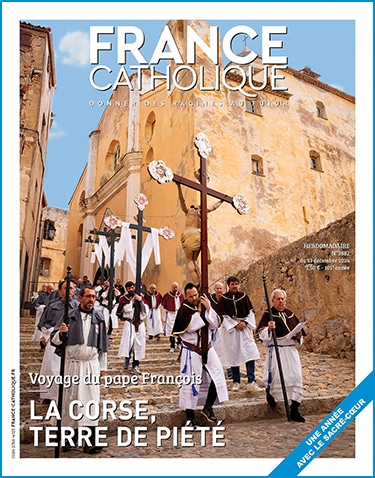J’ai essayé de montrer dans une précédente chronique (FC du 11 août)1 que le grand marchandage technologique et scientifique actuellement en cours entre Russes et Américains aboutira soit à la libéralisation de la Russie, soit à sa colonisation par l’Amérique. Cette prédiction est donnée sur une hypothèse que je voudrais expliciter aujourd’hui : c’est que le progrès scientifique et technique ne peut plus désormais être planifié, que toute planification aboutit soit à l’égarer sur de fausses pistes, soit à le bloquer.
Comme il ne saurait être question de démontrer pareille hypothèse dans une brève chronique, je me bornerai à l’illustrer par un exemple, mais caractéristique.
Prendre le train en marche
Il y a une dizaine d’années, un jeune mathématicien de mes amis émigrait aux États-Unis pour y acquérir les connaissances de pointe en matière de mathématique des ordinateurs. En trois ou quatre ans, il passait son doctorat ès sciences dans une grande Université, devenait l’un des meilleurs dans sa partie, et à plusieurs reprises était désigné pour représenter les États-Unis dans des conférences internationales2.
Je suivais de loin, avec admiration, cette carrière météorique, non toutefois sans m’interroger avec perplexité sur un point particulier qui, je l’avoue, m’inquiétait un peu : cet ami ne cessait de changer d’adresse, d’Université et de programme de travail. Tantôt il collaborait ici à une recherche astronomique sur les étoiles doubles, tantôt il participait là à une étude sur le cancer, qu’il abandonnait ensuite pour travailler ailleurs à un programme de la NASA.
Quand après un nombre indéterminé de déménagements il m’annonça, pour ajouter à la confusion, qu’il allait revenir en France, je supposais, soit qu’il n’avait pas trouvé en Amérique une vie intéressante et stable, soit peut-être, mon Dieu, qu’il manquait lui-même dangereusement de stabilité.
Il rentra donc, engagé à distance par les responsables d’un grand programme officiel que je ne nommerai pas3. Il était enchanté de retrouver Paris, ses bibliothèques et ses bouquinistes. Son enchantement ne dura guère.
− Quelle déception me disait-il bientôt. J’étais arrivé ici, ayant sous le bras, conformément à ma correspondance préalable avec le directeur du programme, divers projets d’investigation que je devais mener à bien. Mais depuis que me voilà intégré à l’équipe, il n’en est plus question. Il faut se réunir, discuter les plans et les projets. Pendant ce temps, je ne fais rien, ma spécialité évolue rapidement aux États-Unis, et je suis en train de perdre ma qualification. Chaque fois que je propose que l’on se mette au travail, on me dit qu’il faut d’abord établir bien clairement les objectifs à proposer au gouvernement, donc discuter pour se mettre d’accord sur un plan que le gouvernement ensuite approuvera. Et comme je réponds invariablement que c’est absurde, qu’une recherche ou bien se propose de découvrir de l’inconnu, ou bien n’est pas une recherche et que l’inconnu est, par définition, implanifiable, invariablement aussi, pour m’apaiser, on m’augmente Mais qu’ai-je à faire d’une augmentation ? Je gagne déjà plus qu’aux États-Unis ! Et cela en ne faisant rien d’utile et en sentant irrémédiablement fondre sous mes pieds mon avance professionnelle ! Cela ne peut pas durer.
Il se cramponna un an, de plus en plus malheureux et impatient. Comme il était sollicité par une éminente Université californienne, il finit par s’en aller définitivement. Quand il annonça sa décision, son patron français fut très surpris et fit tout pour le retenir.
− Vous partez, lui dit-il, alors que le plan va être prêt et les crédits votés.
− Peut-être. Mais, premièrement, je travaillerai avec des collègues qui, comme moi, n’ont fait aucune recherche depuis un an ou plus. On ne met pas des cerveaux en marche en appuyant sur un bouton. La recherche est un mouvement entretenu. Le chercheur est ainsi fait qu’il est incapable de démarrer seul. S’il ne prend pas un train en marche, il ne fait rien. Le train que nous avons mis en marche ici est un train de parlottes et c’est ce qu’il restera. Il coûtera les yeux de la tète, n’aboutira à rien et devra dans quelques années avouer son échec. On achètera alors aux Américains les résultats qu’on n’aura pas obtenus ici (a). Et, deuxièmement, ce que j’ai vu en France suffit à me convaincre que si le planificateur s’est trompé, son plan aura créé une situation de fait d’où rien ne pourra nous tirer : nous poursuivrons irrésistiblement dans le même sens, en vertu des structures du plan, et une équipe de chercheurs de première valeur se changera peu à peu en croque-budget et en parasites. Or le planificateur s’est forcément trompé, car il n’aurait pu concevoir un plan convenable qu’au prix de savoir déjà ce que précisément il nous demande de chercher4.
Depuis le retour de cet ami aux États-Unis, je m’interrogeais sur la part de paradoxe que contenait son diagnostic. Lors de mon récent séjour outre-Atlantique, j’ai pu voir fonctionner de l’intérieur sept ou huit projets de recherches dans les Universités suivantes : Stanford (Californie), Utah State University, Colorado State University, Chicago, Northwestern5. Dans tous ces projets, je n’ai vu que des chercheurs d’une très grande mobilité. La plupart n’étaient là que depuis un an, ou moins. Ils s’en allaient dès que leur intérêt commençait à faiblir.
Mais ce qui m’a le plus frappé, c’est que souvent l’initiateur du projet lui-même était parti et que, dans plusieurs cas, le projet avait complètement changé d’objectif en route à cause de la nouveauté des problèmes rencontrés par hasard.
Comme poissons dans l’eau
Dans un de ces programmes, la réalisation la plus remarquable fut la mise au point (tout à fait imprévue) d’un robot traducteur pour les aveugles : la machine traduit en braille n’importe quel texte imprimé ou tapé à la machine. Si ce robot fut imaginé et construit, c’est parce que la fille unique de l’ingénieur principal avait perdu la vue ! Imagine-t-on cela en France ? Quel programme planifié peut être assez souple pour comptabiliser l’amour et le chagrin d’un père ? Que si l’on me dit qu’on peut prévoir des plans assez souples pour fonctionner ainsi, eh bien c’est ce que je disais : c’est qu’alors il n’y a plus de plan.
Certes, il y a là de quoi affoler les Européens toujours obsédés de stabilité. Mais les Américains ont la stabilité en horreur. Je ne dis pas qu’ils ont raison. Je dis seulement que, tant que ce monde sera livré au mouvement, ils y seront comme poissons dans l’eau et prieront Dieu pour que leurs rivaux, eux, s’obstinent à planifier6.
Aimé MICHEL
(a) C’est ce qui s’est produit.
(*) Chronique n° 105 parue dans France Catholique – N° 1340 – 18 août 1972.
Notes de Jean-Pierre ROSPARS
- Il s’agit de la chronique n° 103, Software et politique, parue ici le 1er juin 2010, où Aimé Michel évoque le retard soviétique en informatique et l’achat d’ordinateurs américains par les Russes. Cet achat réalisé, analyse-t-il, du côté russe, « ou bien on persistera dans la planification intégrale, et le retard supposé comblé par cet achat recommencera à se creuser ; ou bien ayant compris la leçon, les planificateurs décideront de libéraliser, creusant ainsi une autre brèche, mais bien plus dangereuse, au flanc du système politique et social lui-même. Car c’est la liberté complète qu’il faut, ou rien, je montrerai cela dans une prochaine chronique à la lumière d’exemples que j’ai pu observer aux États-Unis. ». Ce sont ces exemples qu’ils rapportent dans la présente chronique.
- Ce jeune mathématicien est Jacques Vallée. Il n’a encore jamais été nommément cité par Aimé Michel dans ses chroniques et il faudra attendre l’année suivante pour qu’il commence à le faire (voir la chronique n° 179, Aux USA : renaissance du grec et du latin, parue ici le 19.09.2011). Par contre, nous l’avons déjà cité plusieurs fois en note à propos de la reconnaissance de la parapsychologie comme discipline scientifique (chronique n° 44, L’étrange expérience d’Apollo XIV, 05.10.09), des performances de Fernand Lagarde en radiesthésie (n° 108, Baguettes, pendules et sourciers, 01.03.10), et surtout de la visite d’Aimé Michel aux États-Unis. Sur cette visite, voir les chroniques n° 103, Software et politique, mentionnée ci-dessus ; la n° 208, La bousculade américaine – La source révolutionnaire de ce temps, c’est l’Amérique, 05.12.11, qui conte une rencontre avec le sataniste Anton LaVey ; et celle de la semaine dernière, Quand la machine nous apprend à penser – La naissance du traitement de texte, d’Internet et des moteurs de recherche.
- Ce programme est le fameux « Plan Calcul » lancé en fin 1966 « avec l’objectif de doter la France des capacités industrielles lui permettant d’être autonome dans le domaine des ordinateurs moyens ». Dans un article de 2004, Bétourné et coll. présentent ce Plan ainsi : « Outre son volet industriel, la Compagnie Internationale pour l’Informatique (CII) issue de la fusion des sociétés CAE [Compagnie européenne d’Automatisme Électronique] et SEA [Société d’Électronique et d’Automatismes, filiale de Schneider], le plan calcul comportait un volet scientifique, l’Institut de Recherche en Informatique et Automatique (IRIA), qui avait pour mission de développer la recherche, la formation, et la diffusion de la connaissance scientifique et technique dans ses domaines de compétence. » (Ésope : une étape de la recherche française en systèmes d’exploitation (1968-1972)).
Selon l’article Wikipédia consacré à la CII « Les deux entreprises [SEA et CAE] étaient concurrentes et, après la fusion, les plans avant-gardistes de la SEA furent rapidement abandonnés au profit de la stratégie “incrémentale” de la CAE. La CII fabriqua donc des ordinateurs américains sous licence (…) jusqu’en 1971, avant de commercialiser ses modèles Mitra 15, Iris 50 et Iris 80. Ceux-ci comportaient près de 90 % de circuits intégrés américains (…) : le Plan Composants, jumeau du Plan Calcul, avait produit peu d’effet. (…) La CII a développé des ordinateurs performants, des systèmes d’exploitation et des langages intéressants (…), et s’est investie tôt dans les réseaux informatiques (…), en se plaçant au premier rang des constructeurs européens de mini-ordinateurs. Mais, plus technicienne que marchande, elle n’a jamais atteint la rentabilité, donc l’autonomie de décision vis-à-vis de l’État et de ses maisons mères, Thomson et CGE. ». En 1973, tenue de devenir rentable, la CII s’allie avec Siemens et Philips dans le consortium Unidata. En 1975, le gouvernement de Valéry Giscard d’Estaing, confronté au premier choc pétrolier et à la nécessité d’augmenter constamment sa mise, se retire d’Unidata et fait absorber la CII par Bull-Honeywell, constituant CII Honeywell-Bull. Nationalisée en 1982, l’entreprise, largement privatisée de 1994 à 1997, l’est totalement en 2004. Bull employait plus de 20 000 personnes au début de 1999 mais 7 800 seulement en 2008. Depuis 2007, Bull est à nouveau bénéficiaire et s’est remis à embaucher. L’entreprise s’est acquis une réputation enviable dans le domaine des supercalculateurs et de l’intégration de système. C’est la dernière des entreprises informatiques indépendantes en Europe, toutes les autres ayant été rachetées par des multinationales américaines et japonaises. Ce qui montre, au passage, que les autres états européens n’ont pas fait mieux que la France en matière informatique, ce qui n’est pas une consolation.
François Raymond (1914-2000), ingénieur issu de Supélec, fondateur en 1947 et directeur de la SEA (voir ci-dessus), a fourni des informations intéressantes sur les débuts du Plan Calcul au Colloque sur l’Histoire de l’Informatique en France (édité par Ph. Chatelin, Grenoble, mars 1988, tome 1, pp. 387-411 ; voir http://jacques-andre.fr/chi/chi88/raymond-plan.html). Ce témoin privilégié et acteur clé des évènements porte un jugement d’ensemble qui recoupe les observations de Jacques Vallée et d’Aimé Michel.
Le 9 juillet 1968, dans une Note confidentielle sur le plan calcul, destinée à Jean Roy, Directeur à la Direction Générale de Thomson-CSF, F. Raymond écrit : Le Plan Calcul « doit être poursuivi car les raisons que l’ont justifié il y a plus de deux ans sont toujours valables (…). Il ne s’agit pas en effet de créer et de développer des activités dont on pourrait apprécier les limites ; il s’agit de promouvoir une participation française significative à un effort international particulièrement dynamique : l’informatique est en effet un domaine aux aspects multiples dont on est incapable d’imaginer les limites à long terme. (…) L’observation des efforts continus accomplis aux USA, en particulier, conduit à un diagnostic objectif : il est trop tard pour gagner le pari Plan Calcul dans une perspective de court et moyen termes. (…) Le Plan calcul est sévèrement critiqué. On discerne une erreur et un ensemble de fautes :
L’erreur est : – depuis deux ans, le Plan Calcul est caractérisé par des décisions visant uniquement des actions à court terme au profit exclusif de certains (hommes, firmes, organismes) dont les réalisations n’ont jamais été sérieusement contrôlées ;
– elle est cohérente avec la position assez coutumière dans notre pays selon laquelle est donnée la priorité au court terme, afin de créer vite l’instrument jugé indispensable (créations de la cII, de la SPERAC, de l’IRIA) ;
– la première conséquence est que la cII a atteint en dix mois des effectifs sans commune mesure avec sa capacité réelle : – de promouvoir des innovations et des produits compétitifs, – de dominer les applications du domaine de la gestion, – de produire même des produits sous licence, et elle apparaît être inorganisée, les divers rouages qui définissent sa structure ne pouvant pas fonctionner en raison de fautes nombreuses ;
– la seconde conséquence est que les efforts de recherches qui hors d’une voie de suiveur étaient engagés il y a deux ans, ont été anéantis et que les résultats des recherches accomplies par la cII depuis sa création sont voisins de zéro. Il n’est pas exagéré de dire, dans ces conditions, que l’informatique est dans une situation plus mauvaise deux ans après la décision du Plan Calcul qu’elle ne l’était au début ; elle a perdu sa mobilité, l’esprit d’entreprise et la foi, alors que la concurrence étrangère a continué à progresser et aura augmenté son avance pour affronter les mutations profondes de l’informatique (qui étaient tout aussi évidentes il y a deux ans qu’aujourd’hui). »
Dès 1966, dans une lettre datée du 27 juin, adressée au colonel Auffray de l’entourage du Général de Gaulle à l’Élysée, François Raymond s’indignait déjà de cette gabegie : « Quel f… pays ! En repensant à ma visite au Général, en essayant objectivement de regarder la situation actuelle, je me dis : où est la vérité ? La rapidité d’évolution des sciences et techniques, l’ouverture des marchés internationaux mettent en évidence les maux congénitaux de notre pays. Mais en définitive, rien n’est changé, la France a raté sa destinée au début de l’ère industrielle, elle a raté son industrialisation entre les deux guerres (les meilleurs de ses hommes ayant été tués), elle a raté sa mise en place après 1945. Pays de c… intelligents dans lequel les côteries ont plus de poids que la compétence et l’expérience. (…). A un moment où en définitive je ne sais vraiment pas ce que je ferai et comment je gagnerai ma croûte dans quelques mois, je regrette amèrement de n’être pas parti quand je le pouvais et d’avoir tenté de faire quelque chose pendant bientôt vingt ans pour des prunes. Pour que quelques polytechniciens ou technocrates à l’esprit bien déformé prétendent savoir eux ce qu’il faut faire, qu’ont-ils fait depuis un demi siècle grand Dieu qui soulèverait notre admiration et reconnaissance ? Il en faut de l’énergie pour que quelques signaux émergent du bruit. »
En 1988, Raymond conclut sobrement : « Dans cette affaire, comme dans bien d’autres, avant cette époque comme après, nous avons constaté, la direction de la SEA et moi-même, que très rarement les actes accomplis concrétisent les déclarations et les engagements qui les précédèrent. Mon propos n’est évidemment pas de tenter comprendre pourquoi si souvent, dans notre pays, des accords sont trahis et des promesses sont oubliées ; ce sujet de réflexions relève de la compétence de l’historien et du sociologue. »
- Jacques Vallée raconte cet épisode de sa vie dans la quatrième partie de son journal Science interdite. Journal 1957-1969 (O.P. Editions, Marseille, 1997). Arrivé en France en octobre 1967, il repart aux États-Unis en novembre 1968. Sa visite à l’IRIA de Rocquencourt le décourage de s’y engager. Il accepte un poste à la Shell, rue de Berri. Désireux de faire de la recherche de pointe sur les bases de données il se heurte à l’incompréhension de responsables pour qui la recherche est trop incertaine, trop coûteuse, voire inutile. Il finit par renoncer et accepte un poste à la RCA près de Philadelphie.
Il résume ainsi son expérience du Plan Calcul : « Cet ambitieux projet s’effondra sous la cupidité des industriels des sociétés semi-publiques comme Bull, CGE et Thomson, qui se précipitèrent pour obtenir des subventions dans le cadre du Plan et gaspillèrent des millions de francs dans des projets voués à l’échec, détruisant ou étouffant au passage nombre de petites sociétés d’informatique qui commençaient à faire leur apparition en France. Bull se vit attribuer la plus grosse part du gâteau et se mit à imposer ses ordinateurs français qui étaient purement et simplement basés sur des licences de fabrication de la société américaine Honeywell. » (pp. 422-423).
- Cette liste de cinq universités éclaire le périple d’Aimé Michel aux États-Unis. À Stanford il a été accueilli par Jacques Vallée et à l’Utah State University par son ami le biologiste Frank Salisbury (il en parle dans d’autres chroniques). À la Colorado State University, je suppose qu’il a pu rencontrer le psychologue David Saunders et à la Northwestern (située à Evanston dans la banlieue nord de Chicago), l’astronome Allen Hynek. Quant à l’université de Chicago, j’ignore à qui il a pu y rendre visite, peut-être Fred Beckman, un spécialiste de l’électro-encéphalographie. Point commun de tous ces chercheurs : leur intérêt pour le problème des ovnis.
- Aimé Michel est revenu plusieurs fois sur ce point, notamment dans la chronique n° 208, La bousculade américaine (La source révolutionnaire de ce temps, c’est l’Amérique), parue ici le 05.12.11.