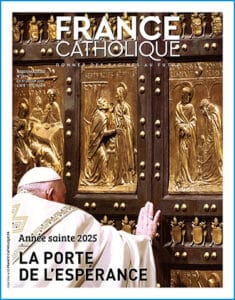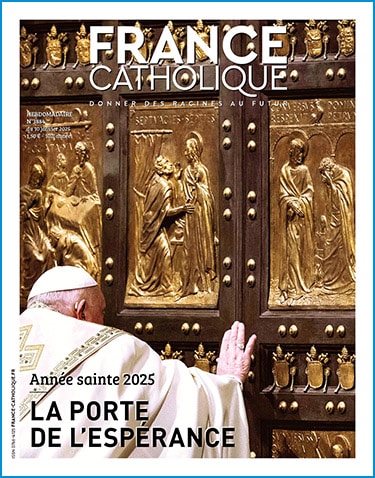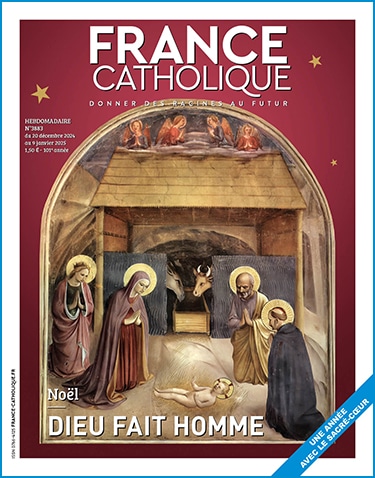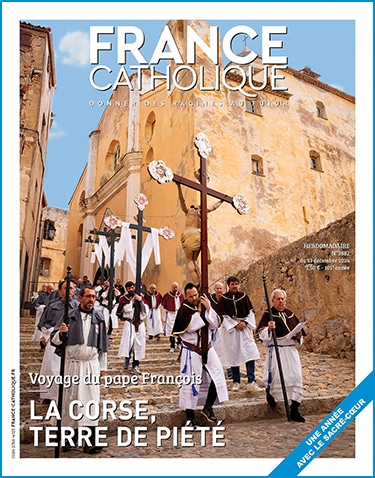− Du grec ? me dit ce directeur d’établissement, vous voulez rire ! du grec dans mon école ? et pourquoi faire ? Même le latin est condamné, et personne ne le regrettera. Le grec, le latin, c’est du passéisme ! Il faut être avec son siècle !
Soyons de notre siècle. Quelles sont les universités les plus prestigieuses du monde, les plus enfoncées dans le futur ? Je ne sais. Mais voici quelques faits, tels qu’ils ressortent d’une enquête toute récente publiée par le New York Times : à Harvard, à Berkeley, à Princeton, à Stanford, partout en Amérique, les études de latin et de grec, après avoir presque disparu au cours des années 60, font maintenant un « boom » extraordinaire. A Princeton, les inscriptions de grec ont triplé depuis 1971. A l’Université du Missouri, elles ont quadruplé. A l’Université du Texas (eh oui, le Texas des cow boys, Monsieur le Directeur !), on enregistre cette année 1 536 étudiants de latin et de grec. Il y a trois ans, on n’en comptait plus que quelques-uns.
Homère sous le bras
Pourquoi ce « boom » ? L’enquête du NYT montre que les étudiants sont « complètement revenus des cours à orientation sociale » (= politique) qui avaient tant de succès pendant les années 60. Ils trouvent dans la culture antique une stimulation aux interrogations fondamentales. Cette culture « nous fournit précisément ce qui nous manquait », disent-ils.
Précision hautement intéressante : la presque totalité de ces étudiants n’ont nullement l’intention de devenir des hellénistes ou des latinistes professionnels, ils font en même temps d’autres études, sciences, médecine, droit, ou bien se préparent à les faire. Simplement, ils veulent, avant leur vie professionnelle, préparer leur vie intellectuelle et spirituelle : « Je veux pouvoir lire Aristote, Platon, Euripide, Cicéron. » C’est moins la philologie que la traduction, la lecture, la méditation que goûtent ces étudiants.
Sont-ils « passéistes » ?
Que mon directeur en décide. Je me borne à l’informer que beaucoup de ces jeunes savants et ingénieurs américains que les Russes espèrent voir venir bientôt mettre la Sibérie en valeur y arriveront avec un Aristote ou un Homère sous le bras, convaincus, nous dit le NY Times, d’y trouver une plus convaincante expression des « valeurs éternelles » que chez les délétères prophètes des années 60. « Ce regain correspond à l’évolution des idées, dit le Pr Robert Connor, de Princeton : les étudiants sont à la recherche de ce qui développe les valeurs personnelles. » Et le Pr Alan L. Boegehold, de l’Université Brown : « Jadis, nous avions surtout des joueurs de football et des snobs ; maintenant, nous avons des étudiants qui aiment ça. »
Pourquoi parler dans une chronique scientifique du regain des études classiques chez les jeunes Américains ? Oh, pour une foule de raisons. D’abord parce que, comme nous le disait l’autre semaine Jacques Vallée 1 , la science sans motivation est en train de disparaître ; la recherche est de plus en plus programmée 2 ; sans doute la découverte résulte-t-elle et résultera-t-elle toujours de la rencontre du hasard, de la persévérance et du génie, mais le champ de son éclosion sera de plus en plus déterminé par les préoccupations collectives, conscientes ou non des chercheurs. 3, 4
Globalement, il ne fait donc aucun doute que des savants nourris d’humanités n’auront pas exactement les mêmes curiosités que leurs aînés, soucieux d’abord, depuis la Renaissance, de libérer leur démarche de la théologie, puis de la métaphysique et de la philosophie.
On observe dès maintenant cette divergence dans certains domaines, et surtout en biologie avec ce que l’on appelle parfois la « bataille du réductionnisme ». La vie, la pensée, les comportements supérieurs peuvent-ils s’expliquer entièrement par le jeu aveugle de la physique ? Les activités supérieures de la vie peuvent-elles être « réduites » à la combinaison des activités élémentaires ? Selon la réponse plus ou moins instinctive que l’on se fera d’abord, il est évident que l’on se mettra en chasse de phénomènes bien différents : les physiciens anglais qui étudient actuellement Uri Geller (a) 5 se forment une idée implicite des choses totalement différente de celle de Monod, par exemple, ou de celle d’Antoine Danchin, autre biologiste, auteur d’un modèle destiné à expliquer l’apprentissage, la mémoire, « et sans doute, dit-il, les propriétés les plus évoluées du système nerveux central des vertébrés supérieurs » (b).
Bien entendu, une découverte est une découverte, quelle que soit la théorie qui y conduit. Mais le corpus des connaissances scientifiques aurait en 1974 un contenu bien différent si depuis Galilée on avait cherché dans des directions autrement orientées.
On saurait des choses que l’on ignore encore, on en ignorerait d’autres qu’on a découvertes. Et le monde technologique où nous vivons serait bien différent.
Un virage historique
Exemple, les sciences humaines (j’entends les vraies sciences humaines, celles qui procèdent par expérimentation et numération) : la presque totalité des expériences de psychologie auraient pu être faites dès le XVIIe siècle ; on n’y a pensé que trois siècles plus tard : Pourquoi ?
Quand on rêve − et c’est un rêve plausible − à ce qu’auraient pu donner trois cents ans de recherche psychologique, on est pris de vertige ! Que serait notre société dotée de trois siècles de connaissances sur l’homme ? La réponse à cette question défie l’imagination 6.
Si le retour au classicisme se confirme, il annonce donc un virage historique aux conséquences imprévisibles. Reste à savoir si ce retour vient des profondeurs, ou si c’est une mode passagère.
Aimé MICHEL
(a) Geller est ce phénomène (disent les uns), cet imposteur (disent les autres), qui, réellement ou par prestidigitation, agit à distance sur les objets, cassant par exemple un couteau enfermé dans une boîte de verre sous les yeux des spectateurs, et même de la caméra.
(b) A. Danchin : l’Inné et l’Acquis, une théorie sélective de l’apprentissage, in : Recherche, 42, février 1974, p. 184 ; voir aussi : J.-P. Changeux, P. Courrège, A. Danchin : Proceedings de la National Academy of Sciences, 70, 2974, 1973.
Les Notes de (1) à (6) sont de Jean-Pierre Rospars
(*) Chronique n° 179 parue dans France Catholique-Ecclesia − N° 1 424 − 29 Mars 1974.
- Aimé Michel avait réuni dans les locaux de France Catholique plusieurs des collaborateurs du journal autour de Jacques Vallée lors d’un séjour parisien de ce dernier en décembre 1973. Il en était résulté deux longs comptes-rendus réalisés par Jean-Pierre Maurel : A l’Institut pour le futur : l’appareil Forum peut-il changer les rapports humains ? Une table ronde autour de Jacques Vallée de l’Institut du futur dans F.C.-E. n° 1418 du 18 février 1974. Puis : La recherche pour le futur : La personne humaine en ordinateur, F.C.-E. n° 1419 du 22 février 1974. Sur Vallée voir aussi la note 4 de la chronique n° 104, Software et politique, d’août 1972 (parue ici le 1.6.2010) et la note 576, p. 494, de La clarté au cœur du labyrinthe.
- Cette « programmation » est telle aujourd’hui qu’elle menace le développement de la science, comme l’explique fort bien le généticien Laurent Ségalat du CNRS dans La science à bout de souffle ? (Seuil, Paris, 2009). Aujourd’hui un chercheur pour pouvoir travailler doit obtenir des subventions en répondant aux appels d’offre ouverts par les grandes agences de financement. C’est là son souci majeur. « Le système dans lequel il évolue tend à le faire ressembler au gérant de supérette plus qu’au savant échevelé perdu dans ses pensées. ». « Mais l’aspect le plus surréaliste de cette dérive technico-administrative, c’est que, pour obtenir une subvention, il faut dire à l’avance ce que l’on va trouver. Les formulaires de demandes de subvention comportent désormais une partie intitulée “Résultats attendusˮ, “Milestonesˮ [jalons], ou “Deliverablesˮ [livrables], dans laquelle il faut décrire en termes précis les résultats que l’on va obtenir dans deux, trois ou cinq ans. Dans le guide de rédaction 2007 des projets soumis à l’ANR, à la page “Critère d’évaluation des projetsˮ, on trouve parmi les critères énoncés : “Rigueur de définition des résultats finauxˮ. (…) Et il ne s’agit pas d’un mal spécifiquement français. La plupart des pays industrialisés ont adopté cette gestion planifiée de la recherche. Monsieur Einstein, pouvez-vous nous livrer une théorie de la relativité pour dans trois ans ? Monsieur Fleming, découvrez les antibiotiques avant la fin de votre subvention, sinon il faudra rembourser. Priez pour les chercheurs ! Bienvenue à l’ère des managers ! » (pp. 21-23).
- Voici le plaidoyer de J.-P. Dupuy en faveur des études classiques, La Marque du sacré, Carnets Nord, Paris, pp. 60-64 : « L’inculture générale et l’incapacité de la science et de la technique à faire culture sont les deux aspects d’un même phénomène. On ne comprendrait rien à celle-là, me semble-t-il, si l’on restait aveugle à celle-ci. (…) Face aux immenses défis et aux menaces qui pèsent sur l’avenir de l’humanité, seule une culture générale accessible à tous peut nous sauver, à condition que la culture scientifique et technique en fasse partie intégrante, ce qui implique qu’il existe une culture scientifique et technique, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
» Pourquoi l’honnête homme du XXIe siècle ne peut-il se permettre de ne pas accéder à la culture scientifique et technique ? Je veux répondre en prenant les questions à la racine. La culture générale ne serait que le décorum vain de la décence bourgeoise si elle n’était avant tout éducation des hommes, de tous les hommes, à la liberté. La liberté de parole et la faculté d’agir sont nos biens les plus précieux. Elles sont aussi la cause de nos maux les plus redoutables. (…) [L’]action (…), désormais, s’exerce sur et dans la nature elle-même er non plus seulement dans la cité humaine. (…) Le bon intellectuel hexagonal est heureux d’étaler son ignorance dans les domaines où désormais l’action s’exerce en priorité. Toutes les questions qui font aujourd’hui les gros titres du débat intellectuel et politique doivent être posées et traitées à nouveaux frais, dans le cadre d’une philosophie morale et politique qui donne à la nature et à la technique une place centrale. (…)
» Pourquoi, de leur côté, les scientifiques, les technocrates et les ingénieurs sont-ils des dangers publics s’ils ne possèdent pas une forte culture générale ? Je m’intéresse aux catastrophes à venir qui mettent en péril la continuation même de l’aventure humaine. (…) [N]ous ne croyons pas à la catastrophe alors même que nous la voyons devant nous. Car si l’avenir n’est pas réel, la catastrophe future ne l’est pas davantage. Croyant que nous pouvons l’éviter, nous ne croyons pas qu’elle nous menace. C’est ce sophisme que j’ai tenté de briser avec la méthode du “catastrophisme éclairéˮ. Le catastrophisme éclairé est une ruse qui consiste à faire comme si nous étions la victime d’un destin tout en gardant à l’esprit que nous sommes la cause unique de ce qui nous arrive. (…) Or cette ruse, ce double jeu, la pratique de la fiction littéraire nous amène à y avoir recours le plus naturellement du monde. Lorsque nous sommes pris dans une fiction, une partie de nous sait pertinemment que l’auteur était complètement libre de clore son récit selon son bon vouloir. Et, cependant, nous vivons le déroulement des évènements comme s’il était dicté par une nécessité implacable qui s’imposait à l’auteur lui-même. (…) Tant dans l’esthétique d’Aristote que dans celle de Hegel, la catastrophe est le dénouement tragique d’une pièce, qui clôt le temps d’un développement inexorable tout en lui donnant rétrospectivement un sens. C’est cette clôture du temps que le catastrophisme éclairé invite à penser à propos de l’histoire humaine. La compétence requise est bien celle de faire et de comprendre des récits et rien mieux qu’une formation littéraire classique ne peut permettre de l’acquérir. Penser ce que nous faisons, c’est aujourd’hui penser notre action technique sur le monde et sur nous-mêmes, et cela requiert une capacité narrative que les humanités aident à développer. Je voudrais que chaque ingénieur, technocrate ou chef d’entreprise pût chaque semaine lire au moins un roman et voir un film.» Il faudrait donc que les hommes de science soient des hommes de culture et que les hommes de culture aient accès à la science au moyen de la culture ; qu’il n’y ait, selon le mot de Michel Serres, ni savants incultes, ni cultivés ignorants. »
On trouve un même constat chez l’écrivain britanniques C.S. Lewis, qui lui aussi s’inquiétait de l’avenir de la civilisation occidentale. Suzanne Bray, dans C.S. Lewis ou la vocation du best-seller (p. 118), présente ainsi l’opinion de l’écrivain : « l’homme moderne n’est pas seulement étranger à la tradition littéraire du passé par son manque de foi vivante, mais aussi par son ignorance de l’histoire et par la disparition de l’éducation classique. Il [Lewis] remarque que de plus en plus de personnes ne lisent que des livres qui viennent de paraître et, donc, n’ont aucune connaissance de la tradition intellectuelle européenne, ce qui était jusqu’à une époque assez récente l’héritage de tout lettré. En 1921, le théologien Charles Gore se lamenta sur l’habitude de ses contemporains “de lire uniquement des livres de [leur] époque”. Lewis accepta l’avis de Gore et expliqua que les livres du passé donnaient au lecteur les outils nécessaires à une analyse pertinente de ceux qui venaient de paraître. (…) De plus, Lewis estimait si peu la sagesse de son époque qu’il craignait que ceux qui ne lisaient que leurs contemporains n’attrapent une espèce de maladie intellectuelle. Pour lui, la seule façon d’éviter cette infection était “de faire en sorte que la saine brise de l’océan des siècles continue à souffler à travers nos esprits”, en lisant de vieux livres. Lewis compare la perte de culture générale de son siècle à celle des temps barbares (…), bien qu’il estime la dégénérescence de son époque plus profonde que celle de l’époque de Boèce : “Nous avons vu pour la deuxième fois la mort de l’éducation classique. De nos jours, les connaissances qui étaient auparavant l’héritage de tout homme cultivé ne sont plus que la spécialisation d’une poignée d’érudits […]. Si l’on se mettait en quête d’un homme qui, à l’opposé de son propre père, ne sait pas lire les œuvres de Virgile dans le texte, il serait plus facile d’en trouver au XXe siècle qu’au Ve.” »
- On trouve un plaidoyer semblable chez le généticien Laurent Ségalat du CNRS (op. cit., pp. 27-28) :
« [L]a réflexion scientifique a de moins en moins d’importance, et cède la place à la gestion. Comme l’a décrit Bruno Latour [Petites Leçons de sociologie des sciences, La Découverte, 1993], le chercheur moderne peut être vu comme le gérant d’un capital qu’il fait fructifier en transformant régulièrement des articles en subventions, et des subventions en articles.
» Les chercheurs sont dans la course parce qu’ils n’ont pas le choix. Mais ils s’y engagent d’autant plus facilement que le but final leur échappe de plus en plus. Combien de chercheurs peuvent, aujourd’hui, dire en quelques phrases avec clarté et certitude quel est le but de la science, leur but ? Car le sens global de celle-ci s’éloigne mécaniquement au fur et à mesure qu’ils sont happés par leur combat dans l’arène. Par la confusion de la fin et des moyens propres à l’époque, mais aussi par l’absence de repères historiques dans leur formation. L’histoire des sciences n’est plus enseignée dans les filières scientifiques. Or on est toujours le fruit de l’histoire. Savoir d’où l’on vient aide à voir où l’on va.Il n’est pas indispensable de savoir situer Aristote, Gutenberg ou Ramsès II pour être un bon chercheur. Mais cela aide à garder le nord. Dans la tradition européenne, le chercheur est un descendant de l’honnête homme. Or, la disjonction entre science et culture humaniste est en train de se creuser. Elle est particulièrement palpable outre-Atlantique, où il n’est pas rare de rencontrer des chercheurs auréolés de prix prestigieux, mais notablement dépourvus de culture générale. Cela confirme que la science s’est transformée en ce que certains nomment “technoscienceˮ, à savoir ingénierie scientifique plus qu’exploration.
- Uri Geller, né en 1946 à Tel Aviv de parents Hongrois, s’est rendu célèbre dans les années 70 par ses dons paranormaux allégués, comme la capacité de tordre des objets sans contact (psychokinèse) et de deviner les pensées d’autrui (télépathie). Sa carrière se poursuit depuis lors et ses apparitions sur les télévisions de nombreux pays du monde lui ont assuré la gloire et la fortune. En France il participa à plusieurs émissions très remarquées, dont Droit de réponse de Michel Polac en 1987. Ses démonstrations sont tenues par les sceptiques pour des tours de prestidigitation et ont été reproduites par des magiciens comme Gérard Majax en France et James Randi aux États-Unis. Au contraire, les physiciens Russell Targ et Harold Puthoff du Stanford Research Institute ont conclu que ses dons paranormaux étaient réels (Nature, vol. 251, pp. 602–607 du 18 octobre 1974) mais les sceptiques estiment qu’ils ont été trompés.
Cependant, en 1974, aux États-Unis également, Geller fut mis à l’épreuve par plusieurs magiciens professionnels. Il parvint à les impressionner par plusieurs résultats positifs qu’ils ne purent attribuer à une fraude. Par exemple, William E. Cox, l’organisateur du comité, tint une solide clé avec un doigt sur une table et l’observa alors qu’elle était en train de se tordre. Il ne put constater aucune tricherie. Pour lui, les prestidigitateurs peuvent, certes, produire les résultats de Geller mais pas dans les conditions qui lui furent quelquefois imposées.
- Toujours cette idée que l’histoire aurait pu prendre un autre cours… Cette idée est présente dans bon nombre de ces chroniques. Dans le cas présent Aimé Michel pense notamment aux ressources de l’inconscient, non celui de Freud mais celui de Myers, source de la création et de facultés dites « paranormales » (voir la chronique n° 23, La psychanalyse : connaissance ou chimère ?, parue ici le 7.12 .2009, en particulier les notes g et h, et la chronique n° 101, Entre Hegel et Groucho Marx, sur la parapsychologie, parue ici le 14.6.2010).