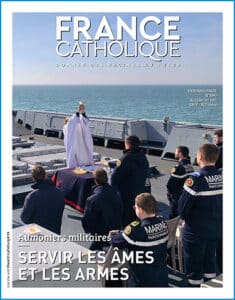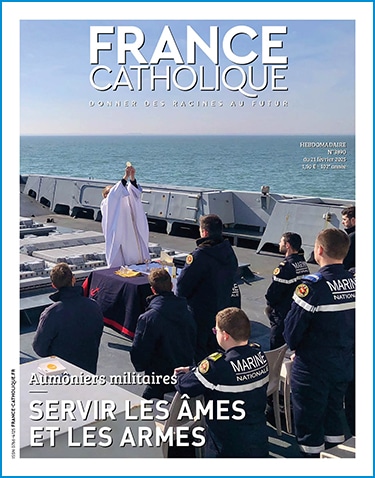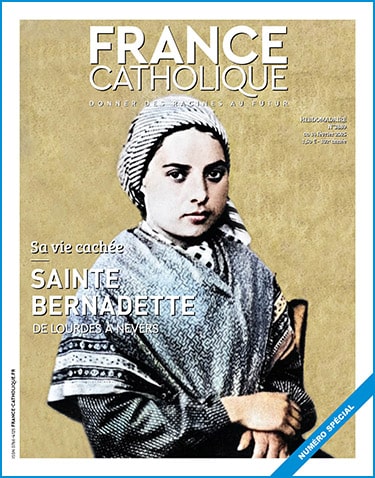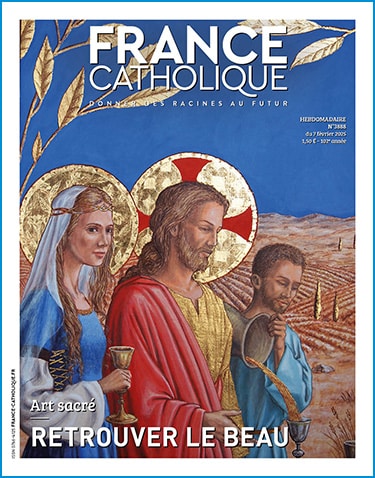Une des théories les plus intéressantes, et peut-être les plus prometteuses, actuellement avancées pour expliquer l’affrontement de l’ange et de la bête dans le cœur de l’homme1 fait appel à l’architecture physiologique du cerveau.
Du point de vue de l’anatomie et de l’histoire, cette théorie n’en est pas une : c’est une pure et simple constatation. Il est exact et démontré par l’expérience que deux types de cerveaux coexistent dans notre boîte crânienne, dont l’un est déjà présent chez les reptiles, bien avant l’apparition des premiers mammifères. C’est, selon l’expression du professeur Debray (a), « notre plus ancienne province ». Cette antique part de nous-mêmes, écrit encore Debray, « est formée chez l’homme de la substance réticulée du tronc cérébral, de l’hypothalamus et des parties archicorticales du cortex fronto-temporal ».
L’autre partie du cerveau s’est développée au-dessus du premier à partir des reptiles, chez les oiseaux et surtout chez les mammifères, pour donner le néo-cortex qui culmine chez l’homme et où s’opèrent toutes les activités supérieures de ce que l’on appelle la pensée2.
L’essentiel hors de portée
Précisons bien trois points essentiels :
D’abord, le fait que les activités supérieures de la pensée aient pour instrument le néo-cortex ne nous apprend rien sur la nature réelle de la pensée consciente et inconsciente. La pensée vécue, telle que nous l’éprouvons subjectivement, est un mystère total pour la science, qui non seulement ne l’explique pas, mais qui est impuissante par essence à en parler. La science n’a accès qu’aux phénomènes, c’est-à-dire à ce que nous apprennent les organes des sens. Elle est, selon un mot du P. Dubarle que j’ai eu déjà l’occasion de citer, « matérialiste dans sa démarche »3.
Si la psychologie est une science, c’est qu’elle se borne à étudier les comportements et toutes les autres corrélations matérielles de l’inaccessible pensée vécue. Dès qu’elle excède cette ambition, elle cesse d’être une science4.
Le deuxième point découle du premier : la science n’atteint pas l’essentiel de l’homme, car l’homme sans sa pensée n’est qu’un cadavre. Les plus hautes activités de l’homme se situent au-delà de la science : ni l’adoration, ni l’amour, ni la conscience, ni la douleur n’appartiennent au champ de la science. Ni l’ardeur qui, comme dit Pascal, « cherche en gémissant », et qui inspire la méditation philosophique – la vraie, celle qui s’interroge sur notre nature et notre destinée, – ou encore, comme dit Popper, qui parle de ce qu’elle ignore : car, dit-il encore, c’est de ce qu’on ignore qu’il faut parler5 ; sinon, à quoi nous sert notre pensée ? Et comment progresserions-nous dans l’inconnu ?
Le troisième point concerne l’existence en nous de ce cerveau animal : n’allons pas commettre l’erreur de la croire hypothétique comme les diverses théories de l’évolution ; elle est un fait anatomique. C’est en expérimentant sur le cerveau du chat, du lapin, du cobaye et d’autres animaux que Magoun, Bard, Dempsey, Clark et cent autres (parmi lesquels les Français Michel Jouvet, de Lyon, et Henri Gastaut, de Marseille, occupent une place éminente6) ont découvert et continuent de découvrir peu à peu les mécanismes du cerveau humain.
Nous avons véritablement en nous le cerveau des vertébrés moins évolués que nous. Plus quelque chose que leur cerveau n’a pas. Comme le dit Koestler (que cite justement à ce propos Debray) : « Ce n’est pas la faute des astres, cher Brutus, c’est celle du crocodile et du cheval qui s’agitent dans nos cerveaux. De tous ses traits spécifiques, c’est bien là celui qui rend l’homme extraordinaire. » L’homme cumule en quelque sorte dans son crâne toute l’animalité. Le cochon ne sommeille nullement en lui : il y vit.
Du tableau anatomique dressé par Debray, ne retenons que l’hypothalamus, comme exemple d’un organe que nous avons en commun avec, disons, le chat.
Quand on examine ses fonctions actuellement connues, on en trouve un certain nombre qui échappent à notre vie consciente. Par exemple, la régulation thermique, celle de la soif et de la faim, les phénomènes cardio-vasculaires, le sommeil, etc. (b). Mais on en trouve d’autres qui sont au cœur même de notre aventure terrestre, et d’abord de nos émotions. Par exemple, l’amine biogène appelée norépinephrine7, qui est présente en diverses parties du cerveau, trouve sa plus haute concentration dans l’hypothalamus.
De nombreuses expériences ont montré que l’on peut induire une sorte d’anxiété artificielle, sans objet, en injectant de la norépinephrine dans le sang (c). En implantant des électrodes dans les portions latérales et caudales de l’hypothalamus du chat et d’autres animaux, W. R. Hess et d’autres ont pu provoquer des comportements de menace, de colère, de combat, de fuite, de frayeur. Enfin les expériences montrant une étroite relation entre l’activité de l’hypothalamus et les comportements sexuels sont innombrables.
Bornons-nous aux effets que je viens de citer, anxiété, peur, colère, menace, attaque, fuite, sexe : n’avons-nous pas nommé quelque 80% des thèmes de la littérature universelle ? Or l’hypothalamus y joue un rôle essentiel, et nous l’avons en commun avec les vertébrés supérieurs.
Et attention ! Là encore, n’allons pas nous imaginer que la neurophysiologie ne fait que confirmer des analogies connues depuis toujours par la sagesse des nations (que l’homme en colère est une bête, etc.). Elle les confirme, certes, mais elle va beaucoup plus loin : elle atteste la réelle présence de l’animal en nous. Les amines biogènes, dont la libération dans l’hypothalamus transmet l’influx nerveux et déclenche telle ou telle réaction, sont les mêmes corps chimiques chez l’animal et chez l’homme. On peut, dans l’expérimentation, les utiliser indifféremment chez le chien et chez l’homme.
Voilà pour « la bête ». L’ange, s’il existe en nous, est inaccessible à la science. Mais l’homme ?
L’homme, du point de vue physiologique, siège dans les parties les plus évoluées du néo-cortex, c’est-à-dire dans les lobes dont le développement particulier n’appartient qu’à nous. En gros, c’est la partie du cerveau qui gonfle la courbure de notre front et l’avant du crâne.
Et c’est ici qu’intervient la théorie neurophysiologique de « l’ange et de la bête ».
Plusieurs auteurs (A. T. W. Simeons, P. Mac Lean, etc.) estiment que le drame de notre condition s’exprime au niveau physiologique par un conflit entre les deux cerveaux. C’est Simeons (d), qui a exprimé avec le plus d’audace cette vue. Selon lui, l’évolution culturelle de l’Homo sapiens a été trop rapide. La culture a précédé l’anatomie, c’est-à-dire que l’invention humaine a mis trop vite notre espèce à l’abri des nécessaires épreuves qui eussent pu faire évoluer notre cerveau animal en l’asservissant convenablement au néo-cortex8.
Simeons (qui est mort il y a quelques années à Rome) était un esprit singulier. Selon lui, l’histoire a privilégié le néo-cortex, instrument de la pensée supérieure et de la raison, au détriment du cerveau instinctif. D’où une foule de maladies fonctionnelles imputables, selon lui, à la révolte de celui-ci contre une condition « à laquelle il ne comprend rien ».
L’autre conquête
Cependant, les expériences d’apprentissage donnent tort à cet ingénieux théoricien. Les savants qui s’en tiennent aux faits, comme MacLean ou Debray, se bornent à souligner la complexité de notre physiologie cérébrale et la dualité réelle de notre nature.
Il y aurait d’autre part à dire, et immensément, sur l’équilibre psychique et physique qui s’atteint à travers l’ascèse. Or, l’ascèse réalise cet asservissement du cerveau ancien que récuse Simeons. L’utilisation correcte de notre cerveau résulte donc d’une conquête du corps par la pensée. Mais ceci est une autre histoire9.
Aimé MICHEL
(a) Pierre Debray-Ritzen : La Scolastique freudienne (Fayard, 1972), p. 49 et suivantes.
(b) L’hypothalamus joue un rôle essentiel dans ces fonctions, mais d’autres organes aussi. Le cerveau est un tout, et il est en prise sur le corps tout entier.
(c) Bibliographie de ces expériences dans : J. J. Schildkrant et S. S. Rety : Biogenic Amines and Emotions (Science, 156, 1967, p. 21).
(d) A. T. W. Simeons : La Psychosomatique (Marabout, 1969).
Chronique n° 142 parue dans F.C. – N ° 1377 – 4 mai 1973. Reproduite dans La clarté au cœur du labyrinthe, Aldane, Cointrin, 2008 (www.aldane.com), pp. 253-256.
Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 1er avril 2013
- On aura reconnu l’allusion à Pascal, fréquente chez Aimé Michel.
- Aimé Michel parle seulement de deux cerveaux, de même que Jean Fourastié qui oppose souvent le paléocéphale, siège des instincts, au néocéphale, siège de la pensée rationnelle. Toutefois, selon la thèse originelle il y en aurait trois. Cette thèse a été défendue et popularisée en particulier par Paul MacLean sous le nom de cerveau « tri-un » ou « tri-unique » pour signifier à la fois sa division en trois parties et son unité fondamentale. MacLean distingue le cerveau reptilien (tronc cérébral), mammalien ancien (système limbique) et mammalien récent ou humain (néocortex). Voici la description pittoresque qu’il en donne : « L’homme se trouve dans la situation embarrassante d’avoir reçu essentiellement de la nature trois cerveaux qui, malgré de grandes différences de structure, doivent communiquer et fonctionner ensemble. Le plus ancien de ces cerveaux est fondamentalement reptilien. Le second est hérité des mammifères inférieurs, le troisième s’étant développé récemment chez les mammifères… a rendu l’homme singulièrement homme. Pour parler allégoriquement de ces trois cerveaux dans le cerveau on peut imaginer que le psychiatre qui fait étendre son patient lui demande de partager le divan avec un cheval et un crocodile. » (J. of Nervous and Mental Disease, 135 n° 4, 1962 ; cité par Koestler, La quête de l’absolu, Calmann-Lévy, Paris, 1981, p. 487 qui note que ce pittoresque est “assez insolite dans un article scientifique”).
Le tronc cérébral est responsable du tonus musculaire, de la vigilance, de la motricité oculaire. C’est là que se trouvent certains des centres impliqués dans le sommeil et le rêve (voir en note 6 les chroniques relatives aux travaux sur le rêve).
Le système limbique (du mot latin limbus qui signifie bord) fait suite au tronc cérébral. Il intervient dans les comportements liés aux besoins fondamentaux de l’organisme ou de l’espèce : besoins de nourriture ou d’eau, comportements sexuels et maternels. Il analyse les différences entre les résultats attendus et effectivement obtenus lors d’une action en tant que succès ou échec ; il utilise ensuite cette expérience passée pour renforcer ou éteindre certaines réponses (une partie de ce système, l’hippocampe joue un grand rôle dans cette mémorisation). La fonction majeure du système limbique est la genèse des émotions grâce auxquelles une tonalité affective (peur, plaisir) se trouve associée à différents signaux.
Le néocortex est la partie la plus antérieure du cerveau. Il reçoit les informations provenant des organes des sens (à l’exception de l’olfaction qui arrive dans le système limbique) et est le point de départ des commandes motrices. Surtout il associe les aires sensorielles aux aires motrices. Plus le cortex « associatif » est grand et plus s’affinent les capacités d’analyse et de prise de décision. Chez l’homme c’est le siège de la pensée rationnelle.
La thèse des trois cerveaux en un de MacLean n’est pas dépourvue de valeur à condition d’éviter deux écueils :
Il ne faut évidemment pas en déduire que le cerveau du reptile se réduit au tronc cérébral (prolongement céphalique de la moelle épinière) ou que le cerveau de mammifère ne possède pas de néocortex. En réalité le néocortex apparaît chez certains reptiles et prend une extension considérable chez les mammifères au point qu’on ne voit presque plus que lui sur une vue externe du cerveau humain. Simplement, en dépit de cette extension considérable des parties antérieures du cerveau au cours de l’évolution des vertébrés (partant des poissons, elle mène aux amphibiens puis aux reptiles et enfin aux mammifères), certaines parties ont été peu modifiées d’une étape à la suivante. C’est pour cette raison qu’on peut dire que le tronc cérébral d’un homme est peu différent de celui d’un reptile, ou son système limbique peu différent de celui d’un autre mammifère.
Il ne faut pas déséquilibrer les deux termes de l’« équation » et donner trop d’importance au « trois » par rapport au « un ». En particulier il ne faut pas croire que raison et émotions sont antinomiques. Le neurologue américain Antonio Damasio a consacré à ce sujet un livre qui a connu un grand succès, L’erreur de Descartes. La raison des émotions (trad. par Marcel Blanc, Odile Jacob, Paris, 1995). Il y montre, en se fondant notamment sur des patients au cerveau lésé, qu’il ne peut y avoir de raisonnement correct en l’absence de capacité à ressentir et exprimer des émotions, et ceci « pour le meilleur et pour le pire ».
- Effectivement Aimé Michel rappelle souvent cette formule clé du R.P. Dubarle, « La science est matérialiste par méthode », notamment dans les chroniques n° 13, La physique en panne (12.10.2000, voir en dernière note une citation complémentaire de Richard Lewontin), n° 51, la science au cou raide (29.10.2012), n° 126, Avis désintéressé à MM. les assassins – les hypothèses les plus certaines ne sont pas de nature scientifique (04.06.2012), et n° 168, La singularité de l’homme – de Jacqueline de Romilly à l’irrationnel dans la nature (10.01.2011). Le R.P. André-Marie Dubarle (1910-2002) était professeur d’exégèse biblique au couvent dominicain du Saulchoir de Paris.
- D’où la forte tentation de passer du matérialisme méthodologique au matérialisme philosophique. Ce pas est allègrement franchi par le philosophe Daniel Dennett dans La conscience expliquée (traduction de Pascal Engel, Odile Jacob, 1993). « La sagesse dominante, écrit-il, (…) est le matérialisme : il n’y a qu’une seule sorte de substance dont les choses sont faites – à savoir la matière, la substance physique de la physique, de la chimie et de la physiologie – et l’esprit n’est en un sens rien d’autre qu’un phénomène physique. En bref l’esprit est le cerveau. Selon les matérialistes, nous pouvons (en principe !) expliquer tous les phénomènes mentaux en utilisant les mêmes principes physiques, les mêmes lois et les mêmes matériaux bruts que ceux qui sont suffisants pour expliquer la radioactivité, la dérive des continents, la photosynthèse, la reproduction, la nutrition et la croissance. Ce livre a précisément pour objectif principal d’expliquer la nature de la conscience sans jamais céder au chant des sirènes dualistes. » (p. 50). Ce chant des sirènes fait cependant l’objet d’une défense « savante » par un autre philosophe, David Chalmers . Nous en reparlerons une autre fois.
- La science en tant que savoir à défendre contre la science en tant qu’ignorance à vaincre.
- Sur Michel Jouvet voir la série des chroniques n° 71 et 73 à 76 sur la science des rêves (mises en ligne du 28.03.2011 au 26.04.2011 puis le 24.08.2011). Sur Henri Gastaut (1915-1995) voir la chronique n° 153, Un substitut de la contemplation – Electroencéphalographie et mysticisme (mise en ligne le 06.06.2011). Jouvet vient d’écrire son autobiographie De la science et des rêves. Mémoires d’un onirologue (Odile Jacob, Paris, 2013).
- La norépinéphrine est plus communément appelée noradrénaline en français. C’est une petite molécule à 8 atomes de carbone proche de la dopamine (dont elle dérive par l’ajout d’un groupe OH) et de l’adrénaline (qui en dérive par addition d’un groupe CH3). On désigne collectivement ces trois molécules sous le nom de catécholamines. Une autre amine biogène importante est la sérotonine.
L’adrénaline est une hormone secrétée par la glande médullo-surrénale tandis que la dopamine et la noradrénaline sont des neuromédiateurs libérés par les terminaisons synaptiques des neurones, tout comme l’acétylcholine. La théorie selon laquelle l’influx nerveux (ou potentiel d’action) conduit au long de l’axone jusqu’aux terminaisons synaptiques provoque dans celles-ci la libération d’un neuromédiateur mit fort longtemps à s’imposer. Cette théorie fut consacrée par l’attribution du prix Nobel à Otto Loewi (1873-1961) et Henry Dale (19875-1968) en 1936. Malgré tout John Eccles s’y opposa longtemps, forçant les partisans de la transmission chimique à affuter leurs arguments. Il défendait une théorie électrique de la transmission synaptique qu’il n’abandonna qu’en 1949.
Jusqu’en 1939 tous les travaux ayant permis la démonstration de l’existence des neuromédiateurs furent faits sur des organes périphériques parce qu’on pouvait les isoler, stimuler leurs neurones avec précision, voir l’effet produit (excitation du neurone suivant, contraction d’une fibre musculaire ou sécrétion d’une cellule glandulaire), analyser le sang artériel entrant et le sang veineux sortant. Rien de tel n’était possible dans le système nerveux central, cerveau et moelle épinière, ce qui explique que la recherche des neuromédiateurs dans les synapses centrales ne commença que pendant la guerre de 1939-1945. Le premier neuromédiateur découvert dans le cerveau fut l’acétylcholine, qui est abondant dans le cortex. Puis, en 1954, M. Vogt montra que la noradrénaline est présente dans l’hypothalamus. Dix ans plus tard, A. Dahlström et K. Fuxe à Stockholm établirent une carte des neurones à noradrénaline du cerveau : leurs corps cellulaires sont dans le tronc cérébral et leurs terminaisons innervent le cervelet, le système limbique et le néocortex.
Aimé Michel résume fort bien l’implication des catécholamines dans la régulation des comportements émotionnels. On admet généralement que la dépression est associée à une déficience en noradrénaline et sérotonine et les manies à leur excès parce que certaines substances qui provoquent une baisse de ces neuromédiateurs, comme la réserpine, peuvent entraîner une sévère dépression, tandis que d’autres qui facilitent leur libération, comme les amphétamines, produisent une exaltation.
- Arthur Koestler a présenté ces idées dans son livre Le cheval dans la locomotive (The Ghost in the Machine, Calmann-Lévy, 1968) et les a reprise dans La quête de l’absolu (Bricks to Babel, trad. G. Fradier et M. Zygband, Calmann-Lévy, 1981). Selon lui, la « désastreuse histoire de notre espèce » révèle plusieurs grands symptôme pathologiques comme : le sacrifice humain (« le meurtre rituel d’enfants, de vierges, de rois et de héros, destiné à flatter ou apaiser des dieux de cauchemar »), le meurtre intraspécifique (alors que chez les autres espèces les conflits se règlent par des menaces symboliques et des combats rituels qui évitent les blessures mortelles), la rupture entre la raison et l’affectivité (« les facultés rationnelles et les croyances émotives irrationnelles »), la disparité entre le progrès des sciences et des techniques d’une part, et de la morale de l’autre.
Koestler propose que ces symptômes interdépendants proviennent « d’un défaut de construction » qui se serait produit au cours de l’évolution dans les relations entre le système limbique et le néocortex. « [T]andis que les structures antédiluviennes au centre du cerveau, qui gouvernent les instincts, les passions, les pulsions biologiques, ont été à peine touchées par l’évolution, le néocortex des hominiens a grossi en cinq cent mille ans à une vitesse fantastique (…). [L]e résultat semble avoir été qu’en se développant avec cette rapidité le cerveau pensant qui donnait à l’homme sa faculté de raisonner n’a pas été intégré ni bien relié aux anciennes structures attachées à l’affectivité auxquelles il s’est trouvé superposé à une vitesse sans précédent. » Il en résulterait « une coordination insuffisante entre cerveau récent et cerveau ancien, et une maîtrise inadéquate du premier sur le second ».
Cependant, à la lueur des explications fournies par Antonio Damasio (voir note 2) il semble bien que ce soit aller un peu vite en besogne que de conclure au « défaut de construction ». Comme l’écrit Damasio : « Il ne s’agit pas de nier que les émotions puissent perturber les processus du raisonnement dans certaines circonstances » mais, inversement, on sait maintenant que « l’incapacité d’exprimer et de ressentir des émotions [est] susceptible d’avoir des conséquences tout aussi graves, dans la mesure où elle peut handicaper la mise en œuvre de cette raison qui (…) nous permet de prendre des décisions en accord avec nos projets personnels, les conventions sociales et les principes moraux. »
D’ailleurs, comme s’il avait prévu une telle objection à cette « schizophysiologie » comme l’appelle MacLean, Koestler avance trois autres explications possibles. La première est la longue période de dépendance totale de l’enfant humain à l’égard de ses parents ; elle fait de lui un récepteur docile aux croyances toutes faites, ce qui lui permettra plus tard de commettre des homicides au nom d’un roi, d’un pays ou d’une cause. La seconde est l’importance du langage dont l’énorme potentiel émotif est capable d’affaiblir les facultés de raisonnement et de renforcer les passions, tandis que l’espèce humaine est éclatée en 3000 groupes linguistiques. La troisième et la découverte de la mort qui a été faite par l’intelligence et refusée par l’affectivité. Incapables de résoudre ce problème, les hommes ont peuplé les airs de présences invisibles (fantômes, dieux, anges, démons), généralement malveillantes et vindicatives qu’il a fallu apaiser. Mais Koestler ne tombe pas dans le simplisme : « Si le mot “mort” n’existait pas dans nos vocabulaires, les grandes œuvres littéraires n’auraient pas été écrites. La créativité et la pathologie humaines sont les deux faces d’une médaille, elles ont été gravées dans le même atelier de l’évolution. » Là encore on est conduit à reconnaître une situation ambivalente qu’on ne peut réduire à un seul de ses aspects, un état de fait qui est « pour le pire et pour le meilleur », indissociablement.
- Sur cette « conquête du corps par la pensée » réalisée dans l’ascèse, voir la chronique n° 147, Ascèse et liberté, que nous mettrons en ligne prochainement.