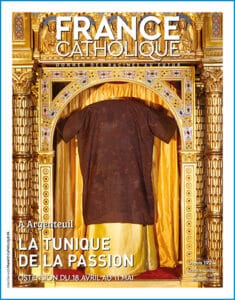Les affrontements qui ont eu lieu lundi soir, place de la République à Paris, reposent une nouvelle fois la question de la violence de l’État afin de défendre l’ordre public. Avant même d’examiner les faits eux-mêmes, qui provoquent des oppositions entre droite et gauche, il n’est pas inutile de revenir à une question de principe. C’est sans doute Max Weber qui l’a définie avec le plus de clarté, en parlant du monopole de la violence physique légitime qui revient à l’État, et à lui seul sur son territoire. Sans ce monopole, le risque est le déchirement du corps social, réglant ses propres conflits avec des factions armées. Ce principe n’est pas accepté partout, du moins avec la même rigueur. Il y a, en effet, l’exemple contraire des États-Unis où la détention des armes par les personnes privées est un droit garanti par le deuxième amendement de la Constitution. On sait les risques de cette disposition.
Mais le monopole de la force armée ne s’exerce pas sans discernement ni mesure, sous peine d’être discrédité. Par ailleurs, il doit s’appliquer souvent dans des situations extrêmement délicates, qui réclament des compétences très particulières. On a reproché à l’évacuation de la place de la République des excès qui s’expliqueraient par l’absence de forces spécialisées. D’où des scènes « choquantes » dénoncées par le ministre lui-même. Mais nous sommes payés pour savoir que la question de la sécurité se pose de façon permanente, avec la mise en cause de bavures policières. On s’en est aperçu au moment des Gilets jaunes. Et l’on en discute avec passion autour d’un projet de loi très contesté à gauche.
Reste la crise migratoire, qui ne peut être, d’évidence, traitée en son fond par des mesures de cette nature. Dans quelle proportion la France peut-elle accueillir « une part de la misère du monde » et comment régler les dispositions propres au droit d’asile ? C’est le monde entier qui est confronté à un défi qui n’est pas près d’être résolu.
Chronique diffusée sur Radio Notre-Dame le 25 novembre 2020.