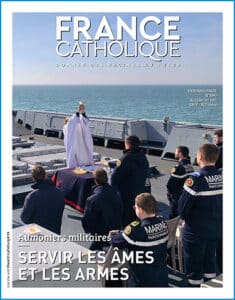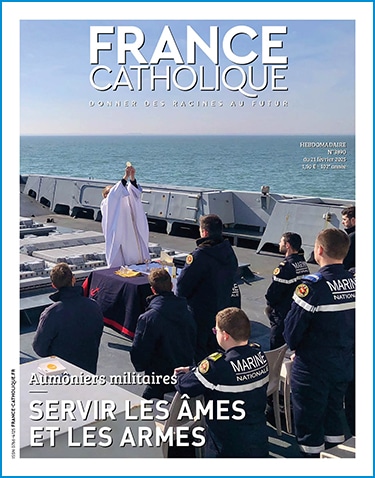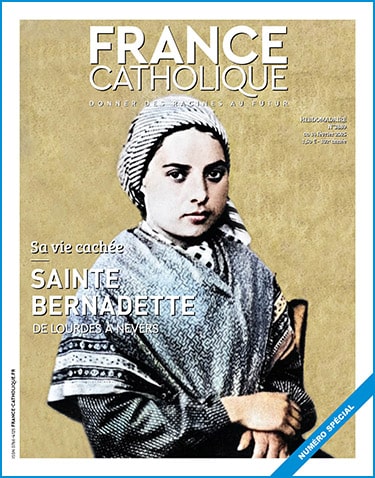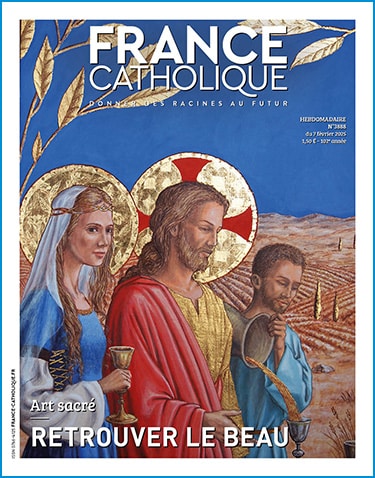Les Français souffrent (et je crois sans espoir de remède) d’une hallucination qui malheureusement semble les conduire tout droit là où ils ont peur d’aller : ils voient dans l’Amérique, prise comme une entité, la personnification arrogante d’un passé qu’il faut abattre si l’on veut faire progresser l’humanité. Je ne vais pas m’amuser à défendre l’Amérique, pour deux raisons qui sont bien suffisantes. D’abord parce que je n’en ai nulle envie ; ensuite parce que toutes les parlottes sur les péchés ou les gloires de l’Amérique ne changent rien à rien.
Les parlottes ne changent rien au fait, obstinément méconnu en dépit de toutes les évidences, que l’Amérique est le pays de la révolution1. Regardez autour de vous. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui a transformé notre pays (et les autres) depuis trente ans nous vient de là-bas, bon et mauvais.
Ne parlons pas de la technique et de la science, c’est trop évident. Seulement des mœurs, et au sens le plus large. La dissolution de la famille était là-bas extérieurement un fait social dès 1950. Je dis extérieurement, car en fait la famille américaine subsiste bel et bien. Mais une certaine façon extérieure des rapports familiaux, le laxisme apparent de l’éducation, le débraillé, la tarte à la crème de la « libération sexuelle », l’autre tarte à la crème de la « libération de la femme » (a), la destruction apparente de l’Université, la drogue, la pornographie, que sais-je encore ? Tout cela, nous l’avons reçu comme argent comptant, nous l’avons pris pour la culture américaine, et nous y avons cherché le modèle de notre avenir. Ce qui n’est en Amérique qu’un spectacle est trop souvent devenu notre façon de vivre.
L’Amérique réelle, qui s’amuse de son spectacle et y prend, quand il y a lieu, ce qu’elle y trouve de bon, est le seul pays – peut-être avec l’Angleterre et l’Allemagne – qui ne se soit pas laissé abuser par l’illusion de ses marginaux. Elle a gardé tout ce qu’il y avait de fort dans sa tradition. Selon le mot d’un de mes amis, « toute vérole américaine, objet là-bas de laboratoire, devient ici épidémie ».
Il est très facile d’arriver en Amérique avec une caméra ou un bloc-notes et d’en rapporter après un mois de vagabondage un modèle effrayant qui semble être celui de la société américaine tout entière.
Le piège ultime, c’est le papier quotidien des correspondants de presse. Lisez le grave Monde une semaine d’affilée2. Si vous n’avez pas eu vous-même l’occasion de voir la machine américaine au travail, vous en tirerez la conclusion que ce pays est peuplé de petits Blancs misérables et racistes, de Nègres et d’Indiens persécutés, de Chicanos surexploités, de pédérastes, de maffiosi tirant les ficelles du Congrès, d’étudiants révoltés, de politicards et de policiers marchant au pot-de-vin ; vous imaginerez New York comme une Babylone en ruines ; et la Californie comme un pandemonium de sectes délirantes, à l’occasion criminelles3.
Cependant, vous lirez dans d’autres colonnes que les Américains viennent de rafler tous les Prix Nobel, et parmi ces « Américains » vous êtes étonné de trouver des noms français, italiens, russes, chinois.
II doit y avoir quelque part une erreur. Mais où ? Cela nous intéresserait au plus haut point, car la Babylone croulante, inexplicablement, tient toujours et plus que jamais le monde dans sa main. Depuis le temps qu’elle s’écroule, comment reste-t-elle en tout et partout la tête de file de la puissance, de l’invention, de la création ? Pourquoi ses écrivains et ses musiciens sont-ils si bons ? Comment trouve-t-on à San Francisco, qui n’est pas plus grand que Marseille, les savants de Berkeley et de Stanford, le San Francisco Philharmonic Orchestra, le Golden Gate Quartet, tant de richesses spirituelles ? Comment trouve-t-on les mêmes merveilles à Chicago, « la ville des cochons », voire à Boulder, la toute petite cité universitaire du Colorado ? Il y a là un mystère et remarquez-le, personne ne nous l’explique. Les journalistes européens seraient-ils tous payés par le département de propagande du KGB ?
Bien entendu, il n’en est rien.
Pourtant l’explication est simple dès que l’on a pénétré dans l’Amérique réelle, qui est l’Amérique professionnelle, l’Amérique du travail.
Comme les Français du XVIIIe siècle, les Américains du XXe sont à la fois frivoles et sérieux. La frivolité américaine est aussi visible, que dis-je, accablante au visiteur que celle des Français de Louis XV. Et comme elle, elle trompe, même les plus avertis. Lisez ce qu’en disait Voltaire ! Mais Rousseau, plus intuitif, voyait déjà dans ses Confessions, derrière la façade polissonne, une « gloire prochaine ».
L’histoire ne se répète pas. L’Amérique actuelle a déjà sa gloire ; son siècle classique est déjà perceptible si l’on écarte le mince rideau des folies qui l’amusent. Ce rideau est fait des mille aberrations de sa vie publique. Les journalistes européens en poste là-bas ne sont ni des menteurs ni des vendus. Mais que voient-ils ? Leur monde professionnel, qui est précisément celui de la folie américaine.
Comme le dit si bien la fille de Staline4 (eh oui !), on ne connaît la vraie Amérique « qu’en y entrant par la cuisine », par la porte des amis, soigneusement dérobée.
Ces réflexions me sont inspirées par de récentes rencontres, et par deux livres. Rencontre avec des physiciens, livres de deux autres universitaires de là-bas.
Voici ce que je lis dans l’autobiographie dont l’un des physiciens accompagne ses travaux : « X… est guitariste, auteur de chansons publiées par Broadcast Music, Inc.; il est ceinture noire (shodan) en aiki-do, il a étudié le judo et le karaté. Il a écrit un livre sur les principes des arts martiaux, intitulé Yoseikan Aikido. » Ajoutons que ce guitariste et troubadour est l’un des responsables de la force de frappe américaine.
Imagine-t-on cela en France ? Le guitariste fait sourire. Qui le prendrait ici au sérieux, avec ses chansonnettes ? Pourtant le bouton rouge de l’apocalypse n’est pas loin de la guitare. Il faut savoir penser aux deux pour saisir la vraie Amérique. Ce savant appartient à la génération qui affrontait la police avec des fleurs. Il chante encore (et de tout cœur) « Make love, not war » (b). Cela ne signifie pas qu’il s’effondrera au premier danger. Il est dangereux de le croire !
Un mot enfin sur les deux livres, tout récents, qui montrent à la fois la témérité et la prudence des rêveurs américains, double face bien faite pour nous induire en erreur.
Le premier est dû au Pr Harvey Cox, théologien de la Harvard Divinity School (c), déjà auteur (très discuté), il y a une dizaine d’années, d’une Cité Séculière où était développée l’idée d’un sacré « naturel ». Il y annonce l’échec des « spiritualités orientales » importées avec tant d’entrain aux USA il y a une quinzaine d’années, avec leurs gourous, leurs « méditations transcendantales » et leurs rites théâtraux. En substance, dit-il, et malgré leur efficacité psychologique, il manque à ces spiritualités ce qui fait l’essentiel du message occidental judéo-chrétien : l’amour. L’intéressant n’est pas qu’un professeur à Harvard le dise : c’est qu’il constate cet aveu dans la foule des jeunes à la recherche d’une spiritualité « nouvelle ».
Le deuxième est d’un auteur plus connu encore, Robert E. Ornstein, qui fit beaucoup pour l’étude en laboratoire des effets produits par ces « spiritualités » non occidentales. Son livre (d) est difficile à résumer, car il est d’un technicien. En gros, Ornstein dit que ces effets ne doivent rien à la spiritualité, qu’ils ont une origine physiologique. C’est un grand progrès dans l’étude physiologique du mysticisme, ou plutôt de ses effets secondaires, non spécifiques. Il rejoint d’ailleurs ainsi des vérités bien connues depuis longtemps par les spirituels européens et les tribunaux de canonisation5.
Aimé MICHEL
(a) Qui ne serait pour cette libération ? Mais aux USA, où tout se manifeste dans des extravagances minoritaires multipliées à l’infini comme un spectacle par les mass media, l’Europe a pris l’extravagance pour règle.
(b) « Faites l’amour, pas la guerre » : c’était, et cela reste le slogan de sa génération, qui peuple maintenant l’entourage de Carter. Ces hommes et ces femmes restent pacifiques. Mais ils ont pris conscience du danger extérieur.
(c) The Promise and Peril of the New Orientalism (Simon and Schuster, 1977).
(d) The Mind Field (New York Grossman Publishers, 1977). Ornstein enseigne la neuropsychiatrie au Langley-Porter Neuropsychiatric Institute de l’Université de Californie.
Chronique n° 301 parue dans F.C. – N ° 1621 – 6 janvier 1978. Reproduite dans La clarté au cœur du labyrinthe, Aldane, Cointrin, 2008 (www.aldane.com), pp. 410-413.
Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 6 octobre 2014
- Aimé Michel est régulièrement revenu sur ce thème au fil des années, avant et après la présente chronique. Voici quelques extraits qui résument son point de vue :
« Bonnes gens, on vous trompe. Chaque jour, vous lisez dans la presse des textes, vous voyez à la TV des images vous montrant l’Amérique comme le pays où la Grande Pagaye décrite par le Voyant de Pathmos est en train de s’installer doucement » (n° 96, Homo americanus, la semaine dernière).
« L’Amérique, qui inventa Mai 68 quatre ans avant et qui le poussa jusqu’à ses conséquences extrêmes, y compris la vraie bataille, avec des morts (Kent State University, mai 1970), l’Amérique a digéré aussi cela. (…) le vrai mystère est qu’une maladie infantile américaine soit devenue une endémie mondiale. Cette maladie, nous avons su l’attraper, mais nous ne l’avons pas assimilée (n° 244, La bataille de Kent State University – Le repli américain ne signifie pas la fin de la suprématie américaine, 21.10.2013)
« Regardez autour de vous. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui a transformé notre pays (et les autres) depuis trente ans nous vient de là-bas, bon et mauvais. » (Chronique présente)
« Viking [sur Mars] n’est pas le triomphe isolé d’un groupe de savants américains. Il est celui d’un état d’esprit qui se décèle déjà chez l’enfant et ne cesse ensuite de se développer, une curiosité d’esprit concrète, un savoir-faire où les mains et l’esprit se conjuguent sans cesse. » (n° 254, Viking et l’autre façon américaine d’être plombier – L’univers aime s’amuser et il aime bien ceux qui s’amusent avec lui, 28.01.2013)
« Je serai tenté de définir la société américaine comme une anarchie spontanément organisée et en perpétuelle évolution. (…) Car le secret de l’Amérique, c’est son rendement humain. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, quand vous entrez dans la carrière, n’importe laquelle, soyez assuré qu’en un temps record vous arriverez à votre limite. (…) Et ceci est vrai en tout : travail, art, science, vice, et s’il le faut, vertu. La société américaine réalise par le seul jeu de ses lois naturelles ce qu’ailleurs on attend de la contrainte. Elle vous presse comme un citron. » (n° 208, La bousculade américaine – La source révolutionnaire de ce temps, c’est l’Amérique, 05.12.2011)
« Que l’Amérique n’aspire pas à la grandeur militaire, nous en sommes certains : sa puissance est celle de ses ingénieurs, de ses savants, de ses marchands. C’est même, peut-être, la première fois qu’un grand peuple détient les moyens d’une domination violente et s’abstient d’en user. » (n° 201, La grandeur aux oubliettes, 03.10.2011).
« Citez-moi dans l’Histoire un peuple, un seul, qui, détenteur d’une suprématie comparable à la nôtre, en ait fait un usage aussi modéré ? » (n° 398, Le Gargantua américain, reproduite dans La clarté, op. cit., pp. 413-415).
Il fallait de la lucidité pour discerner la force véritable de l’Amérique au-delà des apparences et du courage pour le faire savoir à une époque dominée par ce qu’on appelait « l’impérialisme » américain. Mais bien entendu ce recadrage et cet éloge n’est pas une admiration béate : les excès et les failles de l’Amérique sont reconnues, qu’on relise par exemple la chronique n° 290, Recette pour un suicide collectif propre – Pourquoi en démographie le principe de plaisir est un principe de mort (2.12.2013), ou La grandeur aux oubliettes ou encore Le Gargantua américain (citées ci-dessus).
- Aimé Michel cite souvent Le Monde, qui exprime les idées dominantes des milieux intellectuels en France, pour en prendre résolument le contre-pied. L’orientation anti-américaine de ces milieux ne semble pas avoir beaucoup changé un quart de siècle plus tard puisque, dans un entretien de 2004 à propos de son livre L’Obsession anti-américaine, son fonctionnement, ses causes, ses inconséquences (Plon, Paris, 2002), le journaliste et essayiste Jean-François Revel estime que l’anti-américanisme en France est un « sentiment élitiste » qui touche principalement « les dirigeants politiques, les intellectuels et les journalistes les plus influents » mais non le reste de la population. Cette opinion est confortée par un sondage du CSA réalisé en 2007 à la demande du Sénat et de la French-American Foundation France qui montre que seulement 15% des Français éprouvent de l’antipathie pour les États-Unis, les autres se partageant entre sympathie (30%) et indifférence (54%) (http://www.senat.fr/evenement/rendez_vous_citoyens/histoire2007/synthese.pdf).
Les thèmes de prédilection de cet anti-américanisme sont bien connus. La quatrième de couverture du livre de Noël Mamère et Olivier Warin, Non merci, Oncle Sam ! (Ramsay, Paris, 1999) en offre un résumé qu’il faudrait citer en entier : « (…) l’Amérique essaie d’imposer son ordre moral, économique et militaire. (…) Elle dicte sa loi à l’ONU (…), veut faire de l’Otan le maître militaire du monde (…). Elle se dote d’une milice planétaire, l’OMC, à laquelle elle donne mission de régenter le commerce mondial, culture et santé comprises. (…) L’Amérique, c’est le record d’obèses, le record absolu d’armes détenues par des personnes privées (…), le poids du puritanisme et des sectes (…). »
Ce genre de réquisitoire, sélectionnant les faits et mêlant le vrai à l’approximatif et au contestable, est monnaie courante dans notre pays plus qu’ailleurs en Europe. Jean-François Revel dans un entretien avec Antónis Samarás, aujourd’hui Premier ministre de Grèce depuis 2012 (http://www.politiqueinternationale.com/revue/article.php?id_revue=12&id=227&content=synopsis&search=Revel&page=1&resultPerpage=10&titre=&intexte=) estime que les motivations profondes de l’anti-américanisme sont la haine du modèle libéral et la volonté de s’innocenter de ses propres erreurs en les imputant aux États-Unis. Il insiste sur la distinction qu’il faut faire entre cet anti-américanisme « primaire » et la critique des États-Unis. « La critique des États-Unis est légitime et nécessaire. La société américaine n’est pas exempte de défauts. L’Amérique commet des erreurs et des abus dans sa politique étrangère. Quel pays n’en commet pas ? Mais il faut se fonder sur des informations exactes et dénoncer les véritables défauts et les véritables erreurs. Il ne faut pas méconnaître non plus, consciemment ou inconsciemment, les qualités et les réussites : les bonnes décisions, les interventions salutaires, les actions couronnées de succès. (…) L’anti-américanisme, c’est tout autre chose. Il s’agit d’un aveuglement passionnel qui repose sur une vision totalisante, sinon totalitaire, selon laquelle les Américains ne commettent que des erreurs ou des crimes, ne profèrent que des sottises et sont coupables de tous les échecs, de toutes les injustices, de toutes les souffrances du reste de l’humanité. Il conduit à reprocher aux États-Unis une chose et son contraire, à quelques jours de distance, voire simultanément. »
- Sur l’une de ces « sectes délirantes » voir la chronique n° 208 citée ci-dessus.
- Svetlana Allilouïeva (ou Alliluyeva en translittération anglaise), fille unique de Staline ayant préféré prendre le nom de sa mère, devint une célébrité mondiale en 1967 lorsqu’elle passa à l’Ouest et publia ses Vingt lettres à un ami (traduit du russe par Jean-Jacques et Nadine Marie, Le Seuil, 1967), témoignage fascinant sur un homme, un régime, une période qui hanteront longtemps les mémoires.
Svetlana naquit le 28 février 1926 à Moscou. Son père avait 47 ans, sa mère, Nadejda Allilouïeva, dite Nadia, en avait 24. C’était une révolutionnaire idéaliste qui n’embrassait jamais sa fille car elle considérait que les bolcheviques n’avaient qu’une famille : le parti. Selon Svetlana, confirmée par plusieurs témoignages indépendants, elle désapprouvait la manière dont son mari conduisait la révolution et fut profondément affectée par les violences, la répression et la famine qui suivirent la collectivisation des campagnes. En novembre 1932, à un banquet où l’on fêtait le 15e anniversaire de la révolution, Staline insista lourdement pour que Nadia, qui ne buvait pas et craignait les effets de l’alcool sur son mari, prenne un verre. Elle refusa, se leva et retourna dans ses appartements du Kremlin. Elle y écrivit une lettre, une « lettre terrible », écrit Svetlana, « pleine de reproches et d’accusations ; non pas purement personnelle mais en partie politique », puis elle se suicida avec une arme à feu. Suivant un autre témoignage, Staline lui-même vint la réprimander et, à l’issu de cette dernière querelle, la tua. La thèse du suicide demeure cependant la plus vraisemblable. La version officielle fut que Nadia était morte d’une crise d’appendicite aiguë.
Pendant les dix ans qui suivirent, Staline fut un « bon père » qui voyait sa fille presque tous les jours. Mais Svetlana, la « petite princesse », sentait l’anxiété grandir dans sa famille. Des proches de sa mère, des parents d’amis d’école, commencèrent à disparaître. Staline, qui les tenait pour responsable du suicide de Nadia, s’enfonçait dans la paranoïa. Svetlana avance, sans doute avec excès, que Lavrenti Beria, chef de la police secrète, manipulait son père à ses propres fins et était largement responsable de sa manie de la persécution. Elle n’apprit le suicide de sa mère qu’en 1942 en lisant une revue de langue anglaise. Ses relations avec son père commencèrent alors à changer. Elles se dégradèrent encore lorsqu’il fit arrêter la femme du demi-frère de Svetlana capturé par les Allemands (et exécuté ensuite par ceux-ci car Staline refusa de l’échanger contre un général allemand), humilia son frère Vassili qui en devint alcoolique, et surtout lorsqu’il envoya le cinéaste Alexei Kapler au goulag parce que Svetlana en était tombée amoureuse.
Staline devint de plus en plus solitaire et claustrophobe. À la fin il travaillait, mangeait et dormait dans la même pièce de sa datcha. Il ne vit jamais cinq de ses huit petit-fils. Pendant cette période, Svetlana, qui fréquentait les cercles littéraires de Moscou, se maria puis divorça deux fois. Au début de mars 1953, elle était en classe de français et n’avait pas vu son père depuis 4 mois lorsqu’elle reçut un message de Malenkov lui demandant de se rendre immédiatement à la datcha de son père. Staline, inconscient, agonisait. Pendant les trois jours que dura son agonie, il ouvrit plusieurs fois les yeux mais son regard était voilé. Le 5 mars, il les ouvrit soudain à nouveau et jeta un regard sur la chambre.
« C’était un regard terrible, dément, ou peut-être furieux et plein de crainte de la mort… Le regard parcouru tout le monde en un instant. Alors quelque chose d’incompréhensible et d’effrayant se passa, quelque chose que je ne peux toujours pas oublier et que je ne comprends toujours pas. Tout à coup il a levé la main gauche comme s’il désignait quelque chose en l’air et jetait un sort sur nous tous. Ce geste était incompréhensible et plein de menace, et personne ne pouvait dire à qui ou à quoi il était destiné. Un instant plus tard, après un dernier effort, l’esprit s’arracha à la chair. »
Au cours des années suivantes elle continua de mener une vie aisée proche des cercles dirigeants mais sa vie intérieure bascula. Elle abandonna complètement sa foi communiste (« Aucune révolution n’a détruit autant de choses de valeur pour le peuple que notre Révolution Russe ») et reconnut qu’elle ne pouvait vivre sans Dieu. Du 16 juillet au 20 août 1963, pour alléger le fardeau de sa mémoire et à la demande d’un ami scientifique « appartenant aussi au monde de la littérature » dont elle ne révéla pas l’identité, elle coucha ses souvenirs sur le papier sous forme de vingt lettres, avec de nombreuses répétitions mais une soigneuse composition d’ensemble. A partir de la même année elle commença une liaison avec un membre du parti communiste indien. Ils ne furent pas autorisés à se marier mais quand son ami mourut à Moscou en 1966 elle fut autorisée à rapporter ses cendres en Inde. Au bout de deux mois, le 6 mars 1967, elle se présenta à l’ambassade des États-Unis à New Delhi et demanda l’asile politique. Le scandale fut énorme d’autant que Moscou se préparait à célébrer le cinquantième anniversaire de la Révolution d’Octobre. Le KGB aurait même songé à l’assassiner. Le président Johnson n’était pas ravi de cette affaire à un moment où les relations avec l’URSS s’amélioraient mais il finit par accepter sa venue « pour des raisons humanitaires ». En avril 1967, via Rome et la Suisse, Svetlana débarqua à New York et les vingt lettres furent publiées la même année. Chacun y vit ce qu’il souhaitait y voir : pour les uns Svetlana avait trahi son pays, pour les autres il exprimait « le jugement blessé d’une fille sur son père, sur une époque, et sur de grands espoirs trahis », « arraché d’une conscience angoissée et d’un cœur blessé » (Arthur Schlesinger).
En novembre 2011 le monde apprend que Svetlana Allilouïeva vient de décéder dans une maison de retraite du Wisconsin après avoir mené une vie d’errance, ne restant jamais plus de deux ans au même endroit, surtout aux États-Unis, mais aussi en Angleterre et même en URSS où elle tenta un retour (voir le témoignage de la fille qu’elle eut d’un troisième mariage aux États-Unis, http://www.parismatch.com/Actu/International/La-petite-fille-de-Staline-est-une-femme-libre-160318). Ainsi finit dans la pauvreté une femme qui connut la gloire mais qui aurait préféré que sa mère épousât un charpentier.
- Aimé Michel s’est beaucoup intéressé au mysticisme, à sa physiologie et aux phénomènes physiques qui lui sont parfois associés. Voir les chroniques n° 83, Les mystiques au laboratoire (11.01.2010), n° 106, L’avocat du diable (01.09.2010), n° 153, Un substitut de la contemplation — Electroencéphalographie et mysticisme (06.06.2011), n° 147, Ascèse et liberté – La libération du corps passe par la libération de l’esprit (22..04.2013), n° 253, Au cœur de l’inconnu (suite et fin) – Ceux qui portent au mystique un mépris « scientifique » sont des ignorants (04.02.2103), n° 330, Marthe robin, ou la lumière du soir – Une mystique pour une fin de siècle consciente de son infinie solitude (31.03.2014).