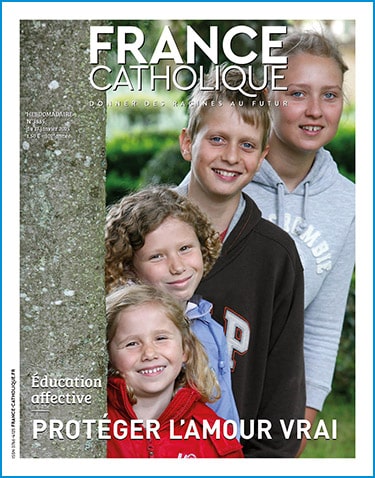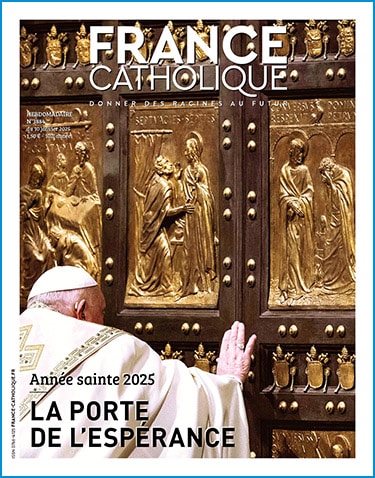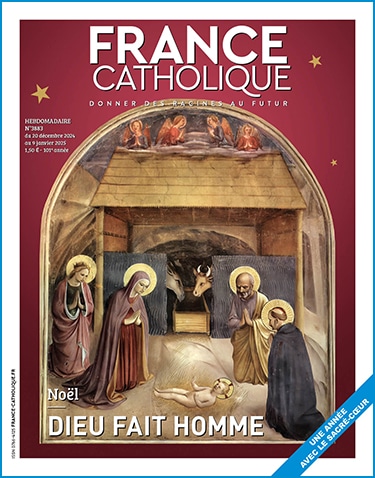L’oraison funèbre est difficile, et c’est pourquoi, sans doute, jadis, les mécréants eux-mêmes apprenaient à la méditer. Voltaire savait par cœur les bons passages de Bossuet et de Massillon.
Ces noms illustres m’ont été rappelés par une oraison funèbre venue de Chicago. L’orateur était un éditorialiste américain connu, que je ne citerai pas. Il y rendait hommage à ceux qui, disait-il, « ont incarné la grandeur passée de la France ». Jusque-là, rien qui incite à la méditation. Mais il ajoutait ceci : « pour autant que cette grandeur existât jamais ». 1
En quatre mots deux mille ans…
Lisant cela, je chiffonnai le journal et le jetai. Non par aigreur chauvine, que l’on m’entende bien, mais par dépit d’éprouver ce que je pris d’abord pour une aigreur chauvine. Assis à mon bureau, je m’étonnais, non sans amertume, de découvrir en moi, jusque-là subtilement déguisé en Dieu sait quoi d’honorable, ce germe de tant de vieilles erreurs, de tant de sottises et de crimes. Et j’en voulais à cet homme assez habile pour m’obliger à me regarder dans son miroir, et à avouer que ce que j’y voyais n’était pas très joli. Être chauvin, pour un Français recru d’histoire, c’est bête.
Mais à la réflexion, une autre idée me vint, plus inquiétante.
Voilà, me dis-je, un porte-parole écouté de l’opinion américaine. Il connaît ses lecteurs nombreux. Sa petite phrase a un sens terrible, elle efface en quatre mots deux mille ans d’histoire et il n’éprouve pas le besoin de la justifier.
Admettons, même si c’est dur, que tant de sueur et de sang, de Vercingétorix à de Gaulle, n’ait finalement rien apporté de grand au monde, et que dans la vague où nous voilà pris nous ne comptions pas pour une goutte.
Mais pour dire cela sans trouble, au fil du discours, il faut être bien sûr de sa propre idée de la grandeur. On ne met pas tout le monde aux oubliettes à la légère.
Je sais ce que vont penser nos amis américains en lisant ces lignes : « Don’t worry ! (ne vous en faites pas !) Pourquoi vous énerver sur quatre mots de notre Bossuet de Chicago ? Ce n’est probablement qu’un analphabète. Relax ! Tous les Américains ne croient pas que l’histoire du monde commence en 1776 et que rien de grand n’a été fait chez vous. Nous savons bien ce que fut la grandeur de la France ».
Eh bien, justement voilà : c’est en imaginant cette réponse et les visages amis de ceux qui ne manqueront pas de la faire que j’ai compris pourquoi j’avais chiffonné et jeté le journal.
Et ce n’est pas la grandeur de la France qui est en cause. La même indignation m’aurait saisi si la petite phrase en quatre mots avait atteint l’Angleterre, ou l’Espagne, ou l’Allemagne, ou la Chine, ou n’importe quelle autre des vieilles nations qui, bien ou mal, mais à travers tant d’épreuves, ont fait ce monde, l’Amérique elle-même qui maintenant en a la charge.
Oh, disons bien que cette indignation ne s’adresse à personne. Peut-être en effet, est-il analphabète, mon Bossuet de Chicago, quoique à son style il n’y paraisse pas, au contraire. Son innocence (et celle de ses lecteurs) ne fait pas plus de doute que le génie de ceux qui conquirent la Lune. Un pays où on peut voir l’armée mettre en accusation ses propres crimes ; c’est cela, entre autres choses, la grandeur. Du moins le pensons-nous, nous autres vieux peuples dont la tête a le droit de faiblir tant nous avons de souvenirs.
Mais l’innocence ici accroît notre perplexité. Vous qui êtes les maîtres du monde et qui pouvez, en appuyant sur le bouton rouge des Monts Cheyenne, le raser, faire de sa surface disparaître toute vie, quelle est donc votre idée de la grandeur pour que la contribution de la France à votre propre patrimoine passe à vos yeux inaperçue ?
Cette modération américaine
Permettez, s’il vous plaît, que nous nous interrogions, fût-ce d’abord pour souligner le fait rassurant que la phrase en question ait été écrite par un journaliste : si analphabète soit-il, un commentateur politique n’ignore quand même pas le nom de Napoléon. S’il doute de la grandeur passée de la France, c’est donc que son idée n’est pas celle de l’orgueil, de la finance et de la gloire, puisque dans ce domaine, nous avons fait ce que l’Amérique ne fera jamais (du moins nous l’espérons) et dont nous n’avons guère lieu d’être fiers : nous avons pris Moscou et nous l’avons regardé brûler.
Que l’Amérique n’aspire pas à la grandeur militaire, nous en sommes certains : sa puissance est celle de ses ingénieurs, de ses savants, de ses marchands. C’est même, peut-être, la première fois qu’un grand peuple détient les moyens d’une domination violente et s’abstient d’en user.
Mais au nom de quelles valeurs s’en tient-elle à cette modération, et ces valeurs, d’où lui viennent-elles ?
N’est-ce pas la vieille Europe qui inventa à la fois les moyens de dominer le monde et les motifs de n’en rien faire ?
C’est ici, non ailleurs, que fut inventée la science expérimentale, et c’est d’ici, non d’ailleurs, que furent proclamés les droits des esclaves et des faibles 2. Je doute que l’on puisse contester la contribution de la France dans ce domaine. Il faut donc croire que la grandeur américaine, ce n’est pas cela non plus.
Qui était grand aux Thermopyles ?
Ce discours est d’un homme blessé ? Oui, je l’avoue. La vérité est que cette idée de grandeur, dont on nous a tant parlé depuis trente ans, est en train de prendre un sens nouveau qui déconcerte notre jugement, à moins, peut-être, qu’elle reprenne un sens ancien dont nous pensions nous être à jamais libérés.
Qui était grand aux Thermopyles ? Léonidas ou Xerxès ? Le premier n’avait que trois cents soldats, et il fut vaincu. Cependant nous répétons depuis deux mille ans et chacun de nous a été éduqué à penser que la grandeur, c’était Léonidas, roi vaincu d’un tout petit royaume perdu sur les confins maritimes des deux Grands de l’époque, l’Égypte et la Perse.
Il faut changer tout cela : la grandeur, ce n’était pas Léonidas, c’était les Grands.
Et nous le sentons bien, il ne s’agit plus ici d’une petite phrase échappée, peut-être, à la plume distraite d’un journaliste, mais d’un signe. Les lois de ce monde ont échappé aux hommes, à leur courage, à leur force d’âme.
Nous devons l’admettre : les lois de ce monde ont échappé au courage des hommes et certains disent même qu’elles échapperont bientôt à leur intelligence, l’histoire étant remplacée par une évolution technologique automatisée.
Quelque chose en nous est en train de mourir, à quoi ne pensait pas l’auteur de l’oraison funèbre. Le paradoxe est qu’il nous faudra sans doute, pour survivre dans ce monde apparemment fait pour décharger l’homme du fardeau de ses vieilles vertus, plus d’intelligence encore et de courage que dans le monde ancien, comme si décidément, et quoi que nous fassions, une éternelle nécessité nous poussait à devenir toujours plus que nous ne sommes 3.
Mais de cela, n’est-ce pas ? nous nous doutions un peu.
Aimé MICHEL
(*) Chronique n° 201 parue dans F.C. – N ° 1446 – 30 août 1974. Reproduite dans La clarté au cœur du labyrinthe, chap. 14 « Histoire de France », pp. 379-382.
Les Notes de (1) à (3) sont de Jean-Pierre ROSPARS
— –
— –
Deux livres à commander :
Aimé Michel, « La clarté au cœur du labyrinthe ». 500 Chroniques sur la science et la religion publiées dans France Catholique 1970-1992. Textes choisis, présentés et annotés par Jean-Pierre Rospars. Préface de Olivier Costa de Beauregard. Postface de Robert Masson. Éditions Aldane, 783 p., 35 € (franco de port).
À payer par chèque à l’ordre des Éditions Aldane,
case postale 100, CH-1216 Cointrin, Suisse.
Fax +41 22 345 41 24, info@aldane.com.
Aimé Michel : « L’apocalypse molle », Correspondance adressée à Bertrand Méheust de 1978 à 1990, précédée du « Veilleur d’Ar Men » par Bertrand Méheust. Préface de Jacques Vallée. Postfaces de Geneviève Beduneau et Marie-Thérèse de Brosses. Edition Aldane, 376 p., 27 € (franco de port).
À payer par chèque à l’ordre des Éditions Aldane,
case postale 100, CH-1216 Cointrin, Suisse.
Fax +41 22 345 41 24, info@aldane.com.
— –
- Complète trois mois plus tard les réflexions de la chronique n° 188, Science et culture (parue ici le 23 mai 2011). « La culture française n’existe plus. Le XXe siècle n’est pas français »
- Cette proclamation par la « vieille Europe » des « droits des esclaves et des faibles » a une histoire longue et complexe. Plutôt que d’en tenter un résumé superficiel je préfère illustrer cette histoire par la vie d’une des grandes figures de la lutte contre l’esclavage, le dominicain espagnol Bartolomeo de las Casas (1484-1566), telle qu’elle est contée par Dominique Laplane dans Un regard neuf sur le génie du Christianisme (2e édition, François-Xavier de Guibert, Paris, 2006).
Las Cases arrive à 18 ans en 1502 dans l’île d’Hispaniola (aujourd’hui Haïti) comme colon pour cultiver des terres à l’aide d’indiens soumis en principe au servage mais en réalité traités en esclaves. En 1510, de retour en Espagne il est ordonné prêtre. En 1513, il assiste impuissant à un massacre d’indiens commis sans raison par des soldats mais ce qu’est que l’année suivante qu’il se met à prêcher à son tour pour la libération des indiens, comme son supérieur Pedro de Cordoba. En 1515 il se rend à la Cour pour défendre la cause des Indiens mais en préconisant l’utilisation comme esclave de Noirs faits prisonniers de guerre (ce dont il se repentit amèrement par la suite). Il est nommé « procureur » des Indiens mais c’est un échec : les religieux inexpérimentés qui l’accompagnent croient que les indigènes sont incapables de se gérer seul car ils sombrent dans l’alcoolisme les jours de repos que la loi impose. Une controverse l’oppose devant le roi à l’évêque Quevedo qui défend les colons victimes des exactions des Indiens et tient ces derniers pour des êtres inférieurs, « esclaves par nature ». Las Casas lui répond « Notre religion est destinée à toutes les nations du monde : toutes, elle les accueille ; elle n’en prive aucune de liberté sous prétexte qu’elles sont esclaves par nature. » Aidé par d’autres intervenants, dont le vice-roi Diego Colomb, fils du découvreur, il l’emporte et obtient 1200 km de terres dans l’actuel Venezuela. C’est un nouveau désastre avec des exactions de part et d’autre. Cette fois il abandonne son rêve d’être un « bon colon ». Il se retire dix ans pour parfaire sa formation et commence à rédiger sa « Très brève relation de la destruction des Indes ».
En 1535, envoyé au Pérou conquis par Pizarre, son navire échoue au Nicaragua. Là il se brouille avec le gouverneur à propos d’une expédition vers l’intérieur des terres. Il se rend au Guatemala où il prêche la douceur auprès de colons qui le mettent au défit de mettre ses principes en œuvre au Tezulutlan, connu pour la férocité de ses habitants. Il relève le défi, approche les chefs indiens et quatre d’entre eux demandent le baptême. Il revient à la cour, où connu et soutenu par les évêques du Nouveau Monde, il obtient confirmation de l’interdiction faite aux Espagnols d’entrer au Tezulutlan puis son rattachement direct à la Couronne. Seuls les Dominicains sont autorisés. De 1545 à 1547 il est évêque des Chiapas « fulminant contre les Espagnols qui refusaient d’appliquer les lois royales, exigeant la libération des esclaves, interdisant l’absolution à ceux qui s’y refusaient, courant de réunions avec les Gouverneurs et leurs fonctionnaires à des réunions épiscopales régionales qui, d’ailleurs, approuvèrent l’essentiel de ce qu’il réclamait ». En 1550, Charles Quint suspend provisoirement les expéditions de conquête et demande un débat théologique sur leur légitimité. Ce fut le célèbre débat de Valladolid qui opposa Las Casas à Sepulveda. Il n’y eut pas de conclusions officielles mais Sepulveda ne reçut jamais l’autorisation de publier ses thèses en Espagne et les guerres de conquête restèrent suspendues avant d’être définitivement abolies en 1573 par Philippe II. Las Casas consacra le reste de sa vie à écrire un grand nombre d’œuvres à la défense des indiens qui eurent un retentissement considérable dans toute l’Europe (même s’il fut cyniquement exploité par les ennemis de l’Espagne).
« Rien ne peut effacer la barbarie des premiers conquistadores mais la relative promptitude des réactions de l’Église et du pouvoir royal restera pour toujours à l’honneur de l’Espagne. Un résultat pratique peu contestable est que les populations indiennes sont nombreuses en Amérique latine où elles ont été littéralement sauvées des mains des bourreaux potentiels ce qui n’a pas été le cas des populations indigènes ni en Amérique du Nord, ni en Australie. (…) Par leur conception des Droits de l’homme et leur universalité, les religieux espagnols dont Bartolomeo de las Casas est le héraut nous apparaissent extrêmement modernes bien que leurs affirmations soient nées au début du 16e siècle au sein même de l’ordre qui a joué le plus grand rôle dans l’Inquisition et dans le pays où elle a été la plus active. Bartolomeo de las Casas a montré également non seulement une curiosité pour les indiens et leur culture, mais une grande estime pour elle. Il les approuve même de défendre leurs dieux au péril de leur vie, puisqu’ils croient en leur existence. Il a tout fait pour que, dans le territoire qu’il a administré du point de vue religieux, les mœurs des indiens, leurs coutumes soient préservées ; il ne l’a pas fait en ethnologue, soucieux de ne pas voir disparaître une des multiples faces de la culture humaine mais par souci pour les personnes qui vivaient de cette culture. Non seulement personne n’a fait mieux que lui, mais il a servi d’initiateur. C’est sa lecture de l’Évangile (…) qui [a] inspiré tous ses combats. Si l’a postérité la suivi, ce n’est souvent pas pour les mêmes motifs, mais (…) parce que ce que l Évangile nous a appris, l’homme l’a ressenti comme vrai. » (pp. 203-204).
- Ces deux paragraphes font écho aux réflexions de la chronique n° 91, La fin de la nature humaine, parue ici le 26 septembre 2011. Le premier résume la thèse défendue aujourd’hui par les transhumanistes (ou singularistes) dont le chef de file est l’informaticien Ray Kurzweil dont j’ai résumé les thèses en marge de la chronique citée ci-dessus (voir aussi la chronique n° 20, Le « Jugement dernier ». Nous avons les moyens de notre extermination, parue ici le 04.01.2010). Le second paragraphe est d’une toute autre inspiration puisqu’il évoque de manière paradoxale, non une disparition de la lignée humaine mais sa survie plus qu’humaine suivant son génie propre.