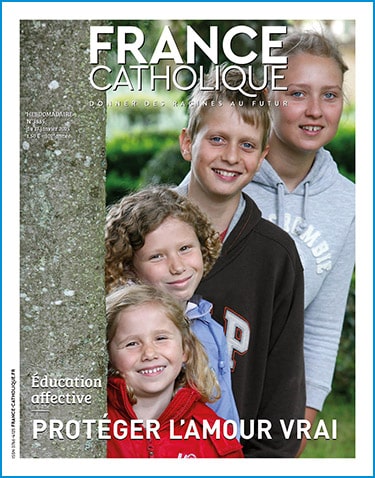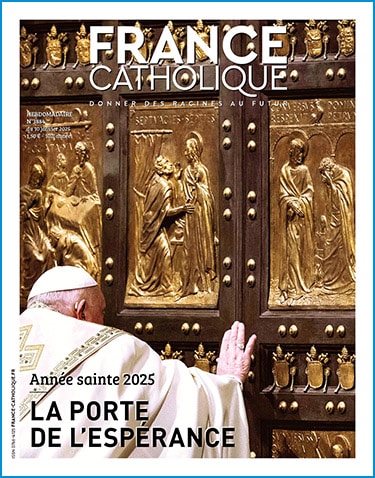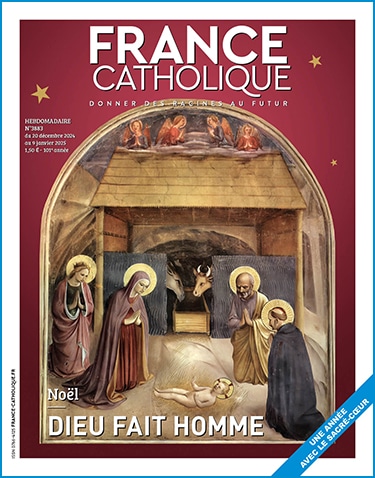C.D. Waddington est un de ces biologistes anglais non conformistes qui, entre autres originalités, croit que l’évolution attend encore son explication et qu’il est temps de déposer, avec un infini respect, la momie de Darwin dans un musée1.
Voilà quelque temps, Waddington réunissait un petit colloque pour discuter du sujet à la mode, à savoir le futur. Mais, non conformiste comme il se doit, il n’avait invité aucun expert : seulement des gens très intelligents et très compétents dans leur spécialité, y compris un urbaniste comme le Grec J. Papaionnou, une anthropologue comme Margaret Mead, un musicien comme John Cage. Ils discutèrent trois ou quatre jours en bras de chemise en s’appelant John, Margaret, Carl.
Une menace illusoire
Je viens de lire l’enregistrement de cette discussion. Que n’a-t-on plus souvent l’occasion d’écouter aux portes quand des esprits de cette qualité bavardent sans contrainte, sans illusion, sans orgueil (a) ! On y découvre que ce qu’ils savent le mieux, c’est qu’ils ne savent pas grand-chose. Et que, s’agissant du futur, ce qu’on peut en dire de plus sensé, c’est qu’« il n’est plus ce qu’il était » !
Pourquoi nos contemporains sont-ils tellement obsédés par l’avenir ? Posez cette question autour de vous : on vous répondra que c’est parce qu’il est sombre et menaçant.
Mais est-ce sûr ? En fait, objectivement, dans toute l’histoire de l’humanité, nous autres mortels de l’an 1974 sommes les plus assurés qu’il y eût jamais de mourir de vieillesse. Même en étendant notre examen à tout le XXe siècle avec ses deux guerres mondiales et en tenant compte de tous leurs morts, jamais, en moyenne, tant d’hommes échappèrent à un trépas prématuré. En espérance de vie, aucune époque ne fut jamais si favorisée. On me dit : oui, mais vos enfants ?
Eh bien, même nos enfants : voyez les statistiques des siècles précédents, quand il y en a. Au XIXe, au XVIlIe siècle, la majorité n’atteignaient pas leurs vingt ans.
Mais cette fois, insiste-t-on, la menace est globale, ce qui ne s’était jamais produit. C’est l’humanité entière qui risque de périr.
Vraiment globale ? Même une guerre nucléaire ne tuerait pas tout le monde. Elle tuerait probablement moins que les épidémies mondiales de jadis. C’est bien suffisant pour effrayer, certes. Mais l’espèce survivrait. Tuer tout le monde est plus difficile qu’on ne croit.
Allons au fond : ce n’est pas la menace de mort qui nous fait peur. Ce sont les ténèbres. Pour la première fois, sans être réellement plus menacé, l’avenir global est inscrutable. L’homme préhistorique, le Gaulois, le sujet de Louis XlV savaient que leurs chances de parvenir à une vieillesse sans histoire étaient minimes, qu’ils pleureraient la plupart de leurs enfants. Mais ils savaient en revanche que leurs incertains survivants continueraient leur œuvre et perpétueraient l’essentiel de leur héritage.
C’est cela qui nous est ôté. Colette disait que la mort n’est rien quand on laisse après soi quelque chose qu’on préfère à la vie. Et justement, le plus que nous puissions espérer laisser après nous, ce n’est que la vie. Avec l’affolante accélération de la science, nous savons de toute certitude que l’univers spirituel de nos petits-enfants est totalement imprévisible, inconnaissable, et c’est cela qui épouvante2.
En veut-on une preuve ?
Une des conquêtes les plus prometteuses de la biologie du comportement est l’élucidation des mécanismes de l’apprentissage. C’est par eux que les primatologues sont en train d’apprendre à parler aux singes. On ne sait pas jusqu’où cela ira avec ces animaux, et avec d’autres comme le dauphin, sur quoi (ou sur qui ?) les Américains poursuivent des recherches couvertes par le secret militaire3.
Une gymnastique cervicale
Mais l’homme aussi, l’homme surtout est susceptible d’apprentissage. Le langage, la logique, la culture, les mœurs sont objet d’apprentissage.
Depuis un an ou deux, les neurophysiologistes ont peut-être commencé de mettre la main sur les mécanismes les plus secrets de l’apprentissage, ceux de notre inconscient. Cette mainmise s’opère par une technique toute nouvelle appelée le biofeedback. Le biofeedback est une application particulière de l’électroencéphalographie qui permet de suivre l’activité électrique de son propre cerveau, d’en repérer les fluctuations, d’en discerner les concomitances avec les fluctuations de la pensée.
Grâce à un dispositif très simple, je peux suivre les variations de mon électricité cérébrale à mesure que je pense à ceci ou cela, que j’éprouve telle ou telle émotion, que je me mets dans telle ou telle attitude intérieure. Et à mesure que cet exercice me devient familier, je peux apprendre à mettre mon cerveau dans tel état que je veux en agissant sur ma pensée4.
Vers une télépathie volontaire
Or plusieurs de ces savants, et notamment le Dr Fernand Poirier, de Montréal, se sont aperçus que le biofeedback semble permettre d’identifier les états cérébraux dans lesquels se produisent les phénomènes jusqu’ici mystérieux de télépathie, de prémonition, etc. Si ces savants ne se trompent pas, l’apprentissage de ces états et la domestication de ces phénomènes pourraient s’enseigner, comme le langage !5
Essayons d’imaginer une humanité où la transmission de pensée deviendrait un fait de culture. Les écrivains de science- fiction ont beaucoup rêvé sur cette fantastique hypothèse (b). Ce n’était que de la littérature6. Cette littérature deviendra-t-elle réalité ? Personne n’en sait rien. Mais on voit dès maintenant comment cela pourrait se produire. Et je crois que ce qui, plus que la mort, nous effraie dans le proche futur, c’est la certitude que si de telles choses sont possibles, elles seront, inéluctablement. Car l’homme a perdu la maîtrise de la science, qui désormais poursuit sa course emballée.
Aimé MICHEL
(a) C.H. Waddington : Biology and the History of the Future (Edinburgh University Press, 22, George Square, Edinburgh).
(b) Cf. le roman classique d’Arthur C. Clarke les Enfants d’lcare.
Chronique n° 204 parue dans France Catholique-Ecclésia − N° 1449 − 20 septembre 1974
Notes de Jean-Pierre ROSPARS du 30 septembre 2013
- Conrad H. Waddington (1905-1975) est un biologiste anglais, professeur de génétique animale à l’université d’Edinbourg, qui s’illustra dans différents domaines, la génétique, la biologie du développement et l’évolution, dont il montra les intimes relations. Il fait partie des grands embryologistes « classiques », c’est-à-dire antérieurs aux découvertes de la biologie moléculaire. Ses intérêts ne se limitaient pas aux sciences et s’étendaient à la philosophie, la poésie, la peinture et la politique (avec des idées de gauche). Il publia une vingtaine de livres de 1939 jusqu’à sa mort.
Il s’illustra en génétique du développement qu’il étudia notamment chez la drosophile. Il introduisit le concept de « canalisation » par lequel un organisme demeure semblable à lui-même (on dit que son phénotype est stable) en dépit des variations de son génotype et de son environnement. Il proposa également celui d’« assimilation génétique » par lequel une population soumise à un stress (un milieu salé par exemple), qui n’a au départ que la capacité d’y répondre par une adaptation morphologique, finit par acquérir un génotype qui produit ce caractère adapté même en l’absence du stress (Waddington insiste que ce résultat n’est lamarckien qu’en apparence : l’environnement n’agit pas directement sur les gènes mais par une longue sélection des individus qui les portent).
Il fut l’un des premiers à soutenir que l’évolution se produisait principalement par des mutations affectant le développement embryonnaire. Cela le conduisit à critiquer certains aspects de la théorie néo-darwinienne de l’évolution et à tenter d’en corriger les défauts. Il considérait que la théorie insistait trop sur les gènes individuels et pas assez sur les interactions entre gènes. Il défendait donc une conception holiste du génome et des êtres vivants ; il était influencé sur ce point par la philosophie d’Alfred North Whitehead et la cybernétique de Norbert Wiener. Il défendit également l’idée que la macroévolution obéissait à des processus différents de la microévolution (l’apparition d’une nouvelle espèce), contrairement au postulat néo-darwinien défendu en particulier par Ernst Mayr.
- Aimé Michel poursuit la réflexion commencée dans la chronique précédente (n° 203, Impossible futurologie, mise en ligne la semaine dernière). Son analyse n’a fait que gagner en pertinence : plus on sait de choses sur le monde et la société, moins on se sent capable de prévoir ce qui va se passer. Il ne suffit pas d’identifier les facteurs d’évolution, il faut encore estimer leur importance relative, décider de leurs effets les uns sur les autres ; plus le système est complexe et moins son évolution devient prévisible. Dans un pays comme la France, cette incertitude grandissante se mue en pessimisme sur l’avenir mais il n’en va pas de même dans d’autres pays.
- Au début on a voulu apprendre à parler aux singes, avec un presque total insuccès. Puis vinrent les psychologues Beatrice et Allen Gardner qui eurent l’idée et la volonté (ils n’avaient ni laboratoire, ni argent, ni appui) d’essayer d’apprendre à leur guenon Washoe le langage gestuel des sourds-muets, en l’occurrence l’American Sign Language (ASL). Ils y parvinrent avec un plein succès : non seulement Washoe apprit à désigner des objets mais aussi à associer des mots en phrase, avec des noms communs, des noms propres, des verbes (aller, venir, donner), des négations, des adjectifs (froid, chaud). En 1964, Ann et David Premack entreprirent à leur tour d’apprendre à écrire à leur guenon Sarah, non avec du papier et un crayon, mais avec des formes en plastique à coller sur un tableau magnétique. Là encore les résultats furent surprenants : Sarah apprit à nommer des objets, à les comparer (signes « le même que » et « différent de »), à répondre à une demande (signe « fais quelque chose ») et à une question (signes « oui » et « non »). Elle parvint à maîtriser 125 mots avec 5 verbes, des adjectifs, des prépositions et des conjonctions.
« Ces études, estime Annie Gautier-Hion, ont un long avenir devant elles. Bien que très critiquées par divers chercheurs, comme c’est le cas à chaque fois qu’une nouvelle expérience ou théorie tend à réduire l’espace entre l’Homme et les singes, elles sont sans aucun doute une des voies pour appréhender les origines du langage humain qui, comme tout autre processus biologique, ne doit pas procéder d’une apparition soudaine mais d’un continuum dynamique au cours de la phylogenèse. » (Article « Anthropomorphes » de l’Encyclopedia Universalis).
Dans cette perspective Rémy Chauvin s’interroge : « Devons-nous renoncer à trouver des critères qui caractérisent absolument et à eux seuls l’espèce humaine ? Mais pas du tout ! Ils existent : le langage n’a simplement pas le caractère de barrière radicale qu’on avait imaginé. L’homme est un être qui allume le feu, cuit ses aliments et enterre ses morts. Voilà les trois critères de l’hominisation. Et en voilà un autre plus radical encore : tourné vers le ciel, il invoque les dieux, comme dit Lucrèce :
Coelumque tueri
Jussit erectos ad sidera tollere vultus » ;
c’est-à-dire : « Il leur ordonna de se mettre debout, de lever le visage vers la voûte céleste et de regarder le ciel… » (La biologie de l’esprit, Editions du Rocher, 1985, p. 183-184). - Les techniques dites de rétroaction biologique (ou biofeedback) ont connu une grande vogue dans les années 70 mais elles n’ont pas résisté à l’épreuve du temps. C’est une histoire fort curieuse qui mérite d’être contée.
Tout commence avec les expériences de Skinner dont nous avons déjà parlé : un rat à jeun découvre par hasard qu’en appuyant sur un levier de sa cage il peut se procurer une boulette de nourriture. Il tend alors à reproduire l’appui sur le levier (réponse renforcée) pour obtenir de la nourriture (le renforcement). C’est ce que Skinner a appelé conditionnement opérant. Il rend compte de la majorité des conduites acquises par les animaux dans leur milieu naturel. Les expérimentateurs se sont alors ingéniés à compliquer les relations entre réponses et renforcements. Ils ont ainsi pu montrer qu’il n’était pas nécessaire de renforcer le comportement à chaque fois : on peut exiger de l’animal des centaines de réponses avant un renforcement. On peut aussi les séparer considérablement dans le temps à condition de le faire progressivement. On a pu de la sorte poser aux animaux des problèmes d’une extraordinaire difficulté impliquant de multiples réponses sous contrainte (franchir un labyrinthe, appuyer sur une pédale ici et une autre là pour ouvrir une porte, transporter une bille etc). qu’ils se sont montrés capables de résoudre contre toute attente.
Toutes ces expériences portent sur des réponses motrices qui mettent en jeu la musculature squelettique. Mais qu’en est-il des muscles lisses des viscères commandés par le système nerveux autonomes (sympathique et parasympathique) ? Skinner pensait qu’il n’était pas concerné par le conditionnement opérant. Des expériences ont été faites qui ont montré que le rythme cardiaque, le rythme des contractions intestinales et d’autres réactions viscérales commandées par le système autonome pouvaient être conditionnés. Les expériences de Neal Miller et coll. (1967-1972) surtout, qui utilisaient l’autostimulation cérébrale ou l’évitement de chocs électriques, ont paru décisive (N.E. Miller, Biofeedback and visceral learning, Ann. Rev. Psychol., 29 : 373-404, 1978). Ces expériences furent au départ du biofeedback et de l’espoir de comprendre les effets psychosomatiques chez l’homme.
Pourtant, la reproduction de ces expériences dans d’autres laboratoires se heurta bientôt à des difficultés. Miller lui-même dût convenir que la proportion de résultats positifs obtenus dans son laboratoire avait décliné au fil des années jusqu’à retomber au niveau du hasard. L’explication de ce déclin demeure mal comprise (B.R. Dworkin et N.E. Miller, Failure to replicate visceral learning in the acute curarized rat preparation, Behavioural Neuroscience, 100 : 299-314, 1986). En tout cas le biofeedback en plein essor en a eu les ailes coupées et aujourd’hui on n’en parle plus guère qu’au passé. C’est un exemple frappant de résultat scientifique attrayant non confirmé par la poursuite des recherches.
- La possibilité d’apprendre les phénomènes psi par biofeedback n’a pas eu plus de succès que le biofeedback lui-même. Un parallèle curieux mérite cependant d’être relevé. On a également remarqué que les résultats d’expériences de parapsychologie devenaient de moins en moins significatifs à mesure qu’on les répétait. Est-ce une simple coïncidence ?
- Dans Les enfants d’Icare Arthur C. Clarke (1917-2008) s’interroge sur l’avenir de l’humanité. Son roman métaphysique et cosmique est probablement l’un des plus riches et des plus déstabilisants que la science-fiction ait produit. Il y décrit un univers où les pouvoirs paranormaux de l’esprit sont une réalité plus dangereuse que l’atome ; un univers peuplé d’intelligences extraterrestres hiérarchisées, où des tuteurs (les Seigneurs) guident des civilisations naissantes vers leur accomplissement ; un univers où certaines races sont sans avenir, bloquées dans des impasses évolutives, tandis que d’autres peuvent accéder à des niveaux supérieurs, non par une transformation du corps mais par une mutation de l’esprit. C’est cette mutation inconcevable qui forme la trame du récit : la fin de l’enfance de l’humanité (le titre originel du roman) qui est aussi un commencement. « L’avenir du monde tel que vous le connaissez est clos, explique l’un des Seigneurs au dernier homme. Tous les espoirs, tous les rêves de votre race sont éteints. Vous avez donné naissance à vos successeurs, et c’est là votre tragédie : vous ne les comprendrez jamais, vous ne pourrez jamais entrer en communication avec leur esprit. » Cette fin de l’enfance est la fin de l’homme, « une fin qu’aucun prophète n’avait jamais annoncée, une fin désavouant aussi bien l’optimisme que le pessimisme ».
C.S. Lewis, dont nous avons déjà parlé (voir La quarantaine des dieux, 03.05.2010, et « Miaou » et tout est dit, 08.04.2013) et qui s’y connaissait (il fut professeur de littérature à Oxford puis Cambridge), tenait ce roman de Clarke publié en 1953 pour « absolument épatant ». Le 22 décembre de cette année-là il écrivait à Joy Davidman Gresham, sa future épouse, que ce livre l’avait stupéfié. « Il est tout à fait en dehors du champ des écrivains courants de l’espace et du temps ; loin au-dessus, près du Voyage à Arcturus de Lindsay et des Premiers hommes sur la lune de Wells. Il est meilleur que n’importe lequel des Stapledon. Il n’atteint pas la délicatesse de Bradbury, mais il en a dix fois la puissance émotionnelle, et bien plus de mythopoeia. » Il ajoutait plus loin : « Nous sommes presque élevé hors de la psyché vers le pneuma (c’est-à-dire de ce qui concerne l’âme à ce qui touche l’esprit). Je veux dire que son mythe nous fait cela par l’imagination. (…) C’est un commentaire surprenant sur notre époque qu’un tel livre reste caché dans une horrible édition brochée, entièrement inaperçue par les cognoscenti, alors que n’importe quelle imbécillité “réaliste” sur un névrosé quelconque dans un appartement de Londres, qui ne nécessite aucune vraie invention, que n’importe quel homme éduqué peut écrire s’il lui en prend l’envie, peut faire l’objet de critiques sérieuses et être mentionnée dans des livres sérieux, comme si elle avait vraiment une importance quelconque. Combien de temps cette tyrannie va-t-elle durer ? je me le demande. Il y a vingt ans, je n’avais aucun doute que je vivrais assez pour voir disparaître tout cela et revenir la grande littérature mais me voici perdant mes dents et mes cheveux, et toujours aucune éclaircie dans les nuages. » (The Collected Letters of C.S. Lewis: Volume III, Narnia, Cambridge and Joy; Letter to Joy Gresham, Dec 22, 1953 ; http://schriftman.wordpress.com/2008/12/16/childhoods-end-by-arthur-c-clarke-c-s-lewis-called-it-an-absolute-corker/). Cette remarque désillusionnée de Lewis reste bien entendu d’actualité. Combien de fois ne m’a-t-on pas expliqué que la science-fiction était de la littérature de gare ou au mieux un « genre » comme le roman policier ?