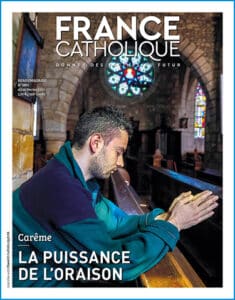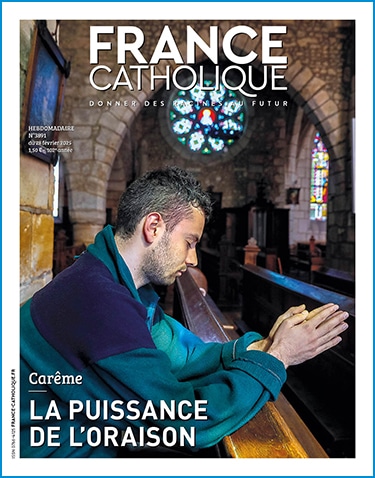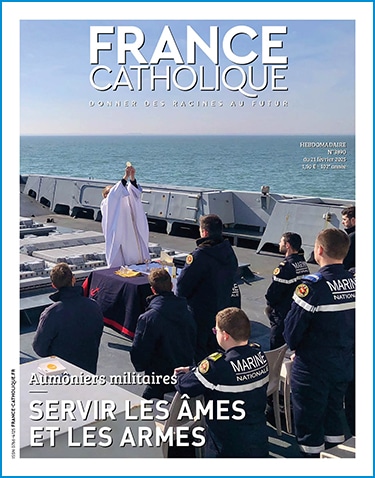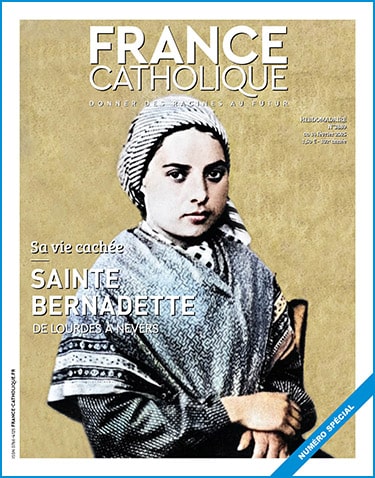1/ au départ, deux problèmes généraux et inséparables : l’émergence et la formation – lentes, difficiles – de ce que nous appelons l’esprit scientifique (en témoignent les six volumes de Georges de Lagarde sur La naissance de l’esprit laïque à la fin du Moyen Âge ou le petit livre d’Alexandre Koyré, Du monde clos à l’univers infini) ; corrélativement, le rapport personnel du savant engagé dans cette démarche aux croyances traditionnelles dans son entourage (par exemple « la religion de Rabelais » étudiée par Lucien Febvre comme témoignage du Problème de l’incroyance au XVIe siècle).
Le propre de la science nouvelle est d’être à double face : positive, exigeant l’indépendance absolue de l’observation et de l’expérimentation ; critique, passant méthodiquement au crible de la raison évidences et certitudes. Ainsi s’explique son lien avec l’incroyance et sa séparation avec la foi. La voie est ainsi ouverte aux Lumières avec leurs deux versants : la raison encyclopédique des philosophes français ; la religion kantienne dans les limites de la simple raison.
2/la curiosité infinie de cette « science du réel » la conduit nécessairement tôt ou tard à la question primordiale selon Abicham Moles (ceux qui l’ont connu se souviennent de son goût mordant et étincelant du paradoxe) : pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Question métascientifique par excellence, à laquelle aucun savant n’échappe et qui ne comporte aucune réponse scientifique. S’ensuivent deux questions subsidiaires du même ordre : tout ce qui est possible à la science est-il permis aux savants et, dans le cas contraire, au nom de quelle référence supérieure ? pourquoi et comment cette turbulence des éléments ou de la « matière » produit-elle du cosmos et non du chaos ? Dans un monde soumis à l’entropie (loi de dégradation de l’énergie), comment le plus peut-il sortir du moins ?
L’absence de réponse scientifique à la question primordiale emporte l’absence de réponse scientifique à la question ultime : tout ce « quelque chose » en mouvement perpétuel, pour quoi faire au bout du compte ? La science nouvelle a fini par se hisser au sommet de l’échelle des savoirs, au détriment de la théologie longtemps « mère et maîtresse » du savoir humain, mais en s’enfermant dans sa phénoménalité. Avec elle commence le bouleversement radical d’une conception du monde sous pavillon chrétien.
3/auguste comte rêvait d’un gouvernement spirituel des savants, les sages guidés par la raison après les mages inspirés par la religion. Nous en sommes loin. La science a bouleversé notre représentation du monde et transformé nos conditions de vie, mais elle reste affectée d’une double limite fondamentale :
– œuvre de raison, elle s’est asservie aux intérêts, aux passions et aux violences de nos sociétés, et, au lendemain de la Grande Guerre, Jules Isaac n’hésitera pas à la qualifier de « science homicide » ;
– règle de vie, elle ne répond pas plus à la question ultime qu’à la question primordiale : tout ce « quelque chose » en ébullition, pour quoi faire et pour aller où ? pourquoi l’homme et l’humanité ? pourquoi tant d’énergies, d’inventions, de chefs-d’œuvre et de sacrifices, si le dernier mot revient à la mort et au néant ? C’est bien cette question sans réponse qui traverse la somme d’Émile Blamont, Histoire politique de la science, où il associe le dernier Juif à Auschwitz et le premier cosmonaute sur la Lune.
4/thomas d’aquin s’était posé la question de la possible éternité du monde créé par Dieu, c’est-à-dire de la matière. C’était une curiosité de philosophe aristotélicien. Pendant des siècles, la Bible a été lue sans personne pour s’interroger sur la datation de cette création : la suite des événements, d’Adam et Ève à Abraham, en passant par les patriarches d’une exceptionnelle longévité, se suffisait à elle-même.
L’astronomie copernicienne-galiléenne et l’héliocentrisme ont ouvert la voie à la science nouvelle sans modifier encore son rapport au texte biblique. Le nouveau rapport naîtra à partir de la Renaissance grâce à l’éveil d’une conscience historique et de préoccupations historiennes. On passe alors de la Bible comme livre d’histoire, susceptible d’une lecture immédiate, aux méthodes critiques de l’histoire appliquées à la Bible comme document, et des quatre sens traditionnels de l’écriture sainte (magistralement étudiés par le P. de Lubac) à son sens proprement historique, inconnu des anciens âges, qui débouchera sur la « crise moderniste » à l’aube du XXe siècle.
Le monde chrétien s’est beaucoup plus préoccupé de la fin des temps – l’apocalypse, échéance redoutable – que de l’origine du monde. Les premiers artisans de ce changement radical de « paradigme » (Edgar Morin) ou d’« épistémè » (Michel Foucault) ont été les savants computistes des XVIe-XVIIe siècles perchés sur les données chiffrées de la Bible prise à la lettre et peinant à s’accorder sur leurs additions : un calcul purement rationnel, ne faisant aucun appel à la foi. Les concordistes du XIXe siècle ne pensèrent pas autrement que les computistes. Le scepticisme de Voltaire se montrera plus perspicace dans son Dictionnaire philosophique : « L’auteur de la Genèse écrivait pour enseigner les voies de Dieu et non pas la physique ».
Ainsi s’est introduite (tardivement) et imposée (globalement) dans l’univers chrétien une chronologie courte : moins de dix mille ans du premier jour de la création au jugement dernier. Le début de l’ère chrétienne à la naissance de Jésus a été celé au VIe siècle par le moine Denys le Petit sur la fondation de Rome environ 753 ans avant, la plus ancienne date attestée. Jusqu’au XVIIIe siècle, la véridicité de la Bible a été une évidence admise avant tout examen. Avec les Lumières commencera le temps de la « mise à nu » du christianisme et de ses enseignements.
Cette chronologie courte a eu la vie dure : jusqu’à la fin du XIXe siècle au moins si l’on en juge par les manuels scolaires publics ou privés, d’accord sur ce point ; jusqu’en 1870, sous le pontificat de Pie IX, selon l’Annuario pontificio à Rome ; encore aujourd’hui, quelle que soit l’interprétation qui en est faite, pour la tradition juive et pour la tradition maçonnique.
L’ouverture à l’histoire a débouché dans un premier temps sur le travail pointilliste des computistes, puis, dans un second temps, sur l’étude critique de la Bible qui devient une affaire de spécialistes, les exégètes ou, comme disent leurs détracteurs, les « rongeurs de textes ».
Les premiers chapitres de la Genèse étant dépourvus de toute valeur historique n’ont guère retenu l’attention des exégètes, hors l’histoire de leur rédaction à partir de plusieurs documents. On regrette d’autant plus que le seul grand commentaire français du premier Livre de la Bible, dû au P. Lagrange, ne soit jamais sorti du placard où ses épreuves – interdites de publication – sont enfermées depuis 1905.
En fait, le changement de « paradigme » ou d’« épistémè » qui va faire éclater la représentation biblique du monde ne viendra ni de la nouvelle exégèse, ni même de l’héliocentrisme copernicien-galiléen qui a ouvert la voie à la science nouvelle sans modifier son rapport au texte biblique. Il résulte après l’ouverture à l’histoire, de l’ouverture de l’histoire à la préhistoire, à la paléontologie, à la géologie et à la cosmologie.
Une ouverture récente : en 1844, Boucher de Perthes croit retrouver en Picardie les restes d’un homme « antédiluvien ». L’homme de Néanderthal est découvert douze ans plus tard, en 1856, trois avant L’Origine des espèces de Darwin en 1859, que suivra en 1868 la découverte de l’homme de Cro-Magnon. On ne cesse de reculer l’ancienneté de l’homo sapiens dont les ancêtres plongent dans la nuit des temps. La géologie elle-même se met de la partie (âges de la Terre jusqu’à notre ère quaternaire, dérive des continents, nappes de charriage, etc.). Mais c’est de l’astrophysique que viendra le coup décisif avec le big bang de l’« atome primitif » voici douze ou quinze milliards d’années : une théorie proposée initialement en 1927 par l’abbé Georges Lemaître (1894-1966), professeur à l’université catholique de Louvain et, par décision de Pie XI, premier secrétaire de l’Académie pontificale des sciences.
Une histoire naturelle – concept dû à Buffon – se met ainsi en place et, progressivement, s’étend à tout l’univers matériel, de l’infiniment grand à l’infiniment petit, caractérisé par la « flèche du temps » qui conduit de la matière inanimée aux anthropoïdes et à « l’entrée dans l’humain » (Ignace Meyerson). Face à elle, se dresse comme la statue du Commandeur la vieille Histoire sainte selon la Bible et tous les problèmes posés par leur confrontation. L’une se passe de Dieu (elle n’a aucun besoin de cette « hypothèse » qui n’a servi qu’à contrarier son progrès), dont l’autre faisait sa réalité centrale et englobante.
On en est ainsi arrivé à une complète redistribution des cartes, comme Teilhard de Chardin a été le premier homme de science et de foi à le montrer. On peut admirer ou critiquer sa vision à la fois poétique et prophétique : elle n’est qu’un épiphénomène. L’essentiel est en amont, à savoir le sérieux, la profondeur et l’ampleur de cette transformation, qu’aucune discussion de détail ne doit perdre de vue. Notre culture est sortie de l’Histoire sainte et a construit, continue de construire sa propre histoire naturelle. Le risque est de s’enfermer dans le domaine de la dispute, là où surgit l’appel à un remembrement de la pensée chrétienne devant une situation intellectuelle inédite.
6/le refus de voir et d’accepter cette nécessité conduit aux thèses « créationnistes » (théologiques) ou simplement « fixistes » (biologiques), qui se nourrissent des excès et des insuffisances des thèses « transformistes » ou « évolutionnistes », dont les promoteurs s’étaient eux-mêmes trop vite persuadés, à l’exemple de Marcelin Berthelot, que leur science serait bientôt au bout de ses peines, que le monde était désormais sans énigme et sans obscurité. La théorie de la « fin de la science » n’est qu’un secteur, trop négligé, de la théorie plus générale de « la fin de l’histoire », remise au goût du jour par Francis Fukuyama en 1989, après la chute du mur de Berlin, et radicalement critiquée un siècle et demi plus tôt par Charles Fourier, le socialiste utopique.
Entre la condamnation et la célébration de l’évolution, l’espace n’est pas homogène : il comporte des niveaux et, à chaque niveau, des étapes ou des moments. Le vocabulaire est tardif : les lexicographes datent transformisme de 1867 et évolutionnisme de la même période sans trop de précision. Dans son Vocabulaire technique et critique de la philosophie (édition de 1972), André Lalande voit dans le mot évolution « un des termes philosophiques qui reçoivent les sens les plus vagues et même les plus opposés ». Sa vogue est due à Spencer, alors qu’on ne le trouve pas dans L’Origine des espèces en 1859 (tout comme capitalisme dans l’œuvre de Karl Marx).
Avec Darwin, le mot renvoyait à la variabilité des espèces, intraspécifique au premier chef. L’idée s’est progressivement mais rapidement généralisée et vulgarisée. Elle était désormais dans l’air du temps, ce qui est un fait de société, de culture, de sensibilité, sans être un fait de science. Le premier et le meilleur témoin en est sans doute Ernest Renan, en 1870, dans sa Préface à L’Avenir de la science (écrit en 1848 sans être publié) :
Je voyais bien que tout se fait dans l’humanité et dans la nature, que la création n’a pas de place dans la série des effets et des causes. Trop peu naturaliste pour suivre les voies de la vie dans le labyrinthe que nous voyons, j’étais évolutionniste décidé en tout ce qui concerne les produits de l’humanité, langues, écritures, littératures, législations, forces sociales…
Près d’un siècle plus tard, en 1964, dans Le geste et la parole, André Leroi-Gourhan, professeur au Collège de France où il avait succédé à l’abbé Breuil, observera qu’on peut avoir des convictions opposées – métaphysiques ou rationalistes – et des explications différentes, mais partager l’idée que « le courant par lequel nous sommes portés est bien le courant de l’évolution ».
Jacques Ruffié, également professeur au Collège de France, pensait de son côté que le fait était désormais indiscutable : le transformisme était né d’un postulat « aujourd’hui largement démontré ». La démonstration pourra être indéfiniment discutée, mais, ici, l’évidence s’est imposée, plus forte que tout raisonnement, par une accumulation de faits d’ordres divers allant sans discontinuer de l’atome primitif au règne humain.
Éminent géologue catholique, aussi attentif à la Bible qu’aux faits, Pierre Termier en avait pris acte depuis plus d’un demi-siècle, sans concession au matérialisme. À ses yeux, il est devenu clair comme de l’eau de roche que la chronologie courte s’efface sans appel – « grâce à la Science » – devant « le mystère de la Durée ». Il date, en 1925, l’ancienneté de l’homme « entre 30 et 50 000 ans, peut-être davantage, mais qu’importe ». Quant au processus d’hominisation, c’est une autre affaire. Les découvertes fossiles ne cessent de l’allonger : deux millions d’années quarante ans plus tard, et plus du triple aujourd’hui. Si l’on remonte aux origines de la vie, estime Pierre Termier en 1920, il faut sans doute compter en « centaines de millions d’années ». En deçà, ce sont les temps cosmiques, « un domaine à peu près impénétrable ». Il n’imaginait pas, sept ans plus tard, l’hypothèse déjà évoquée du chanoine Georges Lemaître de l’atome primitif et les douze milliards d’années attribuées à son big bang.
C’est la voie acceptée par l’autorité suprême de l’Église catholique depuis le pape Pie XII et son encyclique Humani generis (1950), pourtant restrictive : « Le magistère de l’Église n’interdit pas que la doctrine de l’évolution, dans la mesure où elle recherche l’origine du corps humain à partir d’une matière préexistante et vivante – car la foi catholique nous ordonne de maintenir la création immédiate des âmes par Dieu –, soit l’objet, dans l’état des sciences et de la théologie, d’enquêtes et de débats entre les savants de l’un et de l’autre parti ». La position de Benoît XVI, dans Création et évolution (2007), est plutôt celle d’une pensée en travail, entre un créationnisme qui exclut la science et un évolutionnisme qui s’aveugle sur ses propres limites.
Cette immense trajectoire donne lieu à deux observations contradictoires : d’une part l’importance primaire des mouvements désordonnés et du gaspillage d’énergies ; d’autre part, l’existence d’un principe d’organisation dans le sens d’une complexité croissante qui a reçu aujourd’hui le nom de développement. L’esprit positif qui anime le travail scientifique répugne à dire que tout cela obéit à un dessein ; il ne peut nier que cette évolution ait un sens dont nul ne peut dire le terme et que nous arrivons à un point où la question ne peut plus être éludée.
En termes généraux, force est de se demander si l’homme est l’étape ultime de cette évolution ou si elle doit se poursuivre sans qu’on puisse beaucoup s’avancer sur ses formes possibles. En termes techniques, deux lignes se dessinent : les manipulations génétiques dont les programmes se multiplient ; les rêves de société virtuelle et de posthumanité qui hantent certains esprits (une exposition sur le thème Post Human s’est tenue en 1992-93 dans quatre grandes villes européennes). Reste enfin l’hypothèse hardiment lancée par Fontenelle en 1686 sur « la pluralité des mondes », à l’origine de nos spéculations sur les « extra-terrestres », dont l’Observatoire du Vatican n’exclut plus l’existence (La Croix, 19 février 2009).
Entre la permanence dans l’être, l’écoulement sans fin ou l’éternel retour, un concept nouveau, central, a percé et s’est imposé : celui d’une genèse fragmentée, ascendante et universelle, avec ses ordres et ses embranchements susceptibles d’une taxinomie, et avec sa floraison de composés (ontogenèse, phylogenèse, morphogenèse, orthogenèse, épigenèse, endogenèse, etc.).
Sans l’avoir cherché, il a rejoint le titre du premier Livre de la Bible, mais affranchi des contraintes et des représentations religieuses qui lui avaient fait obstacle. Il s’est combiné avec l’idée, chère à Condorcet, d’un progrès illimité, même si son inachèvement interdit d’en prédire la suite. Depuis un demi-siècle, accompagné par croissance et expansion, le développement est devenu notre impératif catégorique, avec ses laissés pour compte à la traîne, les « sous-développés ». Il lui est arrivé de s’associer à des théories insoutenables : par exemple le messianisme terrestre d’un peuple élu ou d’une race supérieure ; ou encore ce qu’on a appelé le « darwinisme social », transposition à l’échelle humaine de la lutte pour la vie observée dans les sociétés animales.
De toute évidence, il ne suffit pas d’en appeler à la raison délivrée de la religion pour être au clair avec la charge métascientifique ou parascientifique que véhicule toute pensée humaine, toute société humaine.
7/s’il est un mot à bannir non du dictionnaire, mais des conversations savantes, c’est bien darwinisme en raison de son imprécision congénitale : de la théorie de l’évolution professée par Charles Darwin à partir de L’Origine des espèces (1859) jusqu’à l’ensemble du mouvement d’idées suscitées ou inspirées par son œuvre.
Il faut, certes, commencer par mettre un peu d’ordre dans tant d’interminables discussions et sortir de confusions qui s’entretiennent, mais il faut aussi élever et élargir le débat dans la perspective des questions précédemment soulevées. Il s’agit, en effet, beaucoup plus que d’« histoire des sciences », d’une transformation des mentalités dans leur environnement culturel et religieux – biblique –, sous l’action d’un concept nouveau qui oblige à une totale recomposition de la pensée. Se dessinent ainsi cinq champs d’études spécifiques :
– la pensée de Darwin à partir de ses Œuvres (35 volumes publiés), replacée dans son temps et dans son développement ;
– les théories et les débats autour de l’évolutionnisme et du transformisme qui s’inscrivent dans la postérité intellectuelle de Spencer et de Darwin.
– les réactions et les critiques suscitées par cette « offensive » dans les milieux religieux – catholiques et protestants – d’Europe et d’Amérique, qui dénoncent d’une part le caractère rationaliste, voire matérialiste, de cette entreprise, et d’autre part son incompatibilité avec les enseignements de la Bible ;
Sur cette ligne, le dernier grand savant catholique semble bien Jules Lefèvre (décédé en 1944), dont le Manuel critique de biologie (Paris, Masson, 1938, 1 048 p.) a paru en même temps que le Palais de la Découverte exposait sa Chambre calorimétrique, et dont le fils, l’abbé Luc J.-Lefèvre, qu’il consultait volontiers, formé au Séminaire français de Rome, sera l’un des fondateurs de la revue La Pensée catholique en 1947.
– la voie moyenne suivie par des savants « croyants » et jugés « concordistes », voire « modernistes » par les précédents pour concilier « la science et la foi », ou, plus radicalement, rallier le camp des novateurs sans renoncer à leurs convictions religieuses.
La liste des savants catholiques évolutionnistes, sans référence obligée à Darwin, serait longue : le Père Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), paléontologue, l’abbé Henri Breuil (1877-1961), préhistorien, professeur au Collège de France, et Pierre Termier (1859-1930), mentionné plus haut, géologue, membre de l’Institut, en ont été en leur temps des figures de proue.
L’ouvrage le plus représentatif de cet esprit est sans conteste la somme de Michel Delsol, père de la philosophe Chantal Delsol et directeur d’études à l’école pratique des Hautes études (Lyon, 3e section), L’évolution biologique en vingt propositions (Paris, Vrin, 1991, 850 p.), qui, selon l’auteur, appellerait déjà une mise à jour. La ferme assurance des savants n’a d’égale que leur perpétuelle insatisfaction.
– en oubliant un moment toutes les discussions théoriques, dresser un état des acquisitions, des recherches, des programmes, des questions et des perspectives à ce jour.
On n’arrête pas la recherche, toujours en mouvement, et c’est à elle qu’il faut prêter grande attention, sans jamais s’enfermer dans l’étroit réduit des recherches particulières. Que le monde était simple quand on l’observait à l’œil nu, au pas de l’homme ou de l’animal, et qu’Abraham comptait les étoiles dans le ciel. Plus la recherche avance, plus s’éloigne la clé de l’univers.
Est-il permis de clore ces réflexions par une anecdote ? à un nobliau qui se flattait devant lui de « descendre des croisés », Louis Veuillot répondait : « Moi, je monte d’un tonnelier ». Si l’on avait dit que l’homme montait du singe, la querelle du darwinisme aurait-elle pris le cours qu’on lui a connu ?
Émile POULAT