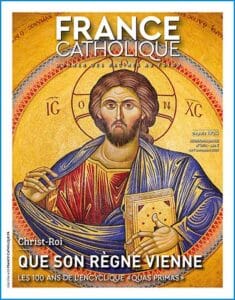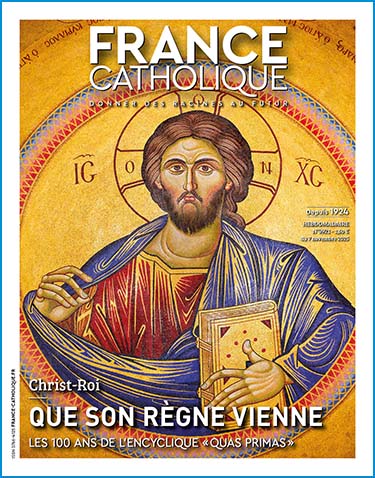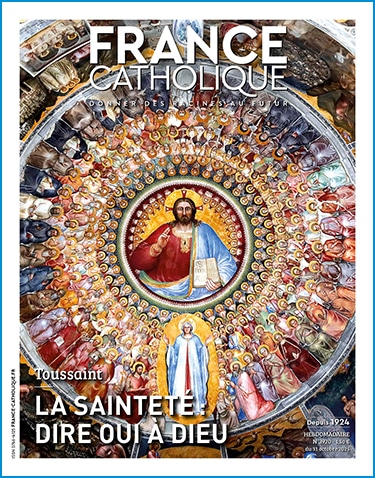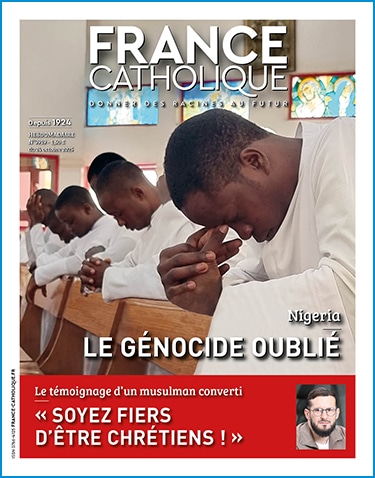L’ auteur s’appelle Aidan Nichols, un dominicain anglais, formé à Oxford et à Edimbourgh, connu déjà pour ses travaux sur Balthasar. C’est un prêtre français, Eric Iborra qui a fort bien traduit l’essai. Nous avions besoin de ce travail à divers titres, notamment pour avoir conscience des grandes articulations de la pensée du Pape. Mais aussi, afin de mesurer le chemin parcouru, des premiers écrits du théologien jusqu’aux textes officiels de l’évêque de Rome. Impossible d’éluder l’importance du Concile sur ce chemin, ne serait-ce que pour tordre le cou de cette opinion, encore couramment professée, qu’il y aurait eu une rupture majeure dans la vie de Joseph Ratzinger, progressiste dans sa jeunesse, puis conservateur, sinon réactionnaire, depuis la crise des années soixante.
Dans mon récent débat de France Culture avec Caroline Fourest, j’ai été obligé de faire une mise au point sur cette affaire, en insistant sur la continuité organique d’une œuvre dont les thématiques essentielles se sont élaborées dans une logique de développement. La réputation progressiste du jeune abbé Ratzinger ne résiste pas à l’examen, notamment à propos de son rôle à Vatican II. C’est pourquoi j’ai lu avec un intérêt profond les pages de Nichols sur la période conciliaire. J’ignorais l’existence de quatre cahiers écrits par le conseiller du Cardinal Frings, archevêque de Cologne, où l’abbé avait noté ses réactions face aux événements conciliaires et à la rédaction du corpus doctrinal au fur et à mesure des sessions. Nul doute que l’intéressé n’ait adhéré de toute son âme à ce qu’il y avait de libérateur au concile dès les premières heures, quand il perçoit qu’on sort de la « névrose anti-moderniste ». Les premières modifications liturgiques sont aussi les bienvenues dans les célébrations à Saint-Pierre, alors qu’il y avait eu un réel malaise lors de la messe d’ouverture, marquée par un cérémonial pesant et l’absence de participation, pour le moins paradoxale, d’une assemblée d’évêques !
Qu’il s’en soit pris avec vigueur à l’usage obligatoire du latin pour enseigner dans les facultés de théologie est aussi compréhensible que sa volonté d’introduire les langues nationales dans la liturgie : « la stérilité de pans entiers de la théologie catholique depuis la fin des Lumières pourrait être en partie imputable à son mariage forcé avec une langue qui a cessée de porter le mouvement de l’esprit humain. » Si de telles prises de position s’opposaient aux convictions et aux attitudes de la curie romaine, singulièrement représentée par l’emblématique cardinal Ottaviani, suffisent-elles à caractériser une tournure d’esprit progressiste ? Évidemment non. Mais l’âpreté des premiers affrontements avec la curie, et la création d’une tendance minoritaire ont donné l’impression, largement orchestrée par les médias, d’une division irréductible entre progressistes et traditionalistes. C’est l’origine, selon moi, d’une méprise totale à propos de Vatican II, dont les véritables intentions et les travaux effectifs se sont trouvés ainsi méconnus ou travestis.
Si l’on donne au progressisme son contenu courant, facilement véhiculé et reçu, on identifie une sorte d’optimisme devant la marche de l’Histoire, optimisme que le christianisme devrait justifier et soutenir plutôt que d’y opposer un pessimisme de principe. En ce sens précis, il est aberrant de voir en l’abbé Ratzinger un adepte du progressisme. Lui, pas plus que ses amis ou maîtres en théologie, n’est disposé à des accommodements faciles avec une quelconque idéologie mondaine. On s’en rend compte à chaque étape des discussions conciliaires lors de la mise au point de ce texte essentiel qu’est Dei Verbum, la constitution sur la Révélation – le père de Lubac y verra le chef-d’œuvre de Vatican II. L’expert Ratzinger s’inquiète que l’on oublie « le mystère de la colère de Dieu », en lequel le drame de la croix trouve toute sa densité sotériologique ».
D’une façon générale, Joseph Ratzinger n’apparaît nullement comme idéologiquement orienté. Il réagit toujours en fonction de son savoir théologique, avec la plus grande exigence. J’ajoute que certains détails font réfléchir, à l’encontre de stéréotypes tenaces sur le déroulement du concile. Ainsi, après l’accrochage très dur en séance plénière où le cardinal Frings s’en est pris au cardinal Ottaviani sur les méthodes pratiquées par le Saint-Office, on apprend, sous la plume du théologien, ceci que je n’ai lu nulle part ailleurs : « Après cette confrontation, les relations personnelles entre Frings et Ottaviani, loin de se refroidir se firent plus chaleureuses. » Ratzinger en attribue la cause à l’atmosphère humaine et spirituelle du concile. C’est peut-être un détail, mais qui me touche. On a pu, en effet, interpréter sur le moment cet accrochage comme le signe d’une irréductible division qui devait se perpétuer jusqu’à la fin de Vatican II. Les choses sont bien plus compliquées, et il y a lieu d’envisager le débat entre évêques selon des paramètres différents d’une assemblée politique.
Mais le point le plus important de discernement pour comprendre les orientations de fond concerne la mise au point de la constitution Gaudium et Spes. Là dessus, Ratzinger confirme les carnets du père de Lubac, en insistant sur la rupture entre Français et Allemands, en désaccord quant à l’optimisme du schéma 13, à partir duquel fut élaborée la doctrine sur l’Église et le monde. L’affaire est capitale et peu comprise encore aujourd’hui, car l’opposition ne concerne plus la minorité dite conservatrice vis-à-vis de la majorité dite réformatrice. Elle est interne à la dite majorité. Et il apparaît que la critique du progressisme post-concilaire est déjà présente au concile, de la part de figures de proue de la théologie comme Lubac et Ratzinger. Ce dernier s’opposait, par exemple, écrit Aidan Nichols à « un teilhardisme vulgarisé pour lequel progrès humain et espérance chrétienne, libération technologique et rédemption chrétienne sont placées sur une ligne de continuité linéaire, quand ils ne sont pas tout simplement tenus pour synonymes ».
Au fur et à mesure qu’on s’achemine vers la fin de la quatrième session, la dernière, Ratzinger se fait de plus en plus critique à l’égard du climat « sensationnaliste » qui entoure les travaux des Pères. Il craint que le nécessaire Renouveau ne soit comme une dilution et une banalisation de l’ensemble du message de l’Église. Ceci étant établi, que reste-t-il de sérieux dans la légende d’un Ratzinger progressiste repenti ? Absolument rien. S’il est vrai que le jeune théologien combattit une certaine scholastique étroite, s’il se montra sévère, un moment, pour une fixation exclusive sur la période tridentine, il ne voulut jamais que l’ouverture à la grande tradition ecclésiale, solidaire de ce point de vue avec ce que les grands théologiens du vingtième siècle avaient voulu dans une ligne très newmanienne. Je pense à Congar, si impressionné par l’école catholique de Tübingen, celle du XIXe siècle avec la figure de Moehler. Mais j’insiste sur ce point capital que les controverses post-concilaires qui vont provoquer des clivages sérieux dans l’Église ont commencé au concile et notamment lors de l’élaboration de Gaudium et Spes.
Il est donc proprement aberrant d’affirmer que le prétendu tournant « conservateur » de Ratzinger aurait eu lieu en 1968, ou à sa suite, à cause des désagréments du professeur de théologie chahuté par des étudiants contestataires du style gauchiste. Il semble que Hans Küng soit à l’origine de cette rumeur concernant son collègue de Tübingen des années soixante. Mais là-dessus, l’ancien professeur a fait une mise au point que l’on doit considérer avec attention. À son interlocuteur Peter Seewald, qui lui rappelait qu’il aurait été agressé par des étudiants allant jusqu’à lui arracher le micro, le cardinal Ratzinger précise : « On ne m’a jamais arraché le micro. Je n’ai pas eu non plus de difficultés avec les étudiants, mais plutôt avec le milieu des non-titulaires, les assistants et autres. Le cours de Tübingen a toujours été très bien reçu, le contact avec les étudiants était très bon. Mais c’est vrai, j’ai assisté à l’intrusion d’un esprit nouveau où des idéologies fanatiques se servaient des instruments du christianisme, et là, j’ai réellement décelé du mensonge. J’ai vu nettement, et réellement vécu, que les concepts de réforme se divisaient. Que l’on faisait un mauvais usage de l’Église et de la foi, que l’on revendiquait celle-ci comme un instrument de pouvoir, mais pour de tout autres buts et avec de tout autres pensées et idées. La volonté unanime de servir la foi était brisée. Au lieu de cela, la foi servait d’instrument aux idéologies, qui étaient tyranniques, brutales et cruelles. » [Le sel de la terre, Flammarion-Cerf, 1997. 1ère édition]
Rien n’est plus redoutable que les légendes, surtout lorsqu’elles veulent symboliser, en quelque sorte, des idées reçues fussent-elles fausses. De Jacques Duquesne à Caroline Foureste, en passant par une multitude de vulgarisateurs, il semble que celle du progressisme premier de Joseph Ratzinger soit increvable. Elle est pourtant contraire à la vérité restituée grâce à des documents peu réfutables.
Gérard LECLERC
— –
Aidan Nichols, La pensée de Benoît XVI : Introduction à la théologie de Joseph Ratzinger, éd. Ad Solem, 494 pages, 29 €.